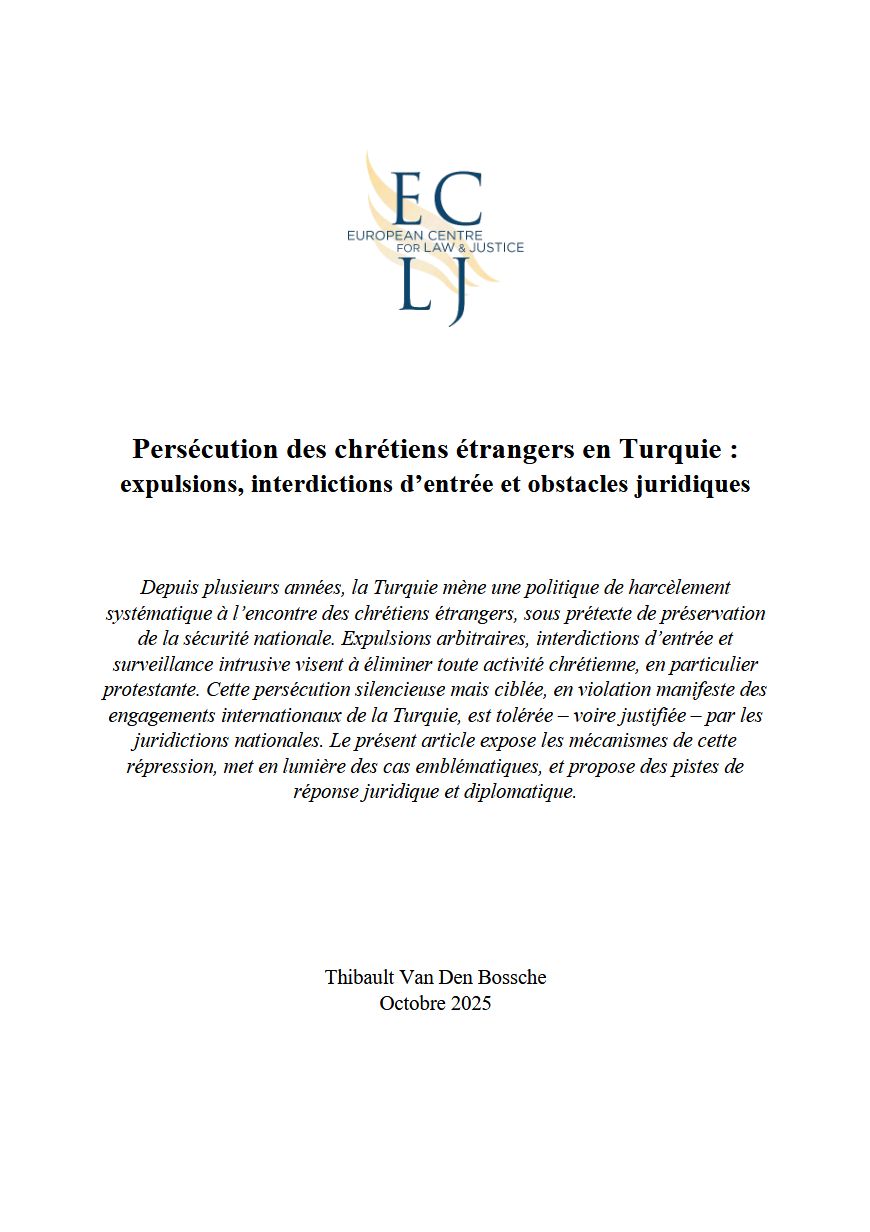La persécution des chrétiens étrangers en Turquie
La persécution des chrétiens étrangers en Turquie
Depuis plusieurs années, la Turquie mène une politique de harcèlement systématique à l’encontre des chrétiens étrangers, sous prétexte de préservation de la sécurité nationale. Expulsions arbitraires, interdictions d’entrée et surveillance intrusive visent à éliminer toute activité chrétienne, en particulier protestante. Cette persécution silencieuse mais ciblée, en violation manifeste des engagements internationaux de la Turquie, est tolérée – voire justifiée – par les juridictions nationales. Le présent article expose les mécanismes de cette répression, met en lumière des cas emblématiques, et propose des pistes de réponse juridique et diplomatique.
1. Introduction : Une recrudescence des persécutions et du harcèlement juridique visant les chrétiens étrangers en Turquie
Depuis la fondation de la République de Türkiye (ci-après « la Turquie »), les autorités ont soumis les minorités religieuses non musulmanes à une discrimination d’ordre juridique et culturel. Aujourd’hui, le gouvernement turc s’appuie sur le droit national pour neutraliser les accords internationaux, entraînant une éradication progressive de la présence chrétienne étrangère sur son territoire.
Ce rapport vise à attirer l’attention sur l’aggravation rapide des mauvais traitements infligés aux chrétiens étrangers par des moyens injustifiés, et à encourager une application plus stricte des accords internationaux existants garantissant les droits fondamentaux de la personne.
Il offre un aperçu démographique des groupes chrétiens présents en Turquie, examine les lois censées protéger leurs droits, et résume plusieurs affaires illustrant la diversité des situations auxquelles sont confrontés les chrétiens lorsqu’ils saisissent les juridictions turques ou la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).
2. Population chrétienne en Turquie : déclin brutal, et danger pour les chrétiens non turcs
Sur les 86,3 millions d’habitants que compte approximativement la Turquie, moins de 0,3 % sont chrétiens[1]. Cette proportion a chuté d’environ 20 % au début du XXe siècle à moins de 0,3 % aujourd’hui[2]. Bien que la population chrétienne soit composée de plusieurs confessions, le gouvernement turc ne reconnaît officiellement que trois minorités religieuses : les chrétiens arméniens apostoliques, les juifs et les chrétiens grecs orthodoxes[3]. En limitant la reconnaissance à ces seuls groupes, les autorités s’exonèrent de toute responsabilité quant à la protection des droits des autres minorités religieuses[4].
La Turquie accueille par ailleurs un grand nombre d’étrangers. En 2025, le groupe de travail des Nations unies sur les migrations recensait 4,1 millions d’étrangers en Turquie, dont environ 1 million titulaires d’un permis de séjour, et 3 millions de réfugiés demandant une protection internationale[5]. Aucune donnée officielle ne documente la composition religieuse de ces populations étrangères.
Entre 2019 et 2024, 132 chrétiens étrangers ont été expulsés de Turquie après avoir reçu un code d’interdiction d’entrée. Ce nombre atteint 303 si l’on inclut 52 conjoints et 119 enfants mineurs qui ont dû quitter le pays afin de ne pas séparer leurs familles.[6] Ces dernières années, des affaires contestant de telles expulsions ont été portées de plus en plus souvent devant les plus hautes juridictions turques ainsi que devant des institutions internationales.[7] Depuis l’arrestation du pasteur Andrew Brunson en 2016, les chrétiens étrangers subissent des sanctions arbitraires pour avoir participé à des activités chrétiennes pourtant légales en Turquie[8].
Parmi les affaires emblématiques portées devant la CEDH figurent : Cox c. Turquie (2010), M.B. et autres c. Turquie (2010), Bremner c. Turquie (2015). D’autres sont actuellement en instance (Kenneth Wiest c. Turquie), ont été récemment soumises (Rachel et Mario Zalma, David et Pamela Wilson, David Byle[9]), ou n’ont pas encore été déposées devant la Cour (Amanda Jolyn Krause et autres, Joy Subasiguller). Parallèlement, aucune mesure équivalente n’a été mise en œuvre contre des missionnaires musulmans étrangers[10].
3. Qui sont les chrétiens étrangers visés par la Turquie ?
Les chrétiens étrangers visés par la Turquie sont principalement des missionnaires protestants et des responsables d’églises, mais aussi des croyants laïcs, des conjoints de citoyens turcs et des réfugiés convertis au christianisme. Ils viennent de divers horizons nationaux — Américains, Sud-Coréens, Allemands, Australiens, Canadiens, Iraniens — et jouent souvent un rôle actif dans les communautés chrétiennes à travers la Turquie.
3.1. Missionnaires occidentaux et membres engagés de l’Église
Depuis la tentative de coup d’État de 2016, la Turquie a intensifié l’usage des lois sur la migration et la sécurité pour surveiller et restreindre les étrangers, en qualifiant de plus en plus les missionnaires et pasteurs chrétiens de menaces potentielles. Cette logique sécuritaire, combinée à un nationalisme croissant et à l’hostilité envers les minorités religieuses, a entraîné une hausse marquée des expulsions de chrétiens étrangers. Beaucoup étaient des résidents de longue date qui vivaient paisiblement en Turquie depuis des années et y avaient souvent fondé une famille. Ces personnes ont été :
- Frappées d’interdictions d’entrée (notamment via le code N-82),
- Qualifiées de menaces pour l’ordre public et la sécurité sans preuves concrètes,
- Privées de recours effectifs devant les tribunaux turcs.
3.2. Conjoints de citoyens turcs
Même les conjoints étrangers de chrétiens turcs ne sont pas épargnés. L’un des cas les plus marquants est celui de Joy Subasiguller, une Américaine mariée à un pasteur protestant turc et mère de trois enfants turcs, qui a été expulsée sans qu’aucune charge formelle ne soit retenue contre elle. Ces situations illustrent la manière dont la Turquie instrumentalise le statut d’« étranger » pour cibler les familles chrétiennes et faire pression sur les citoyens turcs impliqués dans la vie ecclésiale.
3.3. Réfugiés chrétiens ex-musulmans
Les chrétiens convertis originaires d’Iran, d’Afghanistan et d’autres pays à majorité musulmane sont également concernés. Ces personnes demandent l’asile en Turquie en raison des persécutions religieuses qu’elles subissent dans leur pays d’origine. Contrairement au traitement réservé aux réfugiés musulmans, les réfugiés chrétiens sont souvent confrontés à[11] :
- Des comportements hostiles et empreints d’ignorance de la part des agents lors des entretiens de demande d’asile,
- Des interrogatoires mettant en doute la sincérité ou la légitimité de leur conversion,
- Des expulsions en violation du principe de non-refoulement prévu par le droit international, alors que nombre d’entre eux risquent l’exécution, l’emprisonnement ou la torture en cas de retour dans leur pays[12].
4. Cadre juridique utilisé pour expulser les chrétiens étrangers de Turquie et affaiblir le christianisme national
4.1. Le droit turc de l’immigration : les restrictions N-82 et G-87
La loi n° 6458 relative aux étrangers et à la protection internationale, adoptée en 2013, confère aux autorités turques un large pouvoir discrétionnaire pour restreindre la présence d’étrangers[13]. Les articles 7, 15, 32, 33 et 45 prévoient que tout étranger considéré comme une menace pour « l’ordre ou la sécurité publics » peut se voir refuser un visa, l’entrée sur le territoire, le renouvellement de ses permis de séjour ou l’accès à un titre de séjour de longue durée[14]. En pratique, ces dispositions sont devenues des outils puissants pour limiter les activités des chrétiens étrangers sous couvert de sécurité nationale.
Deux codes sont systématiquement utilisés pour appliquer ces restrictions[15]. Le code G-87 est imposé lorsque les autorités soupçonnent simplement un individu de représenter un danger pour la sécurité nationale[16]. Alors que la plupart des codes « G » concernent des activités criminelles avérées, le G-87 repose uniquement sur des « données » fournies par l’Organisation nationale du renseignement (Millî İstihbarat Teşkilatı, MIT). Aucune preuve corroborante n’est exigée. Une fois appliqué, il entraîne l’expulsion immédiate et une interdiction automatique d’entrée.
Le code N-82 fonctionne différemment mais entraîne des conséquences tout aussi graves. Il impose aux étrangers d’obtenir une autorisation préalable avant de pouvoir revenir en Turquie. En théorie, les intéressés peuvent déposer une demande auprès de la Direction générale de la gestion des migrations. En pratique, ces demandes sont systématiquement rejetées, transformant la restriction en une interdiction permanente de facto[17]. Jusqu’à présent, aucun cas n’a permis un retour effectif : chaque refus s’est traduit par une exclusion indéfinie.
L’ampleur de cette politique témoigne de son caractère systématique. Entre 2019 et 2024, 132 protestants ont déclaré avoir reçu un code d’interdiction d’entrée, la quasi-totalité sous le régime du N-82. Des personnes ayant reçu ce code il y a plus de cinq ans et ayant tenté de revenir en Turquie comme simples touristes ont également été refoulées, démontrant que cette mesure « temporaire » fonctionne en réalité comme une interdiction à vie. Un plus petit nombre de protestants, bien qu’ils n’aient aucun casier judiciaire, aucune enquête en cours et qu’aucune preuve n’ait été présentée contre eux, ont été frappés du code G-87, habituellement réservé dans d’autres pays aux individus impliqués dans le terrorisme, les conflits armés ou l’extrémisme violent.
Bien que le droit turc prévoie en théorie des recours administratifs et judiciaires, ceux-ci sont illusoires. Les preuves décisives — les rapports classifiés du MIT — ne sont jamais communiquées à l’intéressé ni à ses avocats. Les tribunaux, au lieu d’examiner ces dossiers secrets, se contentent de s’en remettre aveuglément à l’exécutif. Ce mécanisme prive les justiciables de toute possibilité de contester les accusations portées contre eux et constitue une violation flagrante du droit à un procès équitable. Il vide également de sa substance le droit à un recours effectif garanti par le droit international des droits de l’homme, notamment par l’article 6 §1 et l’article 13 de la CEDH, ainsi que par l’article 1 du Protocole n° 7 en cas d’expulsion.
Ces codes ont été largement utilisés contre des chrétiens étrangers qui vivaient paisiblement en Turquie depuis des années, souvent mariés à des citoyens turcs et y élevant leurs enfants. Leur seul « tort » était de participer à des activités religieuses ou communautaires légales. Étiquetés comme menaces pour la sécurité sans aucune preuve, ils ont été expulsés ou exclus de manière à dévaster leurs familles et leurs communautés ecclésiales. Cette stigmatisation blesse profondément non seulement les personnes directement concernées, mais aussi la communauté chrétienne dans son ensemble.
4.2. Des expulsions systématiques pour affaiblir le christianisme local
Les expulsions de chrétiens étrangers ne sont pas de simples actes administratifs isolés mais s’inscrivent dans une stratégie délibérée. En ciblant systématiquement les pasteurs, missionnaires et responsables laïcs, les autorités turques frappent le cœur structurel des communautés protestantes. Beaucoup d’églises en Turquie dépendent largement de la présence de chrétiens étrangers pour l’encadrement pastoral, la formation théologique et le soutien communautaire. Leur départ laisse les congrégations sans direction, vulnérables et plus facilement intimidées.
Cette stratégie envoie également un avertissement clair aux citoyens turcs qui se sont convertis au christianisme ou qui entretiennent des liens avec des croyants étrangers. Le message implicite est sans équivoque : le christianisme est étranger, illégitime et dangereux. En qualifiant les pasteurs étrangers de menaces pour la sécurité nationale, les autorités stigmatisent non seulement leurs activités, mais aussi les chrétiens turcs qui prient et servent à leurs côtés.
La logique sous-jacente à cette approche est particulièrement préoccupante. Si les chrétiens étrangers sont accusés de commettre des « crimes » contre la Turquie, avec qui les commettraient-ils sinon avec les communautés locales ? Inévitablement, le soupçon rejaillit sur la communauté protestante nationale. Cela alimente un climat d’intimidation dans lequel les croyants locaux craignent la surveillance, le harcèlement et même la criminalisation, simplement pour avoir pratiqué leur foi en communion avec des étrangers.
Les conséquences dépassent largement les individus ciblés. En 2025, la loi turque interdisait toujours la formation des membres du clergé chrétien ou la création d’institutions d’enseignement religieux. Pourtant, le droit de former et de nommer des responsables religieux constitue l’un des piliers essentiels de la liberté de religion ou de conviction (article 9 de la CEDH). Privée de ce droit, la communauté protestante a dû improviser des solutions précaires : formation par compagnonnage, séminaires de petite taille, envoi d’étudiants à l’étranger, ou encore recours au soutien de clergé étranger. Mais à mesure que ces derniers sont expulsés ou interdits de territoire, même ces structures fragiles s’effondrent, laissant les congrégations sans encadrement qualifié.
Le coût humain de cette politique est dévastateur. Beaucoup de ceux qui ont été expulsés ou bannis vivaient en Turquie depuis des décennies, y avaient fondé une famille et contribuaient pacifiquement à leur communauté. Lorsqu’un membre de la famille reçoit soudain un code N-82 ou G-87, l’unité familiale est brisée, laissant conjoints et enfants dans une situation légale et émotionnelle précaire. Dans certains cas, même lorsque les tribunaux ordonnaient la levée d’un code ou le renouvellement d’un permis de séjour, les autorités refusaient de se conformer, annulant les documents ou réimposant les interdictions. Les familles n’avaient d’autre recours que de saisir la Cour constitutionnelle et, en cas d’échec, de se tourner vers la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette double dynamique — expulsions forcées, discriminatoires et illégales d’un côté, érosion silencieuse de l’autre — est en train de miner le protestantisme en Turquie de l’intérieur. Les affaires présentées ci-après montrent comment la Turquie a utilisé les codes N-82 et G-87 pour cibler des chrétiens étrangers au moyen de mesures à la fois arbitraires en droit et dévastatrices dans leurs effets.
5. Le déni de justice devant les tribunaux turcs
5.1. Amanda Jolyn Krause et autres (2024)
Le 15 février 2024, la Cour constitutionnelle de Turquie a rendu son arrêt dans l’affaire Amanda Jolyn Krause et autres (requête n° 2019/40761), concernant neuf protestants étrangers originaires des États-Unis, d’Allemagne et d’Australie[18]. Tous vivaient légalement en Turquie avec des permis de séjour jusqu’à ce qu’ils soient frappés du code N-82, sur la base de rapports confidentiels de l’Organisation nationale du renseignement (MIT). Le MIT considère systématiquement tout membre non turc de la communauté protestante en Turquie comme un espion[19]. Ce code N-82 a conduit au refus de renouvellement de leurs permis de séjour, à des ordres d’expulsion ou au refus de visas lorsque les intéressés tentaient de rentrer en Turquie.
Les activités reprochées étaient la participation à des rassemblements protestants, des actions missionnaires, et, dans certains cas, la présence à la Conférence familiale de 2019 organisée par l’Association des Églises protestantes, qui avait réuni 120 personnes principalement venues des États-Unis, d’Allemagne et du Royaume-Uni. Aucun des requérants n’a été inculpé d’une infraction pénale, et aucune enquête criminelle n’a été ouverte contre eux.
Les requérants ont invoqué la violation de plusieurs droits : la liberté de religion (article 24 de la Constitution ; article 9 CEDH), la liberté de réunion (article 34 de la Constitution ; article 11 CEDH), la vie privée et familiale (article 20 de la Constitution ; article 8 CEDH), le droit à un procès équitable (article 36 de la Constitution ; article 6 §1 CEDH), le droit à un recours effectif (article 40 de la Constitution ; article 13 CEDH), les garanties procédurales en matière d’expulsion (article 1 du Protocole n° 7) et l’interdiction de la discrimination (article 10 de la Constitution ; article 14 CEDH). Ils soutenaient n’avoir jamais été informés des accusations concrètes portées contre eux, et rappelaient que l’activité missionnaire est légale en Turquie.
La majorité de la Cour a rejeté ces arguments. Elle a estimé que, puisque les requérants n’avaient pas été empêchés de pratiquer leur culte lorsqu’ils vivaient en Turquie, leur liberté de religion n’avait pas été atteinte ; cette partie de la requête a donc été déclarée irrecevable comme manifestement mal fondée. Concernant le droit à un recours effectif, elle a jugé que le contrôle juridictionnel par les tribunaux administratifs était suffisant, bien que les rapports de renseignement décisifs n’aient jamais été communiqués aux requérants ni à leurs avocats. Surtout, la Cour s’est appuyée sur la doctrine de la souveraineté de l’État en matière d’immigration et de sécurité nationale, considérant que la Turquie dispose d’un pouvoir discrétionnaire très large pour admettre ou exclure des étrangers. En érigeant ainsi la souveraineté au-dessus du droit, la Cour a de facto placé la Turquie hors de portée des garanties constitutionnelles et internationales dès lors que l’État invoque la sécurité.
Sur les 13 juges siégeant, neuf ont exprimé des opinions dissidentes. Six d’entre eux, dont le président Zühtü Arslan, ont estimé que les droits des requérants avaient été violés. Ils ont souligné que l’activité missionnaire pacifique et la participation à une conférence sont des formes d’expression religieuse protégées par la Constitution et la CEDH, et qu’elles ne peuvent être assimilées à une menace pour l’ordre public sans preuves concrètes. Pour eux, la liberté de religion inclut non seulement le droit de culte privé, mais aussi le droit de participer à la vie religieuse collective, y compris l’évangélisation. Ils ont en outre affirmé que les recours juridictionnels sont illusoires lorsque les tribunaux ne peuvent pas examiner les preuves et que les requérants ne connaissent pas les accusations. Ils ont insisté sur le fait que la protection juridictionnelle effective exige un procès contradictoire, où les rapports de renseignement doivent être soumis à un véritable examen, et non acceptés aveuglément.
Les opinions dissidentes ne contestent pas que des restrictions puissent être imposées à des activités missionnaires dans certaines circonstances liées à la sécurité publique. Mais, dans ce cas, les autorités doivent démontrer la réalité de la menace par une justification pertinente et suffisante.
En revanche, trois autres juges ont exprimé une dissidence en sens plus restrictif, estimant que même les griefs relatifs au droit à un recours effectif auraient dû être déclarés irrecevables. Cela montre que la Cour était divisée non seulement entre protection et restriction des droits, mais aussi sur la possibilité même d’un contrôle constitutionnel.
L’importance de l’affaire Krause réside précisément dans cette fracture nette. Alors que l’opinion majoritaire consacre une doctrine de souveraineté absolue, plaçant la Turquie au-delà des garanties constitutionnelles substantielles, les opinions dissidentes posent un raisonnement de principe conforme à la jurisprudence de Strasbourg. Elles montrent qu’au sein même de la plus haute juridiction turque existe une reconnaissance du fait que le refus d’accès aux preuves et l’assimilation d’activités religieuses licites à des menaces sécuritaires sont incompatibles avec la Constitution comme avec la CEDH. Ces opinions dissidentes offrent donc une base solide pour un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme, où les requérants pourront invoquer la violation des articles 9 et 13 de la CEDH ainsi que du Protocole n° 7, en s’appuyant sur les arguments déjà développés par le président et plusieurs juges de la Cour constitutionnelle.
5.2. Dave et Pamela Wilson
David et Pamela Wilson vivaient en Turquie depuis 35 ans lorsqu’ils se sont vu refuser l’entrée sur le territoire à leur retour d’un voyage aux États-Unis[20]. Le ministère de David en Turquie consistait notamment en de l’évangélisation de porte à porte, comprenant le partage de messages bibliques et l’invitation à des études bibliques[21]. Le couple avait déjà échappé à plusieurs tentatives d’expulsion par le passé, mais après un séjour aux États-Unis en février 2019, les autorités de l’aéroport d’Istanbul leur ont annoncé qu’ils faisaient l’objet à la fois d’un ordre d’expulsion et d’une interdiction d’entrée. Leur affaire est actuellement pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
5.3. Rachel et Mario Zalma
Rachel et Mario Zalma se sont installés à Istanbul en 2009 pour soutenir une nouvelle église chrétienne. Le couple s’est fortement impliqué dans l’église et dans la vie locale, notamment en dispensant des cours d’anglais et en organisant des activités de garde d’enfants. En 2019, les Zalma participent à la conférence familiale de l’Association des Églises protestantes de Turquie. Peu après, alors qu’ils tentent de se rendre au Royaume-Uni pour rendre visite à leur famille, ils sont arrêtés à l’aéroport. En juin 2020, le gouvernement leur impose à tous deux un règlement de restriction N-82. Les Zalma sont alors retournés volontairement en Angleterre, et cherchent désormais à obtenir une intervention internationale devant la Cour européenne des droits de l’homme.
5.4. David Byle
David Byle est un citoyen américano-canadien qui a vécu à Istanbul pendant 19 ans, où il a élevé ses cinq enfants. Il a été accusé de porter atteinte à la sécurité de l’État pour avoir témoigné publiquement de sa foi chrétienne. David Byle et sa famille partageaient fréquemment leur foi en public, recevant souvent des réactions positives. Il est arrêté une première fois en 2016. Il est alors autorisé à rester temporairement en Turquie, dans l’attente de la décision finale. Toutefois, il est de nouveau arrêté en 2018, cette fois accompagné d’un ordre d’expulsion lui enjoignant de quitter le pays sous 15 jours. Cette seconde arrestation intervient un jour seulement après la libération d’un autre pasteur américain, Andrew Brunson. Bien que les activités missionnaires ne soient pas illégales en Turquie, l’avocat de David Byle auprès de la CEDH a déclaré que son engagement missionnaire était « au cœur de la décision des autorités de l’expulser et de lui interdire l’entrée sur le territoire »[22].
5.5. Expulsion des conjoints de citoyens turcs : l’affaire Subasiguller
Joy Subasiguller est une citoyenne américaine mariée au pasteur turc Lutfu Subasiguller[23]. En juin 2020, elle reçoit un ordre d’expulsion accompagné d’une interdiction d’entrée sur le territoire, sans qu’aucune justification ne soit fournie. À ce moment-là, Joy n’était pas engagée activement dans la vie de l’Église, puisqu’elle s’occupait à temps plein de ses trois enfants, dont le plus jeune n’avait pas un an.
Elle vivait en Turquie avec son mari et leurs enfants depuis dix ans. Son époux ainsi que leurs trois enfants sont citoyens turcs. Les autorités ont exploité le statut d’étrangère de Joy pour viser indirectement son mari, responsable chrétien turc, dans le but de contribuer à l’éviction des chrétiens du pays. En interdisant le séjour de Joy, le gouvernement a poussé le pasteur protestant turc à quitter son propre pays. Lutfu a dû choisir entre rester avec sa famille et poursuivre son ministère pastoral en Turquie. Joy et son mari ont connaissance de nombreux autres cas similaires, mais les personnes concernées préfèrent garder le silence afin de préserver leur sécurité.
Ce cas révèle davantage encore la volonté profonde du régime d’Erdogan d’éliminer toute influence chrétienne en Turquie. La crainte de la « christianisation », exprimée notamment lors de l’affaire du pasteur Andrew Brunson, ne se limite pas aux missionnaires occidentaux, mais vise également les pasteurs turcs entretenant des liens avec des étrangers.
6. Recherche de justice devant la CEDH
6.1. Cox c. Turquie (2010)
La requérante dans cette affaire est une citoyenne américaine ayant vécu et étudié en Turquie pendant plusieurs années, à partir de 1972[24]. En 1984, elle commence à enseigner dans une université du sud du pays. En 1985, elle déclare à ses étudiants que les Turcs ont expulsé et massacré les Arméniens. Le ministère de l’Intérieur procède alors à son expulsion. Quelques années plus tard, en 1989, elle revient en Turquie et est arrêtée alors qu’elle distribue des tracts critiquant le film La Dernière Tentation du Christ.
Durant et après son expulsion, le ministère de l’Intérieur aurait rédigé des rapports classifiés la concernant, contenant notamment les mentions suivantes : « la requérante, qui exerce une activité missionnaire dans notre pays » ou encore « la requérante, placée sous surveillance après avoir assisté à un office dans une église protestante en Turquie ». Cependant, la requérante n’a soumis aucun de ces documents à la Cour et n’a pas fourni d’éléments complémentaires pour étayer ses affirmations. La CEDH a donc jugé plus approprié de concentrer son analyse sur la liberté d’expression (article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme).
La Cour a conclu que l’expulsion n’était pas « nécessaire dans une société démocratique », et que la Turquie avait violé la liberté d’expression de la requérante. Elle a condamné l’État turc à verser 12 000 euros au titre du préjudice moral. Selon le rapport d’exécution de la Turquie, ce montant a été versé en novembre 2010.
6.2. Bremner c. Turquie (2015)
En 1997, le requérant apparaît dans des images filmées à son insu à l’aide d’une caméra cachée, dans le cadre d’un documentaire télévisé sur les « étrangers colporteurs de religion[25] ». Il avait accepté de rencontrer l’auteur des images, ce dernier ayant répondu à une annonce proposant de la littérature chrétienne gratuite.
La même année, le procureur engage des poursuites contre le requérant, l’accusant d’avoir insulté Dieu et l’islam dans la vidéo. Le requérant est finalement acquitté, puis engage une action en justice contre le réalisateur du documentaire pour obtenir réparation. Le tribunal rejette sa demande, estimant que le thème du documentaire relève de l’intérêt public.
La Cour européenne des droits de l’homme conclut à une violation du droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme), et condamne l’État turc à verser 7 500 euros au titre du préjudice moral.
6.3. Wiest c. Turquie (affaire pendante)
Kenneth Wiest a vécu en Turquie pendant 34 ans, où il exerçait un ministère missionnaire avec son épouse. Le couple y a élevé ses trois enfants, tous nés en Turquie[26]. En 2019, alors qu’il rentrait d’un voyage à l’étranger, Kenneth Wiest découvre qu’il est frappé d’une interdiction d’entrer sur le territoire turc. Le gouvernement turc l’accuse de représenter une menace pour la sécurité nationale, sans fournir aucune preuve. Il n’a jamais bénéficié d’un procès équitable lui permettant de se défendre.
Après plusieurs tentatives infructueuses pour obtenir une autorisation préalable d’entrée, Kenneth Wiest tente de contester le refus devant les juridictions turques, sans succès. Il saisit alors la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant une violation de son droit au respect de la vie privée (article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme) et de son droit à un recours effectif (article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme). L’affaire est toujours pendante devant la CEDH. Le Centre européen pour le droit et la justice a soumis ses observations écrites en novembre 2024[27].
7. Expulsion des convertis chrétiens étrangers
7.1. Violations du principe de non-refoulement et persécutions au retour
Parallèlement aux expulsions de missionnaires occidentaux et de résidents de longue durée, la Turquie a également pris pour cible des convertis chrétiens étrangers, en particulier originaires d’Iran et d’Afghanistan. Ces cas revêtent une gravité particulière : contrairement aux ressortissants occidentaux, qui peuvent poursuivre leur vie en sécurité dans leur pays d’origine après leur expulsion, les convertis issus d’États à majorité musulmane font face à de graves persécutions à leur retour. En Iran et en Afghanistan, la conversion de l’islam est assimilée à l’apostasie et peut entraîner l’emprisonnement, la torture, voire l’exécution.
La loi turque n° 6458 sur les étrangers et la protection internationale intègre le principe de non-refoulement, qui interdit le renvoi de toute personne vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa religion[28]. Malgré cela, des convertis iraniens et afghans ont à plusieurs reprises été visés par des ordres d’expulsion, des détentions dans des centres de rétention ou des pressions pour qu’ils partent « volontairement ». Les associations protestantes en Turquie rapportent que les agents chargés de l’asile manifestent souvent de l’hostilité envers les convertis, remettant en cause la sincérité de leur foi et considérant leur conversion comme illégitime.
Cette contradiction doit aussi être replacée dans le contexte plus large de la politique d’asile. Après l’Iran, la Turquie est le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés au monde — environ 3,1 millions. Parmi eux, près de 2,8 millions de Syriens bénéficient d’un statut de protection temporaire. Le reste inclut des titulaires de protection internationale venant d’Irak, d’Afghanistan, d’Iran et d’Ukraine. Depuis le déclenchement de la guerre civile syrienne en 2011, la Turquie est tenue d’accorder une protection temporaire à tout Syrien arrivant sur son territoire[29]. Alors que ces réfugiés musulmans sont officiellement accueillis comme des « frères » et bénéficient d’une protection collective, les convertis chrétiens des pays voisins sont confrontés à la suspicion, aux obstacles administratifs et aux expulsions forcées.
Ces expulsions violent non seulement le droit interne, mais aussi les obligations internationales de la Turquie au titre de la Convention de 1951 sur les réfugiés, de son Protocole de 1967 et de la Convention européenne des droits de l’homme. Plusieurs arrêts de la CEDH ont condamné la Turquie pour avoir expulsé des chrétiens iraniens, estimant qu’il s’agissait d’une violation du principe de non-refoulement. L’article 4 de la loi n° 6458 stipule clairement que nul ne peut être renvoyé vers un lieu où il risque « la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou encore où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Contrairement aux chrétiens occidentaux, qui peuvent être expulsés sans risque de persécution physique, les convertis iraniens et afghans bénéficient d’une protection accrue en vertu du droit international des réfugiés, précisément parce que leur vie et leur liberté sont directement menacées en cas de retour.
L’affaire emblématique M.B. et autres c. Turquie illustre ces dangers et représente l’une des condamnations les plus nettes de la Cour européenne des droits de l’homme contre la Turquie pour son non-respect du principe de non-refoulement à l’égard des convertis chrétiens.
7.2. M.B. et autres c. Turquie (2010)
Une affaire emblématique concernant des convertis chrétiens est celle de M.B. et autres c. Turquie, jugée par la Cour européenne des droits de l’homme[30]. Les quatre requérants étaient un couple marié et leurs deux enfants qui avaient fui l’Iran vers la Turquie en raison de menaces liées à la persécution politique et religieuse. Leur demande d’asile fut d’abord rejetée, le Haut-Commissariat aux Réfugiés de l’ONU (HCR) ne les ayant pas initialement reconnus comme réfugiés.
Après s’être installée à Istanbul, la famille se convertit au christianisme et devint active dans l’église protestante locale. Leur conversion les mit rapidement en conflit avec les autorités iraniennes : les enfants se virent refuser l’accès à l’école du consulat iranien d’Istanbul, et des preuves montrèrent que le père avait déjà été emprisonné en Iran en 1991 pour non-respect des pratiques religieuses. En 2008, le HCR reconnut finalement la famille comme réfugiée à Ankara, notant que les autorités iraniennes étaient informées de leur conversion et qu’ils couraient un risque avéré de persécution en cas de retour en Iran.
Malgré cette reconnaissance, les autorités turques continuèrent à les traiter comme des migrants irréguliers. Lorsqu’ils demandèrent des permis de séjour à Hakkari en mai 2008, la police s’interrogea sur leurs déplacements et découvrit que le père et le fils s’étaient rendus illégalement en Iran avec de faux passeports afin d’y introduire des Bibles en farsi. Le 30 juillet 2008, la famille fut expulsée vers l’Iran.
De manière remarquable, les requérants parvinrent à rentrer en Turquie dès le lendemain et saisirent à nouveau le bureau du HCR à Ankara. Le HCR confirma que leur statut de réfugiés demeurait valable. Ils demandèrent alors la suspension de la décision d’expulsion et de nouveaux permis de séjour, mais leur situation resta précaire.
La CEDH rendit un arrêt clair :
- Elle jugea que l’expulsion de la famille vers l’Iran violerait l’article 3 de la CEDH (interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants), compte tenu du risque réel de persécution lié à leur conversion.
- Elle constata une violation de l’article 13 de la CEDH (droit à un recours effectif), car les requérants ne disposaient d’aucune voie de droit adéquate en Turquie pour contester leur expulsion.
- Elle estima qu’aucune question distincte ne se posait sous l’angle de l’article 2 de la CEDH (droit à la vie), l’article 3 couvrant déjà les risques mortels encourus.
- Elle rejeta la demande de satisfaction équitable des requérants.
Cette affaire illustre la gravité des expulsions de convertis chrétiens. Contrairement aux chrétiens occidentaux, qui peuvent poursuivre leur vie en sécurité après expulsion, les convertis iraniens risquent l’emprisonnement et la torture à leur retour. L’arrêt démontre que la pratique turque de renvoyer des convertis est en contradiction directe avec ses obligations découlant du principe de non-refoulement, consacré tant par le droit interne (loi n° 6458) que par la Convention. Il souligne également la faiblesse structurelle des recours en Turquie : même des réfugiés reconnus, exposés à un risque avéré, n’ont pas pu obtenir de protection par le système national et ont dû s’en remettre à Strasbourg pour faire valoir leurs droits.
8. Protections internationales pour les chrétiens étrangers de Turquie
8.1. Le traité de Lausanne
Le traité de Lausanne, signé en 1923 par plusieurs États — dont l’Empire ottoman, la France, l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni, la Grèce et la Roumanie — conserve un rôle juridique exceptionnel en Turquie[31]. Il demeure à ce jour le seul cadre international invoqué par l’État turc pour définir les droits des minorités non musulmanes. L’un de ses objectifs principaux était d’assurer la protection des droits civils et religieux de ces communautés. Toutefois, dans la pratique, la Turquie limite son application à trois groupes reconnus officiellement : les Arméniens, les Grecs et les Juifs[32]. Cette reconnaissance sélective, fondée sur une interprétation restrictive du traité, exclut de fait les autres confessions chrétiennes du statut légal de minorité. Le gouvernement turc justifie cette exclusion en affirmant que seules ces religions existaient à l’époque ottomane, ignorant ainsi toute preuve de la présence d’autres communautés[33].
La section III du traité aborde le statut des minorités religieuses non musulmanes[34]. L’article 38 prévoit que le gouvernement turc devra assurer la « protection pleine et entière de la vie et de la liberté de tous les habitants de Turquie sans distinction d’origine, de nationalité, de langue, de race ou de religion ». Il précise également que ces droits ne doivent pas être « incompatibles avec l’ordre public et les bonnes mœurs ».
8.2. La Convention européenne des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
En plus du traité de Lausanne, la Turquie est liée par deux instruments majeurs de protection des droits de l’homme : la Convention européenne des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).
La Turquie a ratifié la Convention européenne des droits de l’homme sans réserve. L’article 9 protège la liberté de pensée, de conscience et de religion, y compris le droit de pratiquer un culte, d’enseigner et d’exercer sa foi individuellement ou collectivement. La loi ne peut restreindre ce droit que dans les cas où cela est nécessaire à la protection de la sécurité publique, de l’ordre, de la santé, de la morale ou des droits d’autrui. L’article 8 protège le droit au respect de la vie privée et familiale, et l’article 10 protège la liberté d’expression. En outre, l’article 6 §1 garantit le droit à un procès équitable, l’article 13 assure le droit à un recours effectif, et l’article 1 du Protocole n°7 prévoit des garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers. Ces dispositions sont souvent invoquées par les chrétiens étrangers pour contester des interdictions d’entrée, des expulsions et des mesures de surveillance qui affectent leur capacité à pratiquer leur foi, à maintenir l’unité familiale et à accéder à une protection juridictionnelle.
La Turquie est également partie au PIDCP, qui garantit la liberté religieuse à l’article 18 et les droits des minorités à l’article 27. Cependant, la Turquie a émis une réserve à l’article 27, précisant qu’elle interprétera cette disposition à la lumière de sa Constitution et du traité de Lausanne. Par conséquent, les protections offertes aux minorités sont limitées aux trois groupes officiellement reconnus — Grecs, Arméniens et Juifs —, excluant ainsi d’autres communautés chrétiennes.
Or, selon le Commentaire général n° 23 du Comité des droits de l’homme des Nations unies, le statut de minorité ne dépend pas d’une reconnaissance officielle. Le principe d’auto-identification est fondamental dans la protection des minorités, ce qui rend la réserve turque incompatible avec l’objet et le but de l’article 27.
En pratique, malgré ces engagements formels, la Turquie invoque régulièrement des justifications floues liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public pour restreindre les droits des chrétiens étrangers — souvent sans véritable contrôle juridictionnel. Ainsi, les protections théoriquement garanties par la Convention européenne des droits de l’homme et le PIDCP demeurent largement inopérantes pour nombre de personnes visées par des interdictions d’entrée, des expulsions ou des formes de harcèlement fondées sur leur identité religieuse.
9. Recommandations pour la protection de la liberté religieuse des chrétiens en Turquie
9.1. Le gouvernement turc doit garantir la liberté religieuse des ressortissants étrangers
Cela suppose l’adoption de dispositions légales claires et spécifiques, ainsi que leur application cohérente, fondée sur des éléments probants et conforme aux normes internationales. Cette nécessité est illustrée par l’affaire Amanda Jolyn Krause et autres c. Turquie, dans laquelle la Cour constitutionnelle a validé le recours à des sanctions administratives — telles que l’interdiction d’entrée ou le refus de permis de séjour — à l’encontre de personnes dont le seul tort est d’avoir assisté à des conférences chrétiennes ou participé à des activités missionnaires.
Dans cette affaire, la décision majoritaire a considéré que de telles activités suffisaient à justifier des restrictions fondées sur la protection de l’ordre public ou de la sécurité, en l’absence de toute preuve concrète[35]. Plusieurs juges dissidents ont critiqué la nature vague et arbitraire de ce raisonnement. L’un d’eux a averti que, sauf à prouver par des éléments précis et crédibles un lien entre les activités missionnaires et un trouble à l’ordre public, un acte d’espionnage ou une menace terroriste, de telles restrictions risquent de violer les droits fondamentaux. Cette opinion se réfère à l’arrêt de la CEDH Religious Organization of Jehovah’s Witnesses in the RA c. Arménie[36], selon lequel le prosélytisme religieux n’est pas en soi illicite et ne peut être restreint qu’en présence d’un motif légitime et fondé sur des preuves.
En cohérence avec cette jurisprudence, la Turquie doit veiller à ce que toute mesure prise à l’encontre de chrétiens étrangers repose sur des éléments vérifiables et soit accompagnée de garanties procédurales, notamment le droit d’être entendu et d’accéder au dossier. À défaut, les victimes pourraient légitimement saisir la CEDH, comme dans l’affaire Krause, plusieurs juges ayant déjà exprimé leurs inquiétudes sur l’absence de justification légale.
9.2. Le Conseil de l’Europe doit demander des comptes à la Turquie pour ses violations systématiques de la liberté religieuse
Face à l’accumulation de violations de la Convention européenne des droits de l’homme par la Turquie, notamment en matière de liberté religieuse et d’expulsions de chrétiens étrangers, le Conseil de l’Europe doit adopter une réponse ferme et coordonnée.
Les arrêts pertinents doivent être placés sous surveillance renforcée par le Comité des Ministres, avec la mise en place de plans d’action détaillés et contraints dans le temps par les autorités turques. Ces plans doivent inclure des réformes législatives, des garanties contre les expulsions arbitraires, et une mise en œuvre effective des recours judiciaires.
Les organisations de la société civile doivent être encouragées à déposer des communications au titre de la règle 9.2, afin d’informer le Comité des Ministres du non-respect par la Turquie de ses obligations. Ce mécanisme est essentiel pour faire monter la pression politique et institutionnelle.
En cas de persistance des refus d’exécuter les arrêts contraignants, le Conseil de l’Europe devrait envisager d’engager une procédure d’infraction au titre de l’article 46 § 4 de la Convention européenne des droits de l’homme, afin de renvoyer la Turquie devant la Cour pour non-exécution systématique.
En outre, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) devrait mobiliser ses prérogatives générales[37], ainsi que les mécanismes prévus dans le cadre de la procédure de suivi, formellement appliquée à la Turquie depuis 2017 en raison des graves inquiétudes concernant les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit — notamment après la tentative de coup d’État de 2016.
Dans ce cadre, l’APCE devrait :
- Demander l’élaboration d’un rapport thématique sur les violations de la liberté religieuse et les expulsions de chrétiens étrangers en Turquie ;
- Inviter le président Erdogan ou des responsables turcs à fournir des explications devant l’Assemblée ;
- Envoyer une mission d’enquête sur le terrain dans les régions où la présence chrétienne ou missionnaire est significative ;
- Engager un dialogue sur une interprétation élargie du traité de Lausanne, incluant d’autres minorités chrétiennes ;
- Exprimer publiquement sa volonté de recourir à des mesures politiques ou à des sanctions, y compris la suspension des droits de vote, si la Turquie persiste à enfreindre ses obligations au titre de la Convention européenne des droits de l’homme.
Seule une pression soutenue, coordonnée et multilatérale pourra contraindre la Turquie à respecter l’autorité de la CEDH et ses engagements fondamentaux au sein du Conseil de l’Europe.
9.3. L’Union européenne doit utiliser ses instruments politiques et financiers pour défendre la liberté religieuse en Turquie
En tant que pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne, la Turquie est soumise à un contrôle accru dans le cadre du processus d’élargissement, en particulier au sujet de l’État de droit, des droits de l’homme et de la protection des minorités. Bien que les négociations soient aujourd’hui au point mort, l’UE conserve un levier important par son dialogue politique et ses instruments d’aide financière.
Dans ce contexte, l’Union européenne devrait prendre des initiatives concrètes pour promouvoir la liberté religieuse et les droits des communautés chrétiennes — qu’elles soient composées de citoyens turcs ou de résidents étrangers — en mobilisant les outils à sa disposition.
Elle devrait notamment :
- Conditionner les fonds de préadhésion du programme IPA III (2021–2027) à des progrès mesurables en matière de liberté religieuse, notamment à la fin des expulsions arbitraires de chrétiens étrangers ;
- Documenter les violations dans ses rapports annuels sur la Turquie et dans ses rapports sur les droits de l’homme et la démocratie, en prêtant une attention particulière aux minorités chrétiennes non reconnues et aux restrictions sur l’activité missionnaire ;
- Soulever systématiquement ces questions dans le cadre des instances bilatérales UE–Turquie, comme les conseils d’association et les dialogues sur les droits de l’homme, en appelant à une reconnaissance juridique de toutes les confessions chrétiennes historiquement présentes en Turquie ;
- Soutenir les ONG confessionnelles et les acteurs de la société civile via l’Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH) et d’autres lignes de financement thématique, en particulier ceux qui documentent les crimes de haine, les expulsions ou les restrictions à la liberté de culte ;
- Encourager l’Envoyé spécial de l’UE pour la liberté de religion ou de conviction à se rendre en Turquie et à rencontrer les représentants des communautés chrétiennes reconnues et non reconnues ;
- Inviter le Parlement européen à adopter une résolution spécifique sur les violations de la liberté religieuse en Turquie, incluant des garanties pour les étrangers exposés à des expulsions arbitraires pour motifs religieux.
Seule l’instauration conjointe d’une pression diplomatique, d’un suivi rigoureux et d’une conditionnalité financière permettra à l’UE de contribuer efficacement à la protection de la liberté religieuse en Turquie et de donner un contenu réel au statut de candidat à l’adhésion.
10. Comment l’ECLJ défend les chrétiens persécutés ?
10.1. De manière générale
Face aux graves violations dont sont victimes les chrétiens étrangers en Turquie, l’ECLJ a dénoncé ces persécutions lors de l’Examen périodique universel de la Turquie devant le Conseil des droits de l’homme des Nations unies, en octobre 2024.[38]
L’ECLJ a également soumis des observations dans plusieurs affaires impliquant des violations des droits de chrétiens turcs d’origine, parmi lesquelles : Fener Rum Patrikliği c. Turquie, Arnavutköy Rum Ortodoks Taksiarhi Kilisesi Vakfı c. Turquie, Arhondoni c. Turquie, et Mavrakis c. Turquie.
10.2. L’affaire Andrew Brunson : un symbole de la répression religieuse en Turquie
L’ECLJ est engagée de longue date dans la défense des ressortissants étrangers persécutés en Turquie, notamment à travers le soutien apporté au pasteur Andrew Brunson. Ce dernier exerçait ouvertement un ministère pastoral à l’église de la Résurrection à Izmir lorsqu’il a été arrêté et accusé de vouloir « diviser et affaiblir [la Turquie] par le biais de la christianisation ». Cette accusation a été assimilée à une forme de terrorisme par le gouvernement turc[39]. Brunson a été détenu pendant une longue période sans chef d’inculpation formel ni procès. Il a été emprisonné, soumis à des traitements dégradants, et utilisé comme monnaie d’échange par le gouvernement turc pendant plus de deux ans.
Au moment de son arrestation, le pasteur Brunson vivait en Turquie depuis 23 ans, où il exerçait ouvertement une fonction de direction ecclésiale. En 2016, il est convoqué dans un commissariat local, pensant obtenir enfin l’approbation de son permis de séjour de longue durée. Mais on l’informe alors qu’il fait l’objet d’un ordre d’expulsion, accompagné d’un mandat d’arrêt visant à détenir sa famille jusqu’à ce qu’elle soit expulsée.
Dans une allocution devant le Parlement européen, le pasteur Brunson a déclaré :
« Je pense qu’ils avaient prévu de nous expulser, mais quelqu’un a décidé de nous garder. L’objectif, selon moi, était d’intimider les autres travailleurs religieux présents dans le pays et de les pousser à partir d’eux-mêmes. Jusque-là, aucun missionnaire n’avait été emprisonné en Turquie, et plusieurs sont effectivement partis ensuite. Cela introduisait un nouveau risque dans leur évaluation personnelle : jusqu’où étaient-ils prêts à aller ? »
L’ECLJ, l’ACLJ (American Center for Law and Justice) et le gouvernement des États-Unis ont uni leurs efforts pour obtenir la libération et le rapatriement du pasteur Brunson et de sa famille[40]. Le 12 octobre 2018, il a été libéré et autorisé à rentrer aux États-Unis, où il réside désormais en sécurité avec son épouse et leurs enfants.
10.3. L’intervention de l’ECLJ dans l’affaire Kenneth Wiest à la CEDH
En novembre 2024, l’ECLJ a soumis des observations écrites à la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Kenneth Wiest c. Turquie, soulignant la politique systématique de ciblage des chrétiens étrangers par le biais d’interdictions d’entrée et d’expulsions[41]. Dans sa contribution, l’ECLJ met en lumière le caractère structurel de ces mesures, révélateur d’une discrimination religieuse persistante à l’encontre des missionnaires chrétiens et des convertis.
Bien que Kenneth Wiest ait invoqué plusieurs articles de la Convention — notamment les articles 6, 8, 9, 13 et 14 — l’ECLJ a appelé la Cour à examiner en particulier les articles 9 (liberté de religion) et 14 (interdiction de la discrimination). Elle s’est appuyée sur la jurisprudence pertinente, notamment Nolan et K. c. Russie[42] et Corley et autres c. Russie[43], dans lesquelles la Cour a examiné des situations comparables sous l’angle de la liberté religieuse.
L’ECLJ a également fait valoir que la requête de Kenneth Wiest met en évidence un problème structurel dans le traitement réservé aux chrétiens étrangers par les autorités turques, analogue aux pratiques discriminatoires relevées en Russie dans les affaires précitées. Elle a ainsi apporté des éléments supplémentaires et des arguments méthodologiques sur l’approche que la CEDH devrait adopter dans l’examen de l’affaire.
11. Conclusion : Mettre fin à la persécution des chrétiens étrangers en Turquie
Depuis plus d’un siècle, les autorités turques œuvrent à la disparition progressive des chrétiens — qu’ils soient autochtones ou étrangers — du territoire national. Cette tendance s’illustre aujourd’hui par le traitement réservé aux missionnaires étrangers, arbitrairement frappés d’expulsions et d’interdictions d’entrée.
Des personnes pacifiques, pleinement intégrées, ayant fondé une famille en Turquie, voient leur vie déracinée du jour au lendemain, sans recours effectif, simplement en raison de leur foi. Leur volonté de vivre en paix au sein de la société turque est systématiquement brisée par des mesures administratives abusives et injustifiées.
Le Conseil de l’Europe, l’Union européenne et l’Organisation des Nations unies doivent exiger de la Turquie qu’elle respecte ses engagements, tant au niveau national qu’international. Elle doit être tenue de faire appliquer les garanties fondamentales de procédure, notamment l’exigence d’éléments de preuve pour toute accusation, et le droit de se défendre.
12. Questions fréquemment posées
12.1. Quel est le statut juridique des chrétiens étrangers en Turquie ?
Les chrétiens étrangers en Turquie sont confrontés à une insécurité juridique croissante, en dépit des engagements officiels du pays en matière de droits de l’homme. En vertu de la loi turque n° 6458 sur les étrangers et la protection internationale, les ressortissants étrangers peuvent se voir refuser l’entrée, être expulsés ou se voir refuser un permis de séjour s’ils sont considérés comme une « menace à l’ordre public ». Bien que les activités missionnaires ne soient pas interdites en Turquie, les chrétiens étrangers — en particulier les protestants — sont souvent visés en raison de leurs engagements religieux.
Les autorités turques s’appuient sur des accusations vagues et des rapports de renseignement confidentiels pour justifier ces mesures, souvent sans preuve ni procédure régulière. Contrairement aux étrangers ou réfugiés musulmans, les chrétiens — y compris ceux mariés à des citoyens turcs — font l’objet d’expulsions et d’interdictions d’entrée disproportionnées. Cette discrimination de facto compromet la liberté de religion et contrevient aux obligations de la Turquie en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme.
12.2. Que signifient les règlements d’interdiction d’entrée N-82 et G-87 ?
Les règlements N-82 et G-87 sont des mesures administratives turques utilisées pour expulser ou interdire l’entrée à des ressortissants étrangers.
- Le règlement N-82 impose une obligation d’autorisation préalable pour entrer en Turquie. Il est souvent appliqué aux missionnaires chrétiens ou aux conjoints étrangers de citoyens turcs. Bien que temporaire en théorie, ce règlement se traduit fréquemment, en pratique, par une interdiction illimitée.
- Le règlement G-87 est encore plus sévère, désignant une supposée « menace pour la sécurité nationale » sur la base de renseignements non divulgués. Il justifie à lui seul une expulsion et une interdiction permanente d’entrée.
Ces règlements sont rarement fondés sur des éléments concrets et violent fréquemment les droits procéduraux des personnes visées — en particulier les chrétiens étrangers exerçant pacifiquement leur foi. Ils sont au cœur des préoccupations croissantes concernant les persécutions religieuses en Turquie, et font l’objet de recours devant les tribunaux turcs et la CEDH.
12.3. Quelles lois internationales protègent les chrétiens en Turquie ?
Plusieurs instruments juridiques internationaux protègent formellement les droits des chrétiens en Turquie, même si leur application reste incertaine en raison des justifications floues liées à la sécurité ou à l’ordre public.
Le traité de Lausanne (1923) garantit les droits civils et religieux des minorités non musulmanes. Cependant, la Turquie limite son application à trois groupes reconnus : les Grecs, les Arméniens et les Juifs — excluant ainsi la majorité des autres confessions chrétiennes, notamment les protestants, les syriaques et les convertis.
Au-delà du traité de Lausanne, la Turquie est partie à la Convention européenne des droits de l’homme, qui s’applique à toutes les personnes sous sa juridiction, y compris les étrangers. La Convention garantit :
- La liberté de pensée, de conscience et de religion (article 9),
- Le respect de la vie privée et familiale (article 8),
- Et la protection contre les discriminations (article 14).
Ces dispositions sont invoquées dans de nombreuses affaires soumises à la Cour européenne des droits de l’homme concernant des expulsions, des interdictions d’entrée et des restrictions à la liberté religieuse.
La Turquie est également liée par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), qui protège la liberté religieuse (article 18) et les droits des minorités (article 27). Toutefois, Ankara a émis une réserve à cet article, stipulant qu’elle l’interprète à la lumière de sa Constitution et du traité de Lausanne, restreignant ainsi sa portée aux minorités officiellement reconnues.
Selon le Comité des droits de l’homme des Nations unies, le statut de minorité ne dépend pourtant pas d’une reconnaissance officielle. Le principe d’auto-identification est fondamental, ce qui rend la position de la Turquie incompatible avec l’objet et le but de l’article 27.
12.4. Qui sont les victimes de la persécution religieuse en Turquie ?
Les victimes incluent à la fois des missionnaires chrétiens étrangers et des réfugiés convertis au christianisme, en particulier venant d’Iran. Nombre d’entre eux vivent en Turquie depuis plusieurs années, sont mariés à des citoyens turcs et participent activement à la vie des églises locales. Parmi les cas notables figurent des citoyens américains, allemands, australiens, et des convertis iraniens, expulsés ou interdits d’entrée sur la base d’accusations floues telles que « activité missionnaire » ou « menace à l’ordre public ».
Les cas du pasteur Andrew Brunson, de la famille Zalma, de Kenneth Wiest et de Joy Subasiguller forment des exemples manifestes. Le point commun entre eux n’est en aucun cas une conduite criminelle, mais bien leur identité chrétienne. Ces expulsions, souvent menées sans procès, portent atteinte à des droits fondamentaux et visent des formes d’expression religieuse pacifique.
12.5. Comment la CEDH réagit-elle à la persécution des chrétiens étrangers en Turquie ?
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) traite de plus en plus d’affaires relatives à la persécution des chrétiens étrangers en Turquie. Plusieurs affaires récentes ou en cours — telles que Cox c. Turquie, Bremner c. Turquie ou M.B. et autres c. Turquie — ont mis en lumière des violations de la vie privée et familiale (article 8), la liberté de religion (article 9) et du droit à un recours effectif (article 13). La Cour a déjà statué en faveur de certains requérants chrétiens, condamnant les pratiques turques et ordonnant des réparations.
D’autres affaires sont encore pendantes, comme Kenneth Wiest c. Turquie, pour laquelle l’ECLJ a déposé des observations juridiques. Ces procédures visent à démontrer la nature systémique des discriminations religieuses en Turquie et à contraindre l’État à se conformer aux normes internationales de protection des droits de l’homme.
13. Photos des victimes :
- Dave et Pamela Wilson (source : ADF)

- David Byle (source : ADF)

- Ken Wiest (compte X)
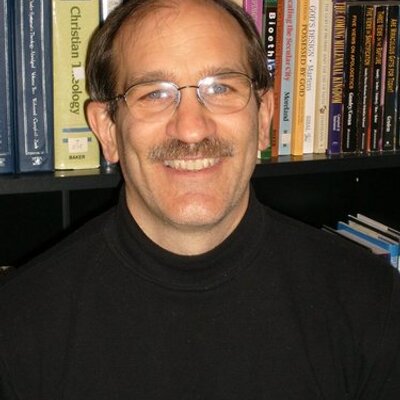
- Joy et Kerem Subasiguller (First Baptiste Melbourne)

__________
[1] Profil pays : Turquie, portes ouvertes.
[2] “Turkey's declining Christian population”, BBC, 2014.
[3] 2023 Report on International Religious Freedom, Turkey.
[4] Institute on Religion and Public Policy Report: Religious Freedom in the Republic of Turkey
[5]OIM, Overview of migrant situation, March 2025
[6] 2024 Human Rights Violation Report, Prepared by the Association of Protestant Churches.
[7]Salma El Monser, Turquie : confirmation de l'expulsion de 9 chrétiens étrangers pour « activités missionnaires », 2020.
[8]Jayson Casper, “Despite a Murder and Visa Denials, Christians Persevere in Turkey”, Christianity Today,2020.
[9]Expulsés de Turquie, 4 expatriés chrétiens en appellent à l'Europe, Portes Ouvertes, 2021 .
[10]Thibault van den Bossche, « La Turquie expulse un chrétien étranger en raison de sa foi », Centre Européen pour le Droit et la Justice, 25 novembre 2024.
[11] Article 18, What are the primary challenges facing Iranian Christian refugees in Turkey? (2023).
[12] US Departement of State 2023 Report on International Religious Freedom : Iran.
[13] Turkey: Law No. 6485, 1 (11/4/2013).
[14] Amanda Jolyn Krause and Others v. Turkey, 1, 5-6 (2024, Turkey).
[15] Lidia Rieder, Christians Banned and Facing Persecution in Turkey.
[16] ONGUR Partners, Restriction Codes for Foreigners in Turkey (2025).
[17] The Association of Protestant Churches, 12 (2024).
[18] Amanda Jolyn Krause and Others v. Turkey, 1, 2 (2024, Turkey).
[19] Nordic Montor, “Turkish intelligence conducted surveillance on Protestants, profiled them as threats to national security,” 13 June 2024.
[20] “Christians Banned and Facing Persecution in Turkey”, ADF International, 2023.
[21] “Christians Banned and Facing Persecution in Turkey”, ADF International, 2023.
[22] “Missionary forced to leave home in Turkey for preaching”, ADF International, 2021.
[23] “Turkey: Pastor’s Wife Security Threat?”, The Voice of the Martyrs, 2022.
[24] CEDH, Cox c. Turquie, No. 2933/03,2010.
[25] Bremner c. Turquie, No. 37428/06, CEDH,2015.
[26] Wiest c. Turquie, No. 14436/21, CEDH, 2024.
[27] Nicolas Bauer, “Kenneth Wiest c. Turquie (N°14436/21)”, Centre Européen pour le droit et la justice, novembre 2024.
[28] Law on Foreigners and International Protection, No. 6488, Article II (2013).
[30] M.B. and Others v. Turkey, No. 36009/08, ECtHR (2010).
[31] “The Treaty of Lausanne”, The Lausanne Project.
[32] Turkey, Report on International Religious Freedom, U.S. Department of State, 2023.
[33] Yanis Papadimitriou, Gulsen Solaker, “Greece and Turkey: The Treaty of Lausanne 100 years on”, DW, 23 juillet 2023.
[34] Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs, Lausanne Peace Treaty.
[35]CEDH,Amanda Jolyn Krause and Others c. Turquie, 1, 16-40,2024, Turquie.
[36] CEDH, Religious Organization of Jehovah’s Witnesses in the RA c. Arménie, n° 41817/10, 22 mars 2022.
[37] “The powers of the Parliamentary», Assembly of the Council of Europe.
[38] Youssef Ayed, Erdogan: The Neo-Ottoman Sultan Against the Christians of Turkey.
[39] Andrew Brunson Full Speech in the European Parliament, ECLJ, 2019.
[40] « Dévelopements de l'affaire A. Brunson », ECLJ, 2018.
[41] Nicolas Bauer, “Kenneth Arthur Wiest v. Turkey (No 14436/21)”, concerning a foreign pastor banned from returning to Turkey (2024).
[42] CEDH, Nolan et K. c. Russie, 2009.
[43] CEDH, Corley et autres c. Russie, 2021.
Lire le document PDF