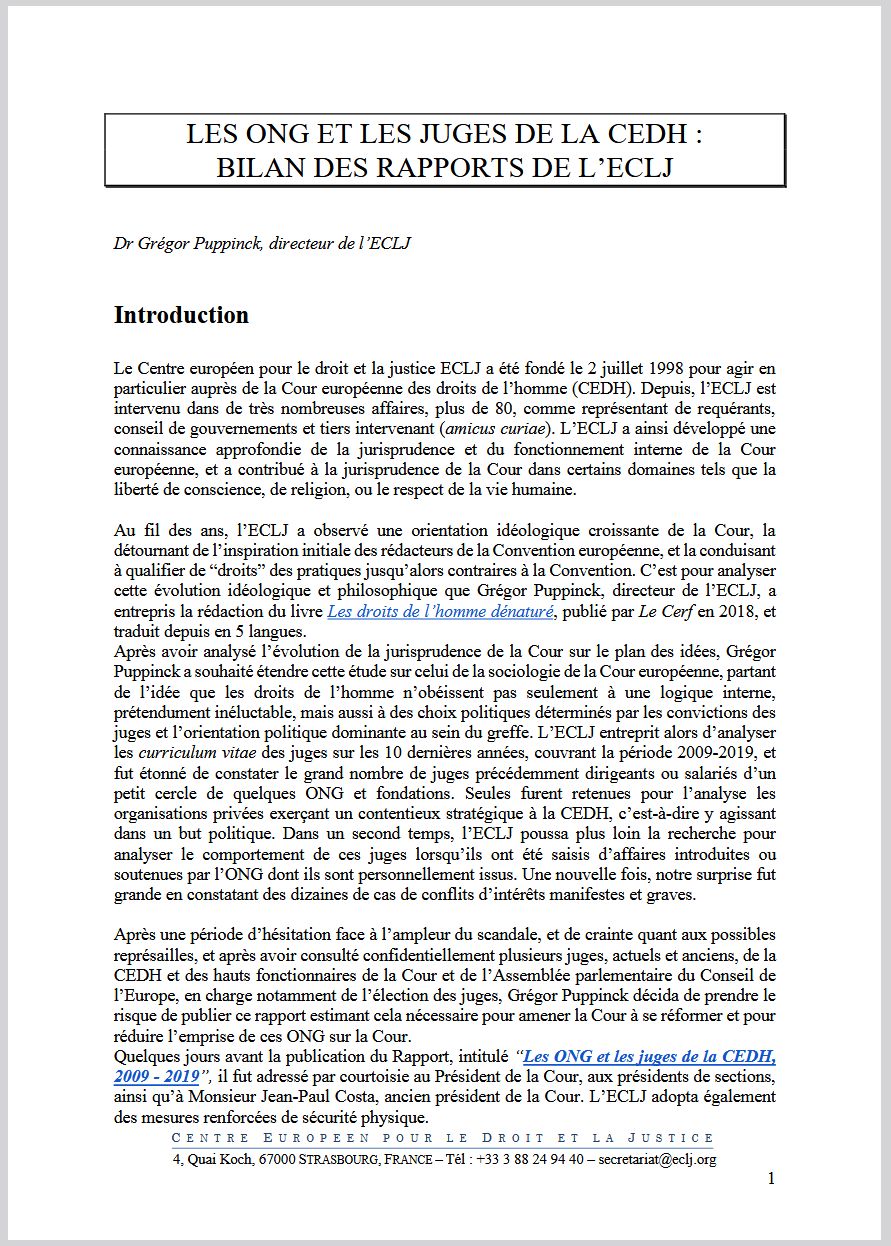Les ONG et les juges de la CEDH: Bilan des rapports de l'ECLJ
Les ONG et les juges de la CEDH: Bilan
L'ECLJ a mené une action extrêmement importante depuis 2020 pour assainir le fonctionnement de la CEDH dans ses relations avec certaines ONG. Après avoir dénoncé l'existence d'un problème structurel de conflits d'intérêts entre juges et ONG, et mené plusieurs initiatives institutionnelles et médiatiques, la Cour a finalement entrepris une série de réformes internes suivant les recommandations de l’ECLJ. Voici un bilan de ce que la presse a désigné comme « le scandale des juges-Soros ».
Introduction
Le Centre européen pour le droit et la justice ECLJ a été fondé le 2 juillet 1998 pour agir en particulier auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Depuis, l’ECLJ est intervenu dans de très nombreuses affaires, plus de 80, comme représentant de requérants, conseil de gouvernements et tiers intervenant (amicus curiae). L’ECLJ a ainsi développé une connaissance approfondie de la jurisprudence et du fonctionnement interne de la Cour européenne, et a contribué à la jurisprudence de la Cour dans certains domaines tels que la liberté de conscience, de religion, ou le respect de la vie humaine.
Au fil des ans, l’ECLJ a observé une orientation idéologique croissante de la Cour, la détournant de l’inspiration initiale des rédacteurs de la Convention européenne, et la conduisant à qualifier de “droits” des pratiques jusqu’alors contraires à la Convention. C’est pour analyser cette évolution idéologique et philosophique que Grégor Puppinck, directeur de l’ECLJ, a entrepris la rédaction du livre Les droits de l’homme dénaturé, publié par Le Cerf en 2018, et traduit depuis en 5 langues.
Après avoir analysé l’évolution de la jurisprudence de la Cour sur le plan des idées, Grégor Puppinck a souhaité étendre cette étude sur celui de la sociologie de la Cour européenne, partant de l’idée que les droits de l’homme n’obéissent pas seulement à une logique interne, prétendument inéluctable, mais aussi à des choix politiques déterminés par les convictions des juges et l’orientation politique dominante au sein du greffe. L’ECLJ entreprit alors d’analyser les curriculum vitae des juges sur les 10 dernières années, couvrant la période 2009-2019, et fut étonné de constater le grand nombre de juges précédemment dirigeants ou salariés d’un petit cercle de quelques ONG et fondations. Seules furent retenues pour l’analyse les organisations privées exerçant un contentieux stratégique à la CEDH, c’est-à-dire y agissant dans un but politique. Dans un second temps, l’ECLJ poussa plus loin la recherche pour analyser le comportement de ces juges lorsqu’ils ont été saisis d’affaires introduites ou soutenues par l’ONG dont ils sont personnellement issus. Une nouvelle fois, notre surprise fut grande en constatant des dizaines de cas de conflits d’intérêts manifestes et graves.
Après une période d’hésitation face à l’ampleur du scandale, et de crainte quant aux possibles représailles, et après avoir consulté confidentiellement plusieurs juges, actuels et anciens, de la CEDH et des hauts fonctionnaires de la Cour et de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, en charge notamment de l’élection des juges, Grégor Puppinck décida de prendre le risque de publier ce rapport estimant cela nécessaire pour amener la Cour à se réformer et pour réduire l’emprise de ces ONG sur la Cour.
Quelques jours avant la publication du Rapport, intitulé “Les ONG et les juges de la CEDH, 2009 - 2019”, il fut adressé par courtoisie au Président de la Cour, aux présidents de sections, ainsi qu’à Monsieur Jean-Paul Costa, ancien président de la Cour. L’ECLJ adopta également des mesures renforcées de sécurité physique.
La publication du rapport, en mars 2020, provoqua une vague de réactions politiques et médiatiques, estompée seulement par la pandémie de Covid. Plus d’une centaine d’articles furent publiés sur tous les continents. Il fut traduit notamment en anglais, polonais, espagnol, russe, croate ou hongrois.
Après avoir analysé minutieusement la véracité du rapport de l’ECLJ, la Cour décida de ne pas le commenter publiquement, d’en minorer les révélations auprès des autres instances du Conseil de l’Europe et d’adopter des mesures internes pour corriger les problèmes identifiés. Il fut aussi décidé, au sommet de la Cour, de ne pas exercer de « représailles » à l’encontre de l’ECLJ, certains juges et greffiers estimant le rapport de l’ECLJ bénéfique, ayant « ouvert les yeux » de la Cour sur certaines de ses déficiences.
Des représailles médiatiques furent tout de même exercées, à l’initiative notamment des ONG et fondations visées dans le rapport. Grégor Puppinck reçut plusieurs conseils quant à la nécessité de veiller à sa sécurité et à celle de ses proches, ce qui advint de façon mécanique, par le confinement décrété dans le cadre du Covid.
Dans les mois qui suivirent la publication du rapport, la Cour européenne a adopté une première série de mesures internes pour renforcer ses normes éthiques.
En 2023, l’ECLJ a publié un second rapport intitulé “L’impartialité de la CEDH - Problèmes et recommandations” afin de dresser un nouvel état des lieux, d’approfondir l’analyse et d’établir une liste de recommandations précises. En parallèle, l’ECLJ a initié une pétition adressée à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et signée par plus de 60 000 personnes, lui demandant de se saisir de ce sujet. Quant au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, il confia la mission à un comité intergouvernemental d’experts sur la CEDH de rédiger « un rapport évaluant l’efficacité du système de sélection et d’élection des juges de la Cour et des moyens d’assurer la reconnaissance du statut et de l’ancienneté des juges de la Cour et offrant des garanties supplémentaires pour préserver leur indépendance et leur impartialité. »
Sans attendre la publication de ce rapport du groupe d’experts, la Cour européenne a rapidement adopté une série de mesures, préconisées par l’ECLJ, pour renforcer l’indépendance et l’impartialité de ses juges, en particulier par l’adoption d’une procédure de récusation.
Face à la gravité du scandale, l’enjeu essentiel pour la Cour européenne et le système du Conseil de l’Europe fut de répondre rapidement aux problèmes graves identifiés dans ces rapports sans en reconnaître publiquement l’existence.
Avec le recul, il apparaît que la publication de ces deux rapports a été extrêmement bénéfique. Le fait que la Cour européenne ait adopté les recommandations formulées par l’ECLJ vient apporter la preuve du bien-fondé et de l’utilité de ces rapports. Ils ont aussi eu pour effet de réduire significativement le nombre de juges élus issus d’ONG militantes actives à la Cour, ce qui constitue une amélioration du système de la Cour. Enfin, ces rapports ont aussi eu l’intérêt d’informer le grand public sur le fonctionnement des institutions internationales et sur l’importance du pouvoir qui y est exercé par quelques riches fondations et ONG.
L’article qui suit présente plus en détail le déroulé de cette opération « d’assainissement » de la Cour.
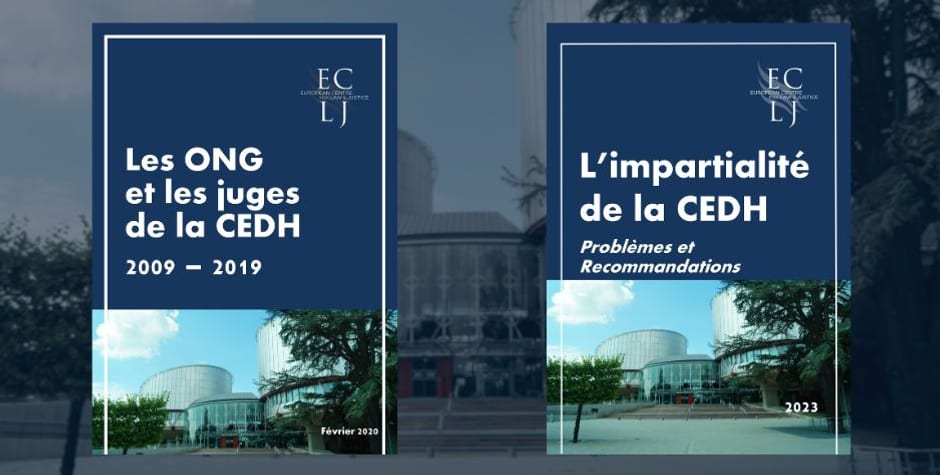
1. Résumé du premier rapport intitulé Les ONG et les juges de la CEDH
En mars 2020, l’ECLJ a publié le rapport Les ONG et les juges de la CEDH, 2009 – 2019, dont voici un résumé.
a. Constat de la présence de juges issus d’organisations militantes faisant du contentieux stratégique à la CEDH
Entre 2009 et 2019, au moins 22 des 100 juges permanents de la CEDH étaient d’anciens fondateurs, dirigeants ou collaborateurs rémunérés de sept fondations et organisations privées fortement actives auprès de la CEDH comme requérantes, représentantes ou intervenantes. Parmi ces 22 juges, 12 viennent de l’Open Society Foundation (OSF) et ses organisations directement affiliées, tandis que les dix autres viennent d’organisations financées, parfois à 50 %, par l’Open Society Foundation de George Soros. Il s’agit de l’A.I.R.E. Centre (Centre sur les droits individuels en Europe), d’Amnesty International, de la Commission Internationale des Juristes (CIJ), du réseau des comités Helsinki, de Human Rights Watch (HRW) et d’Interights.

Il n’est pas interdit à un juge d’avoir travaillé précédemment pour une ONG, mais cela peut entraîner des conséquences sur son impartialité lorsque cette ONG milite pour certaines causes, et agit à la CEDH. En outre, et plus encore, la prégnance de l’Open Society au sein de la Cour est un fait qui revêt une importance politique majeure, et qui mérite donc d’être connu. Le révéler n’est pas une attaque contre la Cour elle-même, mais contre l’emprise exercée par une fondation politique sur la Cour.
b. Constat des conflits d’intérêts entre ces juges et leurs anciennes ONG
Le rapport analyse ensuite le comportement des 22 juges en question lorsqu’ils ont été saisis d’affaires introduites ou soutenues par leur propre ONG, agissant comme requérant, représentant ou tiers-intervenant.
Entre 2009 et 2019, 185 jugements impliquant l’une des sept ONG identifiées ont été rendus publics. Or, à 88 reprises, 18 des 22 juges issus de ces ONG ont jugé des affaires introduites ou soutenues par leurs propres organisations, se plaçant ainsi en situation manifeste de conflits d’intérêts. Ces conflits d’intérêts ont eu lieu dans des affaires suffisamment importantes pour que ces organisations estiment devoir s’y impliquer ; ainsi 33 de ces 88 cas de conflits d’intérêts concernent des jugements de Grande Chambre, c’est-à-dire les jugements dont la jurisprudence est revêtue de la plus grande autorité. A titre d’illustration, un juge a jugé des affaires qu’il a potentiellement introduites par l’ONG dont il était le directeur et l’un des avocats au moment de la requête.
c. Constat du manque de transparence de l’action des ONG
L’analyse des modes d’action des ONG et fondations auprès de la Cour a permis en outre de révéler leur manque de transparence.
En l’absence de règles imposant une transparence minimale, il est très difficile d’identifier toutes les affaires dans lesquelles ces organisations interviennent, surtout lorsqu’elles représentent les requérants sans être formellement mentionnées. Les arrêts publiés et les résumés disponibles dans la base HUDOC ne reflètent qu’une infime partie de cette réalité.
Cette opacité est d’autant plus problématique que certaines affaires sont construites stratégiquement par les ONG pour influencer la jurisprudence. Il devient alors impossible de savoir si le véritable auteur de la requête est le requérant lui-même ou l’organisation qui l’accompagne dans l’ombre. Seuls quelques initiés, anciens membres ou collaborateurs des ONG devenus juges ou greffiers, sont parfois en mesure de reconnaître les acteurs réels de ces affaires. Il existe également des situations où une même ONG agit à la fois comme représentant du requérant et comme tierce partie dans une même affaire, renforçant encore la confusion. Ce manque de clarté nuit à la lisibilité des procédures, fragilise l’exigence d’impartialité et alimente le soupçon d’influences croisées entre certaines ONG et la Cour. Une réforme est donc nécessaire pour garantir la transparence, la loyauté procédurale et la confiance du public.
2. Résumé du second rapport sur les recommandations de l’ECLJ
En 2023, l’ECLJ a publié un second rapport intitulé L’impartialité de la CEDH - Problèmes et recommandations. Ce rapport approfondit l’analyse entreprise en 2020 sur le fonctionnement de la CEDH. Il constate que les cas de conflits d’intérêts entre juges et ONG ont augmenté, même si la Cour a adopté quelques mesures pour y remédier. Ce rapport expose aussi une série de problèmes structurels affectant l’impartialité de la Cour et démontre que celle-ci n’est pas à la hauteur des standards des autres grandes juridictions internationales et nationales. Afin de soutenir le processus de réforme de la CEDH, ce rapport présente une série de recommandations visant à résoudre les problèmes identifiés.
Voici un résumé du rapport.
a. Constat des conflits d’intérêts persistants entre juges et ONG
Entre 2020 et 2022, les conflits d’intérêts déjà dénoncés en 2020 par l’ECLJ se sont maintenus à un niveau préoccupant. Alors qu’entre 2009 et 2019, les ONG concernées étaient visibles en moyenne dans 17 affaires par an, ce chiffre est passé à 38 affaires annuelles sur la période étudiée, soit plus du double. Parmi ces 114 affaires, des juges ont siégé en situation de conflits d’intérêts directs à 54 reprises, réparties sur 34 affaires. Ces juges ont siégé alors que « leur » ancienne ONG défendait les requérants ou intervenait comme tierce-partie, ce qui est constitutif d’un conflit d’intérêts. Parmi ces 34 affaires, 7 concernaient des arrêts de Grande Chambre.
En nombres relatifs, la fréquence de ces conflits a diminué, passant de 48 % à 30 % des affaires impliquant ces ONG. Cela s’explique surtout par la fin de mandats de plusieurs juges issus d’ONG. Dans la grande majorité de ces 34 affaires, la Cour a donné raison à la position défendue par l’ONG impliquée.
b. Liste de recommandations pour la Cour
L’ECLJ considère que la Cour européenne des droits de l’homme, en tant que juridiction suprême, doit être exemplaire dans le respect des principes d’impartialité, de transparence et de compétence. Pour préserver son autorité, la CEDH devrait en effet être exemplaire et respecter les normes qu’elle impose aux juridictions nationales en matière de droit à un procès équitable, et spécialement en matière d’impartialité. Ce n’est pas le cas à ce jour pour divers motifs, le principal étant que, en tant que juridiction suprême, la CEDH n’est soumise au contrôle d’aucune autre juridiction ou instance susceptible de constater ses erreurs et dysfonctionnements. Ce sont les gouvernements qui devraient, en principe, effectuer ce contrôle, mais ils s’estiment souvent mal placés pour ce faire, car toute critique de la Cour venant d’eux peut être perçue comme une pression politique. Il échoit donc à la société civile de pointer ces dysfonctionnements, d’assumer ce travail de lanceur d’alerte. C’est ce qu’a entrepris l’ECLJ en formulant ces recommandations nécessaires pour le bien de la Cour. Elles ont été relues et approuvées par plusieurs juges de la CEDH.
Il s’agit de :
- Établir une procédure de récusation respectant les normes que la Cour exige des juridictions nationales
La Cour devrait respecter les exigences qu’elle impose aux juridictions nationales en la matière. En 2023, seul le juge peut décider de se déporter volontairement, ce qui ne garantit pas une protection suffisante contre les risques de partialité. La Cour pourrait utilement s’inspirer des procédures en vigueur à la Cour pénale internationale ou dans plusieurs cours constitutionnelles européennes, où les demandes de récusation sont encadrées, motivées et ouvertes au contradictoire. => Recommandation adoptée
- Privilégier la nomination de magistrats de haut niveau plutôt que de militants
La majorité des juges de la CEDH n’ont pas d’expérience comme magistrats, mais sont des anciens avocats, juristes et enseignants. Ils ont donc souvent un profil militant, et n’ont été soumis précédemment à aucune obligation de réserve. Ils sont davantage en situation de conflits d’intérêts.
- Prescrire la publication de déclarations d’intérêts
Cette exigence de transparence est déjà en vigueur au sein de nombreuses institutions judiciaires nationales ou européennes, comme la Cour de justice de l’Union européenne, les juridictions françaises ou le Parlement européen. Il est donc logique d’appliquer la même exigence à la CEDH, afin d’identifier d’éventuels conflits d’intérêts et de renforcer la confiance du public.
- Vérifier l’exactitude des curriculum vitae présentés par les candidats
Il est apparu que certains juges n’ont pas présenté un CV sincère à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à l’appui de leur élection, allant jusqu’à usurper les titres d’avocat et de maître de conférences.
- Éviter le népotisme
Il est apparu que de nombreux juges ont des liens étroits, familiaux, affectifs, professionnels ou politiques, avec des membres du gouvernement du pays au titre duquel ils ont été élus. Il serait donc bénéfique de demander aux candidats de révéler ces liens pour prévenir le favoritisme, renforcer l’indépendance des juges ainsi que le respect du secret judiciaire. Ce problème est réel bien que discret.
- Appliquer les règles de sélection aux juges ad hoc
Les juges ad hoc sont nommés de façon discrétionnaire par les gouvernements, et échappent donc à toute exigence de sélection.
- Améliorer la transparence de l’action des ONG devant la CEDH
L’ECLJ recommande à la Cour d’exiger des ONG qu’elles agissent avec transparence, qu’elles déclarent leurs relations avec les parties requérantes lorsqu’elles les représentent ou agissent en tierce-intervention. => Recommandation adoptée
- Assurer la transparence du greffe pour renforcer les garanties de son impartialité
L’opacité du greffe est un réel problème. Contrairement à d’autres juridictions internationales, la Cour européenne ne publie pas la liste complète de son personnel, ni ne communique systématiquement aux parties l’identité des agents en charge de leur affaire. L’ECLJ recommande de corriger ce manque en publiant ces informations, afin de garantir un traitement équilibré et transparent des dossiers.
- Éviter que le juge national soit désigné juge rapporteur dans les affaires importantes
Il est courant à la CEDH que le juge élu au titre de l’État mis en cause participe à la formation de jugement, ce qui peut renforcer la légitimité de la Cour dans l’opinion publique nationale. Toutefois, lorsqu’il est désigné comme juge rapporteur dans des affaires sensibles, cela peut poser des problèmes d’équité, notamment si l’on considère que ces juges sont statistiquement plus enclins à défendre leur État. L’ECLJ recommande donc de ne plus attribuer ce rôle clé au juge national dans les dossiers importants, ou à tout le moins d’indiquer clairement son identité dans l’arrêt, comme le font d’autres instances internationales.
- Informer les parties de la composition de la formation de jugement avant l’examen
Afin de permettre aux requérants d’exercer leur droit de demander la récusation d’un juge, il est nécessaire d’informer à l’avance les requérants de la composition de la formation de jugement en charge de juger leur requête. Actuellement, cette information n’est souvent révélée qu’après la décision, sauf dans les cas d’audience publique. Cela empêche les parties d’exercer leur droit à la récusation de façon effective. Cette lacune est particulièrement problématique lorsqu’un juge unique ou un juge ad hoc statue seul sur une requête. Ce manque de transparence peut porter atteinte au droit à un procès équitable.
- Permettre la révision d’une décision prise par un juge dont l’impartialité ou l’indépendance peuvent être légitimement mises en cause
Selon le règlement, seuls les « arrêts » de la Cour sont susceptibles de révision, ce qui exclut les décisions déclarant une requête irrecevable, même lorsqu’une partie découvre un fait qui aurait pu exercer une influence décisive sur celle-ci. L’ECLJ recommande à la Cour de formaliser la faculté de demander le réexamen d’une affaire déclarée irrecevable, notamment lorsqu’il apparaît que le juge unique ayant adopté la décision en cause a agi en situation de conflit d’intérêts. => Recommandation adoptée
- Informer toutes les parties de l’existence du recours à la CEDH
À ce jour, la partie ayant eu gain de cause devant les juridictions nationales n’est pas informée lorsque la cause est portée devant la CEDH par la partie adverse, sauf lorsque la partie adverse est l’État. Cela a pour conséquence de réserver à la seule partie requérante la faculté de présenter les faits en cause à la Cour, et de priver l’autre partie de toute possibilité de se défendre, et même de savoir que ses intérêts sont en cause devant la CEDH.
L’ECLJ recommande en conséquence d’exiger de l’État défendeur qu’il informe toutes les parties concernées par la requête et de leur reconnaître le droit d’intervenir dans la procédure.
3. Les réactions
a. Dans la presse et les média

L’hebdomadaire Valeurs actuelles a publié une présentation complète des deux rapports, en “une”, leur conférant ainsi une grande visibilité.
Plusieurs centaines d’articles ont été publiés en Europe et dans le monde entier. Ils sont trop nombreux pour être tous cités. Pour la plupart, ils rendent compte de ce rapport de façon objective et positive. En France, des personnalités telles que Éric Zemmour, Michel Onfray, Gilles-William Goldnadel ont évoqué ce rapport. Toutefois, assez peu de grands journaux nationaux ont présenté le rapport de façon précise dans un premier temps. Le journal Le Figaro a évoqué à plusieurs reprises les rapports, de façon objective.
Le journal Le Monde publie le 3 mars 2020 un long article d’attaque ad hominem contre l’ECLJ, en réaction au rapport, mais sans en contester le contenu. Cet article de Samuel Laurent aurait été commandé depuis Strasbourg.
Le 20 mars 2020, Conspiracy Watch publie un article médiocre n’apportant aucune contradiction au rapport et mettant en cause la religion de Grégor Puppinck.
Quelques jours à peine après la publication du premier rapport de mars 2020, les pages Wikipédia de Grégor Puppinck et de l’ECLJ furent réécrites par un groupe de professionnels, pour les discréditer. Quelques avocats et universitaires ont publié des articles pour tenter de porter atteinte à la réputation de l’ECLJ et ainsi discréditer ses rapports. C’est le cas notamment de Martin Scheinin, “NGOs and ECtHR judges: A Clarification”, publié le 13 mars 2020, ou de Laurence Burgorgue-Larsen qui a falsifié les conclusions du rapport de l’ECLJ pour pouvoir les critiquer.
Au fil des ans, des articles plus objectifs ont été publiés pour analyser l’action de l’ECLJ, tel que : Cliquennois G, Chaptel S, Champetier B. « How conservative groups fight liberal values and try to ‘moralize’ the European Court of Human Rights ». International Journal of Law in Context. 2024;20(3).
b. De la part de personnalités politiques
Selon le journal Valeurs actuelles, des conseillers de Matignon et de l’Élysée ont téléphoné à cet hebdomadaire pour les informer qu’ils avaient franchi une “ligne rouge” en publiant ces rapports.
Des personnalités politiques nationales
De nombreux responsables politiques ont fait des déclarations publiques, interpellant leur gouvernement ou les instances européennes. En France, il s’agit notamment de Philippe de Villiers, Marine Le Pen, François-Xavier Bellamy, Julien Aubert, Valérie Boyer, Xavier Breton, Bérengère Poletti, Guy Teissier, Jean-Paul Garraud, Gilles Le Breton, Nicolas Bay, Jérôme Rivière… En octobre 2023, Valérie Boyer a demandé au président Macron que soit diligentée une enquête sur l’indépendance de la CEDH, sur la base des rapports de 2020 et 2023, suggérant de suspendre la participation de la France tant qu’une enquête ne serait pas menée.
Des débats ont été organisés dans plusieurs parlements nationaux. C’est le cas, entre autres, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Danemark. D’autres débats et conférences, prévus pour se dérouler au printemps 2020, ont été annulés ou reportés à cause de la pandémie.
Le Ministre russe des affaires étrangères
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergeï Lavrov, a publié un communiqué officiel relatif au rapport de l’ECLJ. Dans ce texte, il s’inquiète de « l’influence cachée » de certaines ONG occidentales au sein de la CEDH et déclare que cette influence « affecte directement la qualité, l’impartialité et l’équité des jugements de la Cour ». La Russie estime en outre qu’un « examen approprié » de ces dysfonctionnements par les États membres du Conseil de l’Europe, dans le cadre du processus de réforme de la Cour, permettrait de corriger et de réduire « les interférences politiques » exercées par ces ONG dans le processus judiciaire.
Le Ministre bulgare de la justice
Le ministre bulgare de la Justice, Danail Kirilov, a fait une déclaration publique indiquant que le juge bulgare, gravement mis en cause dans le rapport, pourrait être destitué par la CEDH. Depuis, c’est Danail Kirilov qui a finalement été contraint à la démission pour avoir défendu l’indépendance du procureur général de Bulgarie.
4. Les questions parlementaires et leurs réponses
Diverses questions parlementaires ont été posées par des députés nationaux à leurs gouvernements, ainsi que par des députés membres du Parlement européen et de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE). Voici celles que nous avons identifiées.
a. A l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE)
i. Questions écrites posées
Entre avril 2020 et mai 2022, six membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) de divers pays et groupes politiques ont adressé chacun une question écrite différente au Comité des Ministres lui demandant ce qu’il comptait faire pour résoudre les problèmes identifiés dans le rapport de l’ECLJ. Cette prérogative permet aux parlementaires d’interroger les ambassadeurs représentant les États membres du Conseil de l’Europe sur des points qui relèvent de leur compétence. Il s’agit des questions suivantes :
- Restaurer l’intégrité de la Cour européenne des droits de l’homme, Doc. 15096 24/04/2020, Réponse du CM.
- Comment remédier à de potentiels conflits d’intérêts des juges de la Cour européenne des droits de l’homme ? Doc. 15095 23/04/2020, Réponse du CM.
- Le problème systémique des conflits d’intérêts entre ONG et juges de la Cour européenne des droits de l’homme, Doc. 15098 29/04/2020, Réponse du CM.
- Protéger le droit de demander la récusation d’un juge de la Cour européenne des droits de l’homme, 15260 08/04/2021, Réponse du CM.
- Créer un droit de demander une révision de décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, 15261 08/04/2021, Réponse du CM.
- Exiger la publication d’une déclaration d’intérêts par les juges de la Cour européenne des droits de l’homme, 15532 17/05/2022.
Lors de sa réunion ministérielle d’Athènes de novembre 2020, le Comité des Ministres a débattu de ce sujet et a adopté une déclaration « appel[ant] tous les acteurs de la Convention à continuer de garantir le niveau le plus élevé de qualification, d’indépendance et d’impartialité des juges de la Cour ». Il a aussi décidé d’inviter « les Délégués à évaluer à nouveau d’ici fin 2024, à la lumière de l’expérience acquise, l’efficacité du système actuel de sélection et d’élection des juges de la Cour ».
Par une décision du 8 avril 2021, en réponse à trois des questions écrites évoquées ci-dessus, le Comité des Ministres a informé les députés de l’APCE de sa décision adoptée à Athènes. Il n’a pas contesté la réalité des conflits d’intérêts en cause. Il note que « La réflexion sur les règles et procédures de récusation est une question qui entre dans la compétence de la Cour dans le contexte de la procédure de révision de son Règlement intérieur ». Il indique également que : « Il est convenu d’examiner les moyens additionnels d’assurer la reconnaissance du statut et de l’ancienneté des juges de la Cour, offrant ainsi des garanties supplémentaires pour préserver leur indépendance, y compris après la fin de leur mandat » et prévoit d’évaluer « à nouveau d’ici fin 2024, à la lumière de l’expérience acquise, l’efficacité du système actuel de sélection et d’élection des juges de la Cour. »
Par une autre décision, du 26 juillet 2021, le Comité des Ministres a répondu à deux autres questions écrites portant sur l’absence de la procédure de récusation des juges ainsi que sur l’impossibilité de demander une révision des décisions de la Cour. Tout en précisant qu’il appartient à la Cour de résoudre ces problèmes, le Comité des Ministres informe notamment que « le Comité des méthodes de travail de la Cour réexamine le Règlement de la Cour existant, y compris l’article 28 ». Cet article, intitulé « Empêchement, déport ou dispense », porte notamment sur la question des conflits d’intérêts, mais sans prévoir de procédure de récusation. L’insuffisance de cet article 28 du règlement de la Cour est précisément dénoncée dans le rapport de l’ECLJ en ce qu’il ne prévoit pas de procédure formelle de récusation.
Une autre question écrite attend encore une réponse. Elle est ainsi formulée : « Le Comité des Ministres envisage-t-il de prendre des mesures pour que soit exigée la publication d’une déclaration d’intérêts par les juges de la Cour européenne des droits de l’homme ? » (Doc. 15532). La question rappelle la recommandation CM/Rec(2010)12 intitulée « Les juges: indépendance, efficacité et responsabilités » qui évoque la publication de déclaration d’intérêts et rappelle que les membres de la Cour de Justice de l’Union européenne et de nombreuses juridictions suprêmes doivent publier une telle déclaration d’intérêts, tout comme les parlementaires et membres de l’Assemblée parlementaire.
ii. Questions parlementaires censurées
Courant 2022, le Président néerlandais de l’APCE, Tiny Kox, a décidé de ne plus communiquer au Comité des Ministres les nouvelles questions écrites de députés en lien avec la déontologie judiciaire de la CEDH. Il est lui-même ancien dirigeant d’une des ONG concernées par le rapport de l’ECLJ. L’une de ces questions visait à « garantir la transparence de la composition du greffe de la CEDH », en lui appliquant les mêmes règles que celles de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ou encore de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIADH).
Une autre question censurée concerne le juge albanais Darian Pavli, et plus précisément un doute quant à l’authenticité de son curriculum. Darian Pavli, qui fut salarié de l’Open Society en Albanie et à New York, s’est présenté comme “Senior attorney” dans son curriculum soumis au Conseil de l’Europe. Or, les jugements des affaires auxquelles M. Pavli indique dans son CV avoir agi au titre de l’Open Society ne le mentionnent pas comme avocat. Le 9 janvier 2022, interrogé par l’ECLJ, le barreau d’Albanie refusa d’indiquer si Darian Pavli a été avocat, en invoquant le respect de sa vie privée. Il accepte toutefois de délivrer cette information concernant d’autres personnes. Le 19 janvier 2022, le barreau de New York (où siège l’Open Society, organisation pour laquelle Pavli a travaillé entre 2003 et 2015) indique que Darian Pavli n’y a jamais été inscrit. Les bases de données d’autres barreaux américains acceptant les étrangers, permettent de déterminer que Darian Pavli n’est pas enregistré chez eux : California, Texas, District of Columbia, Illinois, Maryland, Massachusetts, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Tennessee et Washington.

Le 17 janvier 2021, le député de l’APCE Barna Zigismond soumet une question écrite au Comité des ministres par laquelle il demande si M. Pavli est avocat. Le 18 janvier 2021, Valérie Clamer, du secrétariat de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, refuse la question au motif qu’elle ne respecterait pas le règlement de l’Assemblée.
b. Questions écrites posées par des députés au Parlement européen
i. Questions posées
Des députés au Parlement européen ont aussi adressé des questions à la Commission et au Conseil européens. C’est le cas notamment des députés Izabela-Helena Kloc (ECR) Maximilian Krah (ID), Jérôme Rivière (ID) et Robert Roos (ECR). La Commission européenne a répondu par la voix de Věra Jourová que « La Commission n’a aucun doute quant à l'intégrité et à l'indépendance de la Cour européenne des Droits de l’homme. » Le Commissaire européen Johannes Hahn, compléta cette réponse de façon lapidaire. Quant au Conseil européen, il déclara ne pas avoir à commenter un rapport d’une ONG. Il est apparu, lors de la publication de ces réponses, que l’Open Society a bénéficié du soutien explicite des commissaires Hahn et Jourová, cette dernière déclarant, en posant aux côtés de M. Soros, que « les valeurs d’Open society sont au cœur de l’action de l’UE ». Johannes Hahn, posant lui aussi avec George Soros, déclare qu’ « il est toujours bon de rencontrer George Soros pour discuter de nos efforts joints pour accélérer les réformes et les sociétés ouvertes dans les Balkans et l’Europe de l’Est ». Entre 2014 et 2018, George Soros et ses lobbyistes ont bénéficié de pas moins de 64 entretiens avec des Commissaires et des hauts responsables de la Commission européenne, ce qui est considérable, selon le registre de transparence de la Commission.
ii. Questions censurées
Le 10 octobre 2023, Nicolas Bay, député au Parlement européen, adresse une question écrite à la Commission européenne demandant si M. Pavli est avocat. Nicolas Bay n’a pas reçu de réponse des services du Parlement ; sa question n’a jamais été publiée et a probablement été supprimée en violation du règlement du Parlement européen.
En janvier 2024, Jean-Paul Garraud adresse une nouvelle question écrite à la Commission européenne sur cette affaire. Le 26 janvier 2024, les services du Parlement européen lui demandent de la modifier pour ne pas viser M. Pavli, au motif qu’elle ne respecterait pas les règles sur la protection des données. Pourtant, de nombreuses questions citent nommément des personnes.
c. Questions posées par des parlementaires nationaux
Des questions écrites ont été posées par des députés de divers pays, en Autriche, Allemagne, Belgique, aux Pays-Bas. En France, le député José Evrard a posé une question au gouvernement, qui lui a répondu en rappelant les règles de nomination des juges à la CEDH. En Suisse, le conseiller Jean-Luc Addor a interrogé le Conseil fédéral sur le rapport de l’ECLJ. Le Conseil, tout comme les autres autorités publiques interrogées, a omis de répondre sur les conflits d’intérêts, se bornant à rappeler, pour l’essentiel, la procédure de nomination des juges, et estimant qu’il est bénéfique que certains d’entre eux proviennent d’ONG.
5. La pétition de l’ECLJ à l’APCE
Le 12 octobre 2022, une pétition intitulée “Mettre fin aux conflits d’intérêts à la CEDH”, signée par plus de 60 000 citoyens européens, a été remise au Président de l’APCE, en vertu de l’article 71 de son Règlement, au regard du rôle central de l’APCE dans l’évaluation et l’élection des juges de la CEDH. Cette pétition demande à l’Assemblée parlementaire d’inscrire ce sujet à son ordre du jour, afin qu’un rapport soit rédigé et que des solutions soient recommandées au Comité des Ministres. La recevabilité de la pétition devait être examinée par la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’APCE, avant d’être éventuellement examinée sur le fond.
La pétition dresse une liste de mesures qui devraient être recommandées à la Cour, tendant à :
- prescrire aux juges la publication de déclarations d’intérêts ;
- demander aux candidats à la fonction de juge de déclarer tout lien de parenté avec un membre du gouvernement ou de leur parlement national ;
- éviter la présentation de candidats issus d’organisations militantes actives auprès de la CEDH ;
- établir une procédure formelle de récusation, respectueuse des exigences posées par la Cour à l’égard des juridictions nationales ;
- informer à l’avance les parties de la composition de la formation de jugement, par respect pour la transparence judiciaire, et afin de permettre aux parties de demander éventuellement la récusation d’un juge ;
- appliquer aux juges l’obligation, et non plus seulement la faculté, d’informer le Président de la Cour en cas de doute quant à leur indépendance ou leur impartialité objectives ;
- établir un formulaire de demande de tierce intervention faisant apparaître les liens éventuels avec les parties principales ;
- assurer un contrôle de l’APCE sur le choix des juges ad hoc ;
- accroître la transparence du fonctionnement du Panel consultatif d’experts sur les candidats à l’élection de juges à la Cour ;
- publier la liste des membres du greffe de la Cour, comme le font la Cour interaméricaine des droits de l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne.
Le secrétariat de l’APCE fut surpris par l’ampleur de la pétition au regard de sa technicité et du peu d’intérêt que porte la population pour l’APCE. Le bureau de l’APCE n’a pas rejeté la pétition d’emblée, et l’a transmise au Comité des affaires juridiques pour avis.
Ce Comité a tenu un vif débat sur cette pétition, de façon confidentielle, et a adopté une position confidentielle adressée au Bureau. M. Puppinck a reçu lecture de cette communication, laquelle dit en substance :
« la pétition soulève une question sérieuse, il est préférable que l’APCE n’y donne pas suite publiquement pour ne pas nuire à la réputation de la Cour ; la Cour s’est engagée à mener un processus de réforme interne pour répondre aux problèmes soulevés par la pétition. Attendons de voir l’évolution de ce processus interne à la Cour. Si la Cour n’adopte pas les réformes nécessaires, l’APCE pourrait se saisir du problème ».
Sur cette base, le Bureau de l’Assemblée rejeta la pétition sans fournir d’explication officielle aux signataires.
Parallèlement à cette pétition, une proposition de résolution intitulée Le grave problème des conflits d’intérêts à la Cour européenne des droits de l’homme (Doc. 15661) a été déposée le
31 novembre 2022 à l’APCE par vingt parlementaires de quatorze pays membres du Conseil de l’Europe. Le sort de cette proposition de résolution a été liée à celui de la pétition. Elle fut transmise par le Bureau de l’APCE à la même Commission « pour information dans le cadre de l’examen de la recevabilité de la pétition reçue sur le même sujet ». Le rejet de la pétition a entraîné celui de la motion de résolution.
6. Les réactions de juristes
En mai 2020, plus d’une centaine de juristes, professionnels du droit, universitaires et magistrats nationaux, dont des membres de juridictions suprêmes nationales et un ancien membre de la CEDH, ont publié une tribune collective « pour l’indépendance et l’impartialité de la CEDH » exprimant leur inquiétude devant les situations de conflits d’intérêts à la CEDH, et appelant la Cour à prendre les mesures qui s’imposent pour remédier à cette situation.
7. La création du groupe d’experts sur les juges de la Cour
Le 11 juillet 2022, suivant la décision de la réunion ministérielle d’Athènes de novembre 2020, le Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH), qui conduit les travaux inter-gouvernementaux du Conseil de l’Europe dans le domaine des droits de l’homme, a constitué un Groupe de rédaction sur les questions relatives aux juges de la Cour européenne des droits de l’homme (DH-SYSC-JC) ayant pour mandat de préparer, avant le 31 décembre 2024, un « rapport évaluant l’efficacité du système de sélection et d’élection des juges de la Cour et des moyens d’assurer la reconnaissance du statut et de l’ancienneté des juges de la Cour et offrant des garanties supplémentaires pour préserver leur indépendance et leur impartialité ».
La portion de phrase « et offrant des garanties supplémentaires pour préserver leur indépendance et leur impartialité » répond aux questions des conflits d’intérêts. Il s’agit de la conséquence la plus importante du rapport de l’ECLJ sur le plan institutionnel.
Grégor Puppinck a participé aux travaux de ce comité comme représentant du Saint-Siège.
Ce Groupe de rédaction a agi en coordination avec la Cour européenne afin de lui laisser l’initiative et le temps d’amender son Règlement en vue de renforcer les garanties d’impartialité de ses juges. Le Groupe publia son rapport « [n]otant que le processus de modification par la Cour de la Règle 28 du Règlement de la Cour progresse ». Cette approche a permis au Groupe de rédaction et au CDDH de ne pas dénoncer publiquement les manquements de la Cour en la matière, et de prendre note de ses progrès.
Il faut noter l’attitude extrêmement virulente de l’expert allemand Hans-Jörg Behrens, élu à la présidence du Groupe, qui fit tout pour éviter de parler des confits d’intérêts et s’oppose frontalement à la simple référence aux « déclarations d’intérêts ».
Le 1er décembre 2023, le Comité directeur des droits de l’homme CDDH du Conseil de l’Europe a adopté le Rapport sur les “Questions relatives aux juges de la CEDH”
8. La réponse de la Cour
D’après le journal Le Monde, si le rapport a provoqué « la colère » de la CEDH, celle-ci a toutefois décidé de ne pas réagir publiquement, et de ne pas répondre à la presse, après avoir vérifié et constaté l’exactitude des faits relevés dans le rapport.
a. Les réponses publiques des présidents de la CEDH
Le Président de la CEDH dut toutefois répondre aux questions posées par des membres de l’APCE et du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur les rapports de l’ECLJ.
Le 22 avril 2020, durant un échange de vues entre le Comité des Ministres et M. Linos-Alexandre Sicilianos, alors Président de la CEDH, celui-ci fut interrogé par l’ambassadeur de Russie sur le rapport, soutenu par son homologue turc. Le Président Sicilianos, ne contesta pas le rapport, mais chercha à limiter la responsabilité de la Cour, indiquant que l’existence de juges issus d’ONG est le fait des États qui sont responsables de proposer des candidats à la fonction de juges. Il n’aurait pas nié les cas de conflits d’intérêts, mais tenté de les relativiser au regard des milliers d’affaires jugées chaque année par la Cour.
Plus tard, la Cour aurait refusé de répondre à une demande d’information émise par le secrétariat du Comité des Ministres et sollicitant son aide pour répondre aux questions écrites posées par des membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

Le 20 novembre 2020, M. Robert Spano, successeur de M. Sicilianos à la présidence de la CEDH, fut à son tour interrogé lors d’un échange de vues avec l’APCE. Interrogé précisément sur la question des conflits d’intérêts, il répondit sur le lien entre juges et ONG, mais sans parler de la question centrale des conflits d’intérêts. Il déclara en effet :
Je vais vous faire la même réponse que j’ai faite et que mon prédécesseur a faite au Comité des ministres au mois de mai. Il n’y a pas d’allégations crédibles à nos yeux d’influences d’organisations non gouvernementales sur le travail de la Cour. Des juges de la Cour ont, parfois dans leur vie professionnelle antérieure, eu une expérience, ou reçu une formation en matière de droit relatif aux droits de l’homme en travaillant dans des organisations non gouvernementales. Cela montre la diversité de leur parcours professionnel, c’est essentiel pour une Cour internationale. Mais la question essentielle, c’est que c’est l’Assemblée parlementaire qui élit les juges. Le Curriculum Vitae des juges avec tout leur parcours professionnel, toutes leurs expériences est soumis à l’Assemblée parlementaire lorsqu’elle élit les juges. C’est donc à vous de décider de la diversité du groupe des juges qui siègent à la Cour. Personnellement, je n’accepte pas, je le dis très clairement, les allégations qui ont été faites et je ne varie pas sur ce point de l’avis de mon prédécesseur Alexandre Sicilianos.
Rappelons que le problème principal pointé par le rapport n’est pas que des juges aient travaillé pour des ONG avant leur élection, mais bien qu’ils siègent dans des affaires en situation de conflit d’intérêts avec ces ONG. À cette question, le président Spano n’apporte aucune réponse.
b. Les réformes mises en œuvre par la Cour suivant les recommandations de l’ECLJ
i. Révision des normes d’éthique judiciaire
Le 2 septembre 2021, la CEDH a publié une version révisée de sa Résolution sur l’éthique judiciaire adoptée le 21 juin 2021. Il s’agit d’un document rédigé par la Cour qui précise son règlement et les obligations déontologiques des juges. Le texte précédent datait de 2008 ; en le comparant au nouveau texte, il apparaît que la révision est profonde et répond partiellement aux problèmes soulevés par le rapport de l’ECLJ. Le nouveau texte renforce les obligations d’intégrité, d’indépendance et d’impartialité des juges. En écho au rapport de l’ECLJ, la résolution oblige à présent les juges à être indépendants de toute institution, y compris de toute « organisation » et « de toute entité privée », en référence aux ONG et autres fondations. Le texte ajoute que les juges « doivent être libres de toute influence injustifiée, qu’elle soit interne ou externe, directe ou indirecte. Ils s’abstiennent de toute activité, de tout commentaire et de toute association, refusent toute instruction et évitent toute situation pouvant être interprétés comme nuisant à l’exercice de leurs fonctions judiciaires ou comme étant de nature à nuire à la confiance que le public se doit d’avoir en leur indépendance ». Le texte précédent était beaucoup plus succinct.
Sur l’impartialité, le nouveau texte ajoute l’interdiction explicite de « participer à aucune affaire qui pourrait présenter un intérêt personnel pour eux », renforçant ainsi la prévention des conflits d’intérêts. Les juges doivent en outre s’abstenir « de toute activité, de tout commentaire et de toute association pouvant être interprétés comme étant de nature à nuire à la confiance que le public se doit d’avoir en leur impartialité ».
La nouvelle Résolution sur l’éthique judiciaire de la Cour fait aussi obligation nouvelle aux juges d’être assidus à leur fonction de juge, de limiter leurs activités extérieures, et de façon plus significative encore, de ne pas critiquer la Cour, par l’interdiction nouvelle de « s’exprimer, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, d’une manière qui nuirait à l’autorité ou à la réputation de la Cour, ou qui serait de nature à susciter des doutes raisonnables quant à leur indépendance ou leur impartialité ». Cela vise notamment les déclarations publiques intempestives de juges sur des matières soumises à l’examen de la Cour. Une autre interdiction nouvelle porte sur l’acceptation de « toute décoration ou distinction pendant l’exercice de leurs fonctions de juge de la Cour ». Celle-ci fait suite au scandale provoqué par l’acceptation par le Président de la Cour d’un doctorat honoris causa en Turquie en septembre 2020.
ii. Précision des modalités d’intervention des ONG et tierces interventions
Le 20 mars 2023, la Cour européenne des droits de l’homme a publié une version révisée de son Règlement, auquel elle a annexé une nouvelle « Instruction pratique » sur les tierces interventions. Reprenant des recommandations formulées dans le rapport Les ONG et les Juges de la CEDH, la Cour exige à présent, significativement, que toute demande de tierce intervention contienne « suffisamment d’informations sur : a) l’intervenant potentiel ; b) tout lien existant entre cet intervenant potentiel et les parties à la procédure ; c) les raisons pour lesquelles l’intervenant potentiel souhaite intervenir ». L’ECLJ avait exposé le manque de transparence de nombreuses interventions et demandé « [d’] établir un formulaire de demande d’intervention dans lequel la personne physique ou morale demandant à intervenir devrait déclarer ses intérêts, […] ainsi que ses liens éventuels avec les parties, notamment s’ils agissent en concertation. »
L’ECLJ se réjouit de la publication de cette instruction pratique, mais note que d’autres problèmes demeurent. Ainsi, il est regrettable que la Cour n’ait pas saisi l’occasion pour porter une autre amélioration importante au système : prévoir l’obligation d’informer les tiers intéressés à une affaire portée devant elle, et leur assurer le droit d’y intervenir. Il peut s’agir, par exemple, de « l’adversaire du requérant dans la procédure civile interne à l’origine de la requête individuelle introduite devant la Cour ou [de] l’autre parent dans les affaires de garde d’enfants. » Les droits et intérêts de ces personnes peuvent en effet être directement affectés par le jugement de la Cour ; et il serait juste qu’ils soient associés à la procédure.
Dans son instruction pratique, la Cour reconnaît que pour ces tiers intéressés, « ‘‘l’intérêt de la justice’’ peut exiger qu’ils soient entendus avant que la Cour ne statue sur une question susceptible d’affecter leurs droits, même indirectement. » Mais encore faudrait-il que ces tiers intéressés soient informés de l’existence du recours. Or, tel n’est pas le cas à ce jour. Dès lors, bien souvent, la Cour statue sans entendre les arguments de ces personnes, sans leur permettre de se défendre.
C’est là un défaut structurel de la procédure à la CEDH qui mérite d’être corrigé, même si cela occasionne une petite charge supplémentaire de travail pour la Cour.
Secondairement, la procédure de tierce intervention serait moins arbitraire si la Cour s’était imposé l’obligation de justifier ses décisions de rejet des demandes d’intervention.
iii. Révision du Règlement de la Cour relatif à l’impartialité
α. Création d’une procédure de récusation
Le 15 décembre 2023, la Cour européenne a modifié en profondeur l’article 28 de son Règlement, ayant désormais pour titre « Empêchement et récusation ». Il institue enfin une procédure de récusation des juges, procédure inexistante jusqu’alors, suivant en cela la demande de l’ECLJ.
L’article 28, « Empêchement et récusation » est ainsi rédigé :
- Tout juge est tenu de siéger dans toutes les affaires qui lui sont attribuées sauf si, pour l’une des raisons exposées au paragraphe 2 du présent article, il ne peut participer à l’examen de l’affaire.
- Aucun juge ne peut participer à l’examen d’une affaire :
- a) s’il a un intérêt personnel dans celle-ci, du fait par exemple d’un lien conjugal ou parental, d’un autre lien de proche parenté, d’un lien personnel ou professionnel étroit, ou d’un lien de subordination avec l’une quelconque des parties ;
- b) s’il est antérieurement intervenu dans l’affaire, soit comme agent, conseil ou conseiller d’une partie ou d’une personne ayant un intérêt dans l’affaire, soit, au niveau national ou au niveau international, comme membre d’une autre juridiction ou commission d’enquête, ou à tout autre titre ;
- c) s’il s’engage, alors qu’il est juge ad hoc ou ancien juge élu continuant à siéger au titre de l’article 26 § 3 du présent règlement, dans une activité politique ou administrative, ou dans une activité professionnelle incompatible avec son indépendance ou son impartialité ;
- d) s’il a exprimé en public, par le truchement des médias, par écrit, par des actions publiques ou par tout autre moyen, des opinions qui sont objectivement de nature à nuire à son impartialité ;
- e) si, pour quelque autre raison que ce soit, son indépendance ou son impartialité peuvent légitimement être mises en doute.
- Tout juge qui, pour l’une des raisons exposées au paragraphe 2 du présent article, s’estimerait empêché de siéger dans une affaire particulière à laquelle il a été appelé à participer doit, dans le plus bref délai, s’il s’agit d’une affaire attribuée à une formation de comité ou de chambre, en aviser le président de la section, qui décidera si ce juge doit être dispensé de siéger. En cas de doute du juge concerné ou du président sur l’existence ou non de l’une des causes de déport énumérées au paragraphe 2 du présent article, la chambre décide. Elle entend le juge concerné, puis délibère et vote hors sa présence. Aux fins des délibérations et du vote en question, l’intéressé est remplacé par le premier juge suppléant de la chambre. Il en va de même s’il siège au titre de toute Partie contractante en vertu des articles 29 et 30 du présent règlement.
- Seules les parties à la procédure peuvent, pour l’une des raisons exposées au paragraphe 2 du présent article, demander la récusation d’un des juges appelés à siéger dans l’affaire en cause. Toute demande de ce type doit être dûment motivée et présentée dans le plus bref délai une fois que son auteur aura pris connaissance de l’existence de ces raisons. La chambre statue sur cette demande conformément à la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article. Les parties sont informées de l’acceptation ou du rejet de celle-ci.
- Les dispositions ci-dessus s’appliquent, mutatis mutandis, aux affaires portées devant la Grande Chambre, et – sous l’autorité du président de la Cour – aux juges appelés à siéger comme juges uniques en vertu de l'article 27 de la Convention ou comme juge de permanence en vertu l’article 39 du présent règlement.
La Cour a complété l’article 28 de son Règlement par la publication d’une « instruction pratique » de quatre pages annexée à son Règlement, qui précise la procédure de récusation.
La Cour a aussi adopté ce faisant deux recommandations supplémentaires de l’ECLJ, l’une visant à permettre aux requérants de connaître à l’avance l’identité des juges susceptibles de trancher leur cause, et l’autre explicitant formellement la possibilité de demander la réouverture d’une affaire après une décision d’irrecevabilité. Une telle possibilité est nécessaire dans le cas notamment où le requérant constaterait qu’un juge ayant prononcé la décision d’irrecevabilité était en situation de conflit d’intérêts. Ce sont là des améliorations sensibles du fonctionnement de la Cour.
β. Création d’un Conseil d’éthique chargé de conseiller le président de la Cour
Le 16 décembre 2024, la Cour plénière de la CEDH a décidé que son président aurait désormais la possibilité de consulter un Conseil d’éthique chaque fois qu’il estime que cela est nécessaire pour donner à un juge qui en fait la demande des orientations sur le respect des normes éthiques dans une situation donnée. Le Conseil d’éthique a compétence pour donner des orientations concernant les juges en exercice, les juges ad hoc et les anciens juges. Des orientations peuvent également être données concernant la Cour elle-même en tant qu’institution. Le Conseil d’éthique est composé de cinq membres : le plus ancien vice-président de la Cour, le plus ancien président de section et les trois plus anciens juges en exercice. Le Conseil d’éthique sera assisté par le greffier de la Cour.
9. Les effets sur la composition subséquente de la Cour
Depuis la publication du rapport de 2020, le nombre de juges issus d’ONG actives à la CEDH a diminué de façon significative, plusieurs ayant achevé leurs mandats, et d’autres n’ayant pas été élu. C’est le cas notamment de la candidate belge Maïté De Rue, juriste salariée de l’Open Society Justice Initiative à New York depuis 2018, qui a échoué à être élue, bien que favorite, en avril 2021.
Conclusion
Cinq ans après le scandale provoqué par la publication du premier rapport de l’ECLJ, beaucoup de chemin a été parcouru. Dans une résolution du 9 avril 2025 intitulée « Respect de l’État de droit et lutte contre la corruption au sein du Conseil de l’Europe », l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe « se félicite des mesures prises récemment par la Cour européenne des droits de l’homme pour revoir et rendre plus transparentes ses propres procédures et normes éthiques, y compris en ce qui concerne la récusation. L’Assemblée encourage la Cour à favoriser le développement d’une culture éthique et à suivre de près les questions éthiques. »
Plusieurs améliorations et réformes sont encore nécessaires dans la procédure de sélection et d’élection des juges ainsi que dans le fonctionnement de la Cour.
Il est en particulier nécessaire de réformer le greffe de la Cour, afin en particulier de le rendre moins opaque et plus indépendant, à l’instar des autres grandes juridictions internationales.
Lire le document PDF