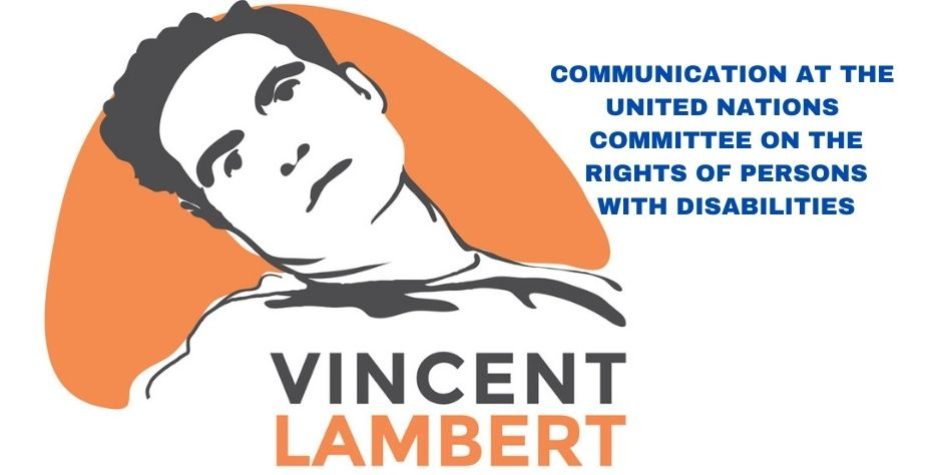

Observations finales du Comité des droits des personnes handicapées sur la France
France : Observations finales du CDPH
Le 14 septembre 2021, le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH) des Nations unies a publié ses observations finales dans le cadre de l’examen périodique de la France. Composé de 18 experts indépendants, le CDPH est chargé de surveiller l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Pour ce faire, il examine notamment les rapports que chaque État partie est tenu de lui soumettre à intervalles réguliers et qui contiennent les détails des mesures prises pour s’acquitter de leurs obligations en vertu de la Convention (article 35). La société civile est également appelée à participer à cet examen par la possibilité qui lui est donnée de soumettre des observations au Comité. Dans le cadre de l’examen périodique de la France qui a ratifié la Convention en 2010, le Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ) a ainsi fait parvenir au CDPH une contribution écrite traitant de la mise en œuvre de la Convention et de son Protocole facultatif en France à la lumière de l’ « affaire Vincent Lambert ».
La France épinglée sur la question du dépistage génétique prénatal
Dans ses observations finales, le Comité relève tout d’abord les aspects positifs de la mise en œuvre par la France de la Convention relative aux droits des personnes handicapées avant d’égrener la liste des aspects préoccupants accompagnés de recommandations pour y remédier.
Parmi ceux-ci, il nous semble tout d’abord particulièrement important de souligner le rappel à l’ordre dont la France a fait l’objet sur la question du dépistage génétique prénatal. Cette pratique permet en effet une forme d’eugénisme en ce qu’elle conduit dans la majorité des cas à l’avortement des enfants à naître pour lesquels une anomalie a été détectée. Le Comité se déclare ainsi préoccupé par « La dévalorisation des personnes handicapées à travers les politiques et pratiques capacitaires qui sous-tendent le dépistage génétique prénatal des déficiences fœtales, notamment en ce qui concerne la trisomie 21, l’autisme et la détection néonatale de la surdité » (§ 17, b / traduction libre). Il recommande donc à la France d’ « Adopter et mettre en œuvre une stratégie basée sur le modèle du handicap fondé sur les droits de l'homme afin d’éliminer les stéréotypes négatifs qui dévalorisent les personnes handicapées, notamment en ce qui concerne l’utilisation des tests génétiques prénataux » (§ 18, a / traduction libre).
Ces déclarations dont il faut se réjouir s’inscrivent dans la droite ligne de ce qu’a affirmé le CDPH en 2018 dans un document officiel : « Les lois qui autorisent explicitement l’avortement en raison d’un handicap violent la Convention des droits des personnes handicapées. » Il poursuivait en expliquant que ce type d’avortement est souvent basé sur des diagnostics erronés, et que « Même s’ils ne sont pas faux, cette affirmation perpétue le préjugé selon lequel le handicap serait incompatible avec une vie heureuse. »
De même, début 2020, la Rapporteuse Spéciale sur les droits des personnes handicapées a énoncé dans son rapport annuel (dont l’un des titres est évocateur : « Des vies qui ne vaudraient pas la peine d’être vécues ») : « Sur les questions telles que le dépistage prénatal, l’avortement sélectif et le diagnostic génétique préimplantatoire, les militants des droits des personnes handicapées s’accordent à considérer que les analyses bioéthiques servent souvent de justification éthique à une nouvelle forme d’eugénisme, souvent qualifié de "libéral" » (§ 21). Elle poursuivait en affirmant que « Le dépistage et les tests génétiques prénatals devraient être effectués et mis à disposition selon des modalités qui respectent les droits des personnes handicapées et reconnaissent leur valeur en tant que membres égaux de la société » (§ 63) et qu’ « Il est important de fournir des renseignements objectifs et précis, non seulement sur les risques et les limites des tests prénatals, mais aussi sur la vie avec la maladie qui fait l’objet du dépistage, afin de permettre aux futurs parents de remettre en question tout préjugé personnel ou sociétal auquel ils pourraient avoir été exposés » (§ 64).
Les violations de la Convention dans l’affaire Lambert en suspens
En soumettant sa contribution écrite, l’ECLJ souhaitait faire part au CDPH des inquiétudes tenant au sort réservé aujourd’hui en France aux personnes lourdement handicapées comme l’a été Vincent Lambert, dont la tristement célèbre « affaire » met en évidence divers manquements dans la mise en œuvre de la Convention et de son Protocole facultatif. Pour rappel, tétraplégique et en état de conscience altérée, Vincent Lambert est décédé le 11 juillet 2019 après avoir été privé pendant plusieurs années des soins auxquels son état de santé lui donnait droit et ultimement de l’alimentation et de l’hydratation qui lui étaient apportées par voie entérale, après que le gouvernement français a refusé de mettre en œuvre la mesure conservatoire indiquée par le CDPH consistant au maintien de cette nutrition.
Force est pourtant de constater que les conclusions du CDPH ne présentent pas de lien direct avec l’ « affaire Vincent Lambert ». On peut toutefois relever la préoccupation du Comité quant aux politiques d’institutionnalisation systématique sur la base du handicap qui ont cours en France. Dans le même ordre d’idée, indiquant être préoccupé par « Les décès de personnes handicapées en milieu institutionnel (…) », le Comité recommande « De développer des mesures, en consultation avec les organisations de personnes handicapées et les mécanismes de contrôle indépendants, pour initier une désinstitutionalisation d’urgence des personnes handicapées afin de garantir une vie sûre et indépendante dans la communauté et de protéger le droit à la vie dans les situations sanitaires critiques » (§ 21, b et 22, b / traduction libre). De ce point de vue, Vincent Lambert aurait en effet dû pouvoir sortir du service de soins palliatifs inadapté à sa situation et où il était retenu dans des conditions « carcérales », alors même que toutes les demandes de transfert ont été systématiquement refusées, que ce soit vers le domicile de ses parents ou vers un établissement spécialisé dans la prise en charge de ce type de handicap et proposant de l’accueillir.
S’il est regrettable qu’à l’occasion de cet examen périodique le Comité ne se soit pas pleinement emparé des questions que soulève l’ « affaire Vincent Lambert », il faut néanmoins reconnaître que celles-ci sont spécifiques et appellent certainement des développements fournis qu’il lui était difficile de formuler dans un tel document : c’est ce qui explique peut-être cette retenue dont le Comité a fait preuve. Cela d’autant plus que la procédure relative à la communication que lui ont présentée les parents de Vincent Lambert le 24 avril 2019 est toujours pendante. Or les conclusions qu’il rendra dans cette affaire lui permettront de traiter spécifiquement et in extenso de ce qui apparaît comme autant de manquements de l’Etat français dans la mise en œuvre de la Convention et de son protocole facultatif à l’égard de Vincent Lambert.













