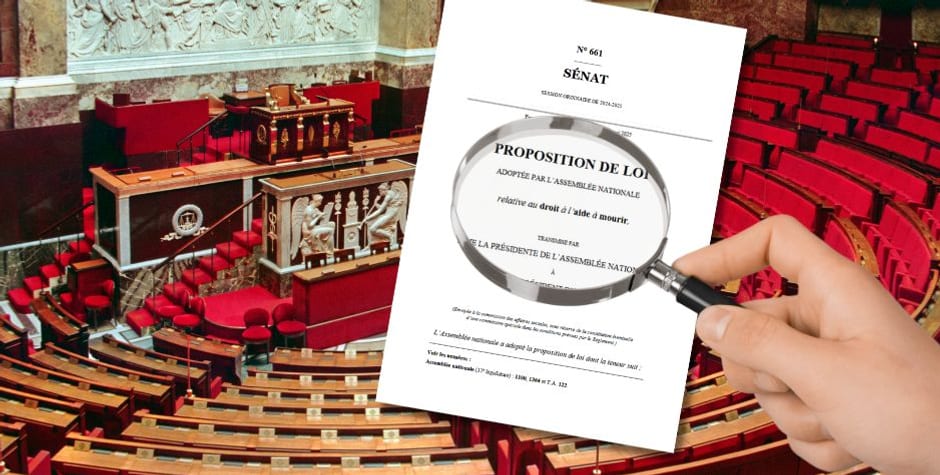

Aide à mourir : 14 problèmes majeurs avec l’actuelle proposition de loi
Aide à mourir: 14 problèmes majeurs avec la proposition de loi
La proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir adoptée le 27 mai 2025, est actuellement examinée par les sénateurs en commission. L'examen en séance publique commencera le 20 janvier 2026. L’ECLJ a identifié 14 problèmes majeurs de ce texte qu’il leur incombe de corriger, outre la violation de l’interdit de tuer.
1. La notion d’« aide à mourir » confond le suicide assisté et l’euthanasie et les assimile à un soin
Le texte qualifie l’euthanasie et le suicide assisté de « soin », créant une obligation pour les médecins. Cette terminologie est un euphémisme qui masque la finalité de l’acte, qui est de provoquer volontairement la mort.
La proposition de loi définit le « droit à l’aide à mourir » comme le fait d’autoriser et d’accompagner une personne à recourir à une substance létale (art. 2). Soit la personne s’administre elle-même la substance létale, soit elle se la fait administrer par un tiers, si elle est incapable physiquement de le faire. Le Conseil d’État a clairement exposé dans son avis du 4 avril 2024 que le projet légalise, sous conditions, l’assistance au suicide et l’euthanasie. La notion d’« aide à mourir » est donc un euphémisme, masquant la finalité réelle du texte.
Le suicide assisté et l’euthanasie sont définis comme « un soin ». Ce nouveau « droit à l’aide à mourir » crée donc une obligation à laquelle doit répondre le médecin, dès lors qu’un patient remplit les conditions d’éligibilité et sollicite l’aide à mourir.
En intégrant ce nouveau droit à l’article L. 1110-5 du Code de la santé publique (art. 3), qui consacre le droit de recevoir les soins les plus appropriés pour apaiser la souffrance, le texte assimile le suicide assisté et l’euthanasie à un soin. Cette approche marque une rupture fondamentale avec les lois précédentes (dites « Leonetti » et « Claeys-Leonetti ») qui, tout en garantissant le droit à l’apaisement de la douleur jusqu’au terme naturel de la vie, et le refus de l’acharnement thérapeutique (art. L.1110-5-1 du Code de santé publique ), écartaient la possibilité de provoquer activement le décès.
Ainsi, une personne souffrant d’hypertension artérielle depuis plusieurs années pourrait un jour formuler une demande de suicide assisté. La décision favorable à la demande sera légalement considérée comme un nouveau protocole de soin dans le cadre du traitement de l’hypertension artérielle et assurant la continuité des soins prodigués.
- Lire ici à ce sujet : Fin de vie : quelle différence entre « faire mourir » et « laisser mourir » ?
2. « L’aide à mourir » ne concerne pas que les personnes en fin de vie
La proposition de loi ne s’adresse pas uniquement aux personnes en fin de vie. Des personnes ayant encore plusieurs années à vivre, pourraient y être éligibles. Les critères de souffrance sont subjectifs.
La proposition de loi ouvre le suicide assisté et l’euthanasie à une population bien plus large que les seules personnes en fin de vie. Les conditions de fond cumulatives définies à l’article 4 imposent :
D’avoir au moins dix-huit ans, d’être de nationalité française ou résider de façon stable en France et être atteint d’une « affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale. »
La notion de « phase avancée » ne s’applique pas uniquement aux personnes en fin de vie. En effet, une maladie incurable ne signifie pas qu’il n’existe pas de traitements appropriés, mais que la maladie persiste malgré les traitements existants. Ainsi des personnes ayant encore plusieurs années d’espérance de vie seraient éligibles. Par exemple, un majeur souffrant d’insuffisance rénale chronique ou du VIH, qui sont des affections graves et incurables engageant le pronostic vital en cas d’arrêt des traitements, pourrait ainsi entrer dans le champ d’application de la loi. À titre d’exemple, environ 50 000 patients sont dialysés en France pour cause d’insuffisance rénale[1], et seraient éligibles à la procédure dans le cas de l’arrêt des traitements.
La personne doit également présenter une souffrance physique ou psychologique constante réfractaire au traitement, ou des souffrances « insupportables », lorsque la personne choisit d’arrêter, ou de ne pas recevoir un traitement. Ces critères sont bien alternatifs et éminemment subjectifs. Il est difficile d’affirmer qu’une souffrance psychologique soit constante car il arrive très souvent qu’une personne ait des « hauts » et des « bas ». Il n’y a aucun consensus médical sur le degré à partir duquel une souffrance est « insupportable ». Grâce à l’adoption de l’amendement n° 1453, la souffrance psychologique seule ne permet pas d’obtenir l’euthanasie. Malgré cela, le médecin aura toute latitude pour apprécier la situation médicale et la volonté « libre et éclairée » du patient. Le juge est exclu de la procédure, contrairement aux cas de procédures de placement sous protection juridique, ou encore de don d’organe intrafamilial.
3. Une personne atteinte d’un trouble psychique peut demander le suicide assisté
La proposition de loi permet à une personne souffrant d’un trouble psychique de demander l’euthanasie. La décision repose sur l’appréciation d’un médecin non spécialiste en matière de discernement.
L’article 6 de la proposition de loi exclut du « droit à l’aide à mourir » les personnes dont le discernement est « gravement altéré ». À contrario, une personne présentant un trouble altérant « légèrement » son discernement, peut demander et obtenir l’euthanasie si les conditions de fond sont réunies. La détermination du discernement au moment de la demande initiale relèvera de l’appréciation du médecin référent.
La Cour d’assises d’appel de l’Ain a jugé le 25 juin 2025 qu’une femme apprenant l’adultère de son mari a eu son discernement « altéré ». Cette altération du discernement de plusieurs heures lui a permis d’obtenir une réduction de peine pour le crime qu’elle a commis dans un accès de fureur à la suite de cette nouvelle. Par conséquent, on peut légitimement penser qu’une demande de suicide assisté intervenant après l’annonce d’un adultère du conjoint pourra être analysée comme une altération, et non une abolition du discernement, n’empêchant pas la demande de suicide assisté.
Précisons encore qu’un amendement (n° 45) qui visait à exclure explicitement du champ de la loi les malades atteints d’une maladie psychiatrique, a été rejeté lors des débats parlementaires. Or, la Fondation pour la recherche sur le cerveau déclare que : « la dépression, les addictions et les troubles liés à la consommation de drogues ou d’alcool, l’anxiété et les phobies, les troubles de comportements alimentaires, les troubles schizophréniques, bipolaires ou borderlines sont des exemples de troubles psychiques »[2]. Si la loi était adoptée en l’état, il découlerait de « l’esprit du législateur » que la loi n’a pas voulu exclure les personnes souffrant de maladies psychiatriques.
4. La proposition de loi discrimine les personnes handicapées
Le texte ne protège pas les personnes handicapées et risque de diminuer leur visibilité et les moyens alloués aux dispositifs qui leur sont consacrés dans la société.
La proposition de loi crée une discrimination à l’égard des personnes handicapées, car les critères d’éligibilité à l’« aide à mourir » coïncident avec la définition même du handicap. Les personnes handicapées sont éligibles en raison même de leur état de santé. Elle porte ainsi atteinte à la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies et l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme qui interdit la discrimination dans la jouissance des droits fondamentaux.
Le 26 août 2025, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies a émis plusieurs réserves sur cette proposition de loi, car les personnes handicapées sont objectivement dans une situation de vulnérabilité et elles devraient être mieux protégées du risque de suicide. Il a également demandé au gouvernement de ne pas affirmer que ce Comité et la Convention qu’il a la charge de faire respecter reconnaissent un « droit à mourir », parce que c’est évidemment faux.
Cela instaure un paradoxe juridique : la loi présume qu’une personne sous protection juridique est apte à consentir à sa propre mort, alors que cette même présomption lui est refusée pour des actes de disposition patrimoniale, ce qui suggère que l’on accorde moins de valeur à sa vie qu’à ses biens.
Les garanties procédurales sont spécifiquement affaiblies pour les personnes en situation de handicap, là où elles devraient être renforcées. Par exemple, l’obligation d’une demande écrite est assouplie, et la loi ne protège pas contre une simplification abusive de l’information délivrée à une personne ayant des facultés de discernement altérées. L’Assemblée Nationale a même supprimé la disposition qui obligeait le médecin à informer la personne handicapée de « tous les dispositifs et les droits visant à garantir la prise en charge de ses besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux », pour l’inclure dans le domaine plus général de l’obligation d’information existant à l’article 5.
Enfin, le texte risque d’engendrer un cercle vicieux : en encourageant le recours à l’euthanasie chez les personnes handicapées, leur visibilité dans l’espace public diminuera. Cette présence réduite pourrait à son tour limiter les dépenses publiques dédiées aux dispositifs d’inclusion, rendant la vie en société plus difficile pour les personnes handicapées et la tentation de recourir à l’euthanasie plus grande.
- Lire ici : Aide à mourir : les obligations internationales de la France.
5. La procédure de suicide assisté est expéditive
Les délais de décision et de réflexion sont très courts. Une euthanasie pourrait être réalisée en une semaine, sans que le patient ait reçu une information complète avant de confirmer sa demande.
La proposition de loi fixe des délais de décision et de réflexion très courts (art. 6). Le médecin doit se prononcer sur la demande dans un délai maximal de quinze jours et aucun délai minimum n’est fixé. Une décision pourrait donc être prise en moins de trois jours, si le collège pluriprofessionnel est réuni rapidement.
Une fois la décision du médecin notifiée, la personne dispose d’un délai de réflexion d’au moins deux jours avant de confirmer sa volonté (art. 6). Une euthanasie pourra donc être accordée et réalisée en un temps très bref, potentiellement une semaine. Ces délais sont expéditifs en comparaison des législations étrangères. Dans le cas de la Belgique, le délai de réflexion est d’un mois, et dans celui de l’Autriche, le délai est en principe de douze semaines, et par exception, de deux semaines si la personne est entrée en phase terminale.
Ensuite la personne faisant une demande de suicide assisté ne reçoit l’information sur les modalités d’administration de la substance létale et ses actions concrètes, qu’après le court délai de réflexion consécutif à la décision (art. 6), ce qui nuit fondamentalement au caractère éclairé du consentement final. Un amendement (n° 51) proposait d’imposer une information réellement complète comportant bien « les risques encourus » avant que le patient ne donne son accord. Il s’agit notamment des risques liés au rejet potentiel de la substance par l’organisme, comme les myoclonies (les spasmes), la variabilité de la durée du processus, les risques de régurgitation, ou encore la difficulté d’accès intraveineux[3]. Cet amendement a été rejeté, ce qui laisse bien présager que l’information donnée par certains médecins ne sera que partielle.
En cas de lancement d’une procédure de suicide assisté, la famille du patient n’est pas prévenue de manière systématique. Selon l’article 7, la décision du médecin et la date d’administration de la substance létale sont communiquées uniquement aux personnes que le patient a personnellement désignées. La « victime[4] » détermine la date d’administration de ladite substance avec le médecin, sans qu’il y ait de délai minimum entre la confirmation et la survenance de l’euthanasie (art. 8). Lorsque la personne demande le report de la date d’administration initialement convenue (art. 9), cette demande est analysée comme une simple demande qui suspend la procédure, et non comme un doute permettant de remettre en cause sa validité.
6. Le médecin référent a trop de pouvoir
Le médecin n’est pas un simple exécutant. Toute la procédure et l’interprétation des critères légaux reposent sur un seul médecin référent, sans intervention du juge.
Il apprécie si le patient doit formuler sa demande par écrit ou par un autre moyen adapté (art. 5), si le pronostic vital est en phase avancée ou non (art. 4), si le discernement est gravement altéré (art. 6) et la volonté libre et éclairée (art. 4). Il rend personnellement la décision finale (art. 6) après avoir consulté un collège pluriprofessionnel qu’il sollicite (art. 6).
La décision n’est pas susceptible de recours sauf par le patient ; et éventuellement sous conditions strictes, par le représentant d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique (art. 12). Le médecin apprécie également l’existence de « pressions » par des proches susceptibles d’influencer la volonté du patient, au moment de l’administration de la substance létale (art. 9). Si le patient met plus de trois mois à confirmer sa volonté après avoir été notifié de la décision favorable « d’aide à mourir », le médecin peut procéder à la réévaluation de son discernement et consentement libre et éclairé par le collège pluriprofessionnel, de manière facultative.
La présence de spécialistes en matière de discernement est également facultative (art. 6). En effet le médecin en question peut être n’importe quel médecin en activité.
Le médecin doit tenir compte du fait que pour une maladie neurodégénérative (art. 6), l’évaluation du discernement « ne peut se fonder exclusivement sur des tests cognitifs ». Cependant, il garde une marge de manœuvre très large pour interpréter les modes de communication non verbaux et apprécier les moments de lucidité.
Cette concentration du pouvoir d’appréciation sur une seule personne, même médecin, et la non-intervention du juge dans la procédure, sont graves, car une décision finale de vie ou de mort en dépend.
7. Le collège pluriprofessionnel ne rend qu’un avis consultatif
Le collège de professionnels consulté par le médecin référent ne donne qu’un avis non contraignant. Sa composition est minimale et il peut même se réunir à distance.
Le processus de réflexion est collectif, et se fait par la consultation du « collège pluriprofessionnel » mais la décision finale est rendue individuellement par le médecin référent (art. 6), qui a une compétence discrétionnaire sur la procédure. Le rôle de ce collège est limité à un échange d’avis non-contraignants, ce qui renforce le pouvoir d’appréciation souverain du seul médecin référent.
Le médecin doit réunir un « collège pluriprofessionnel » composé au minimum d’un médecin spécialiste de la pathologie, d’un aide-soignant ou, à défaut, d’un auxiliaire médical qui participe au traitement et du médecin référent. La participation d’autres professionnels, comme des psychologues, est facultative. L’avis de la personne de confiance n’est recueilli que si le patient le demande expressément, et le représentant d’un majeur qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique communique seulement des observations, sans participer au collège (art. 6).
« L’auxiliaire médical » renvoie à diverses professions (infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste), et la réunion du collège peut avoir lieu à distance, en cas d’impossibilité de se réunir physiquement. Le médecin spécialiste pourrait ainsi donner son avis sans avoir jamais examiné physiquement le patient, ni même consulté son dossier médical (art. 6).
Par exemple, un dermatologue intervient dans le cadre d’un soin auprès d’un patient atteint de diabète et résidant en EHPAD. Pendant la visite, le patient déclare vouloir mourir. Le dermatologue convoque alors un diabétologue et un aide-soignant de l’EHPAD. Le diabétologue ne pouvant se rendre sur place, la réunion pourrait se faire en distanciel et le dermatologue pourrait rendre sa décision en moins de trois jours, après avoir déterminé que le discernement du patient n’est pas gravement altéré et que les conditions de fond sont réunies.
En définitive, la procédure est conçue pour que le collège ne puisse agir ni comme un contre-pouvoir ni comme un organe de contrôle.
8. Le suicide assisté est présenté comme une alternative aux soins palliatifs
Le texte présente le suicide assisté et l’euthanasie comme une alternative aux soins palliatifs, et non comme une solution ultime intervenant après l’épuisement de toutes les autres ressources.
Le médecin doit informer la personne sur les dispositifs d’accompagnement et de soins palliatifs, et s’assurer qu’elle y ait accès si elle le souhaite, mais cette information est mise sur le même plan que celle sur l’« aide à mourir ».
Or un rapport récent de la Cour des comptes révèle l’inégalité d’accès aux soins palliatifs en France, où seulement 48 % des besoins sont pourvus[5]. Selon le rapport Sicard de 2012, les demandes de mort chutent drastiquement dès qu’une prise en charge efficace de la souffrance est mise en place. La proposition de loi ne priorise pas l’accès aux soins palliatifs et ne précise pas comment le médecin s’assure de « manière effective » que la personne ait accès aux soins palliatifs si elle le souhaite (art. 5).
Bien que le gouvernement ait mis en place une stratégie décennale dotée d’1,1 Md€ sur dix ans, en prévoyant de définir la « politique de soins palliatifs de la République », pour garantir l’égalité d’accès aux soins palliatifs sur tout le territoire, rien n’est prévu pour les patients qui attendent l’accomplissement de cette stratégie, et qui font actuellement face à l’inégalité d’accès aux soins palliatifs. L’effectivité immédiate de la procédure de suicide assisté ou d’euthanasie porte ainsi atteinte à l’obligation positive des États de protéger la vie, consacrée par l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Nous sommes manifestement devant le risque de voir le suicide assisté devenir un choix par défaut. En pratique, il sera plus rapide d’obtenir une aide à mourir qu’un accès aux soins palliatifs.
9. Absence de recours juridique contre la décision du médecin
Seul le patient peut contester une décision de refus du médecin ; Pratiquement aucun tiers (proches, soignants) ne peut contester une décision de mort.
La proposition de loi écarte presque totalement l’intervention du juge. L’article 12 prévoit que la décision du médecin ne peut être contestée que par la personne ayant formulé la demande. En pratique, cela signifie que seul un refus d’euthanasie pourrait faire l’objet d’un recours, par le patient. Seule la personne résolue à mourir a ainsi le droit de saisir le juge pour aller au bout de sa demande, alors même qu’aucun tiers, qu’il s’agisse de ses proches, de la personne de confiance désignée ou d’un soignant, n’est autorisé à contester la décision favorable ou défavorable du médecin référent. L’unique et très restrictive exception concerne le représentant d’un majeur protégé, qui dispose d’un délai de deux jours (art. 12) pour saisir le juge des contentieux de la protection, et uniquement en cas de doute sur le caractère libre et éclairé de la volonté du majeur protégé.
Cette absence de droit au recours est unique par rapport à ce qui se pratique en Belgique, en Espagne, ou aux Pays-Bas par exemple, et méconnaît le principe du droit au recours consacré par l’article 13 de la CEDH, qui a pour objet de porter remède à la situation critiquée par le plaignant.
Elle est aussi contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel[6], qui garantit le droit à un recours juridictionnel effectif pour les « personnes intéressées » dans le cadre de la procédure collégiale préalable à la décision de limitation ou d’arrêt des traitements dans le cadre d’une sédation profonde. Ce droit impose de notifier la décision aux personnes auprès desquelles le médecin s’est enquis de la volonté du patient, dans des conditions leur permettant d’exercer un recours en temps utile. Ce recours doit pouvoir être examiné dans les meilleurs délais par la juridiction compétente.
Indubitablement, une telle procédure permet au médecin de frauder et d’euthanasier des personnes sans respecter la procédure et sans que personne ne puisse faire intervenir la justice.
Un parent d’un jeune garçon de 18 ans, éligible à la procédure, ne pourra donc pas contester devant le juge la décision favorable rendue par le médecin, à la suite de la demande de suicide assistée formulée par son enfant.
10. Les contrôles a priori et a posteriori sont insuffisants pour prévenir les dérives
Le contrôle a priori est un « autocontrôle » exercé par des médecins, sans intervention judiciaire, tandis que le contrôle a posteriori par une commission créée (art. 15), n’intervient qu’après la mort du patient.
Le contrôle a priori repose entièrement sur la vérification de l’éligibilité de la personne à l’aide à mourir, au travers de la procédure du collège pluriprofessionnel. Plusieurs éléments affaiblissent ce contrôle médical : la demande initiale peut être formulée par écrit, ou par « tout autre mode d’expression adapté », l’appréciation relevant encore une fois du médecin référent (art. 5). Les avis rendus par les différents intervenants du collège pluriprofessionnel ne sont pas soumis au formalisme écrit et à leur inscription dans le dossier du patient, à la différence de la procédure collégiale relative à la sédation profonde (L1110-5-2 et R4127-37-2 du CSP). Ces avis ne sont pas contraignants vis-à-vis du médecin référent, qui rend la décision finale.
Le contrôle a posteriori est, quant à lui, confié à une « commission de contrôle et d’évaluation ». Cette commission est chargée de vérifier, après la mort de la personne, la légalité et le respect de la procédure, tant sur le fond que sur la forme. Ainsi, le contrôle intervient une fois que l’acte a été commis, et ne peut donc pas maîtriser en amont une éventuelle dérive.
Cette commission peut signaler au Procureur de la République les infractions pénales qu’elle constate en vue de mettre en œuvre l’action publique, ou saisir les chambres disciplinaires des ordres professionnels concernés en cas de manquement aux règles déontologiques. Son action reste entièrement rétrospective et elle n’a aucun autre pouvoir. De plus, l’ADMD, principale association militante pour la légalisation de l’euthanasie en France, pourra également en faire partie au titre « d’associations agréées représentant les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou dans les instances de santé publique » (art. 15).
- Lire ici les conséquences d’une telle procédure de contrôle à partir du cas belge : Euthanasie : le contre-exemple des lois belge et néerlandaise
11. La conscience des médecins violée
Le professionnel qui refuse de pratiquer le suicide assisté ou l’euthanasie doit « sans délai » communiquer au demandeur le nom d’autres professionnels disposés à mettre en œuvre le suicide assisté et l’euthanasie.
Cette obligation (Art. 14) transforme un refus en un acte de coopération indirect, contraignant de fait les médecins opposés à l’euthanasie, à conduire une personne à obtenir le suicide assisté. Elle porte atteinte à la liberté de conscience du médecin, garantie à l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, au nom de la « liberté individuelle » du patient de choisir le moment de sa mort. En effet, il n’est pas fait référence à une obligation de renvoi vers un établissement ou simplement un confrère, mais directement aux professionnels disposés à pratiquer l’euthanasie.
Si la loi prévoit une clause de conscience pour les professionnels de santé ne souhaitant pas participer à l’euthanasie, elle l’assortit d’une contrainte en excluant les étudiants en médecine, les pharmaciens et les institutions (Cf ci-dessous).
Cette approche est contraire aux recommandations de l’Association Médicale Mondiale qui déclare que : « Aucun médecin ne saurait être forcé à participer à une euthanasie ou à aider une personne à mettre fin à ses jours, pas plus qu’il ne devrait être tenu d’orienter un patient à cette fin[7] ».
Il n’y a pas d’échappatoire pour le médecin opposé par principe à l’euthanasie. Soit il ne se déclare pas objecteur de conscience pour rendre des décisions défavorables aux demandes qui lui sont adressées, et il peut être poursuivi devant le juge par le patient éconduit, soit il se déclare objecteur de conscience et il doit renvoyer la personne vers un confrère dont il a la certitude qu’il pratique l’euthanasie.
12. Tout établissement médico-social doit permettre l’euthanasie en son sein
Le responsable de tout établissement médico-social est tenu de permettre la mise en œuvre du suicide assisté et de l’euthanasie dans ses locaux. Cette obligation s’appliquera aux établissements privés ayant une éthique spécifique opposée à l’euthanasie.
Le champ d’application (art. 14) est très large, cela concerne également les établissements médico-sociaux, qui accueillent temporairement des personnes handicapées ou des personnes en situation d’exclusion sociale, les EHPAD, les foyers de jeunes travailleurs, etc.
La totalité des amendements visant à permettre une clause de conscience pour les établissements a été rejetée, malgré les multiples rappels au cours des débats d’une directive européenne[8] affirmant qu’« une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation ».
Si « Les murs n’ont pas de clause de conscience », la proposition de loi diffère en ce sens de la loi sur l’IVG, qui, bien que ne permettant plus de clause institutionnelle aux établissements publics[9], permet à un établissement privé de refuser la pratique de l’IVG en son sein (art. L2212-8 du CSP), une possibilité non reprise dans ce texte sur l’euthanasie.
Seront ainsi incluses les futures maisons d’accompagnement, pourtant dédiées aux soins palliatifs, ou encore les établissements confessionnels et non confessionnels dont l’éthique de l’organisation s’oppose fondamentalement à la pratique du suicide assisté ou de l’euthanasie.
- Pour aller plus loin : Loi sur la fin de vie: «L’objection de conscience des établissements confessionnels est un droit fondamental» / Euthanasie: le texte français est le plus répressif au monde à l’égard des établissements confessionnels
13. Les pharmaciens sont obligés de délivrer la substance létale
Les pharmaciens n’ont pas de clause de conscience et sont contraints de délivrer la substance létale. La France se démarque en cela des législations étrangères.
Les pharmaciens sont exclus du bénéfice de la clause de conscience (art. 14), cristallisant par là une antinomie entre l’obligation déontologique du pharmacien d’exercer sa mission « dans le respect de la vie et de la personne humaine » (art. R4235-2 du CSP) et la nouvelle obligation de préparer et délivrer une substance prescrite dont la finalité est de donner la mort (art. 6).
En l’état actuel du droit, un tel acte serait constitutif d’une complicité d’empoisonnement, dont la peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle[10]. L’intention de donner la mort est caractérisée par la production de la substance, poison dont la finalité est de donner la mort. Ce n’est pas parce que le pharmacien n’administre pas ce poison lui-même qu’il n’est pas impliqué dans la mort subséquente, aux yeux de la justice. Le lien entre la mort et l’administration de la substance est certain, bien qu’indirect, par la simple délivrance du produit par le pharmacien.
Le Conseil d’État, dans son avis du 4 avril 2024 sur le projet de loi, a estimé que la délivrance de la substance létale n’était pas « suffisamment directe » avec la mort du patient, pour porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens (§ 38). Le pharmacien qui auparavant, devait refuser la délivrance d’un tel produit au nom de l’intérêt de la santé du patient, et sous peine d’incrimination (art. R4235-61 du CSP) serait désormais contraint de le faire.
Ici encore, la France se démarque des législations étrangères par cette exclusion des pharmaciens. En effet, les législations belge, suisse, autrichienne, ou canadienne permettent au pharmacien d’objecter en conscience sous conditions.
- Pour aller plus loin : Nicolas Bauer et Agnès Certain, « Responsabilités, droits et devoirs du pharmacien ». In : Emmanuel Hirsch (dir.), Fins de la vie : les devoirs d’une démocratie, Éditions du Cerf, 2025, pp. 407-418.
14. Le délit d’entrave limite la possibilité de prévenir l’euthanasie et le suicide assisté
Une personne cherchant à dissuader un proche de se suicider pourrait être poursuivi pour « pression morale » constitutive du délit d’entrave.
L’article 17 de la loi crée un délit d’entrave à l’« aide à mourir », puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les peines ont été alignées sur celles du délit d’entrave à l’IVG (Article L.2223-2), et donc doublées par rapport à la proposition initiale.
Ce délit réprime le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher la pratique ou l’information sur l’aide à mourir, notamment en exerçant une perturbation dans l’accès aux établissements tenus de permettre la pratique de l’aide à mourir, ou en exerçant des pressions morales ou psychologiques à l’encontre des personnes cherchant à s’informer.
Ce délit est contraire à l’obligation positive des Etats de prévenir le suicide résultant du droit au respect de la vie (art. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme), tel qu’interprété par la Cour européenne.
À la lumière de la jurisprudence relative à l’entrave à l’IVG, on constate que les pressions morales et psychologiques sont caractérisées dès lors qu’elles sont constatées subjectivement par des femmes venues consulter le planning familial pour obtenir une information relative à l’IVG[11].
En matière d’euthanasie et de suicide assisté, c’est le médecin qui exerce un contrôle sur les « pressions » (art. 9), et qui veille au moment de l’administration de la substance, à ce qu’aucun proche, bénévole accompagnant ou encore la personne de confiance n’exprime de convictions ayant pour but de dissuader le patient. Le médecin pourrait facilement considérer subjectivement les propos d’un proche ou d’un accompagnant comme une pression morale et psychologique et signaler au Procureur de la République la commission d’un délit d’entrave.
Cette disposition est une atteinte grave à la liberté d’expression et d’opinion, consacrée par l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce délit d’entrave délictualiserait l’activité de certains soignants, accompagnants, bénévoles et proches, en désaccord avec la procédure « d’aide à mourir ».
Le même article crée un droit pour toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans et dont l’objet statutaire comporte le droit à l’accès à l’aide à mourir, d’exercer l’action civile en cas de délit d’entrave. Ainsi la principale association militante en faveur de la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie en France, l’ADMD, sera titulaire de l’action civile en représentation des personnes qui auront déclaré subir une entrave au sens du délit créé et de la jurisprudence relative à l’IVG. Cette même association sera en mesure de tenir des registres de médecins « aidant à mourir », tout en repérant les institutions dont l’éthique de travail s’oppose à la pratique de l’euthanasie, susceptibles de refuser sa mise en œuvre dans leurs locaux.
Conclusion
L’analyse de la proposition de loi révèle un dispositif qui, par sa conception même, facilite l’accès au suicide. La procédure se singularise par son caractère expéditif, avec des délais de décision et de réflexion particulièrement courts ; un pouvoir de décision finale concentré entre les mains d’un seul médecin référent, et un collège pluriprofessionnel réduit à un rôle purement consultatif. L’absence quasi-totale de recours juridique pour les tiers et l’insuffisance des mécanismes de contrôle a priori éliminent de potentiels garde-fous, créant un boulevard vers la mort administrée, qui risque de devenir une autoroute en raison des difficultés d’accès aux soins palliatifs.
Cette légalisation française du suicide assisté et de l’euthanasie se révèle d’autant plus préoccupante qu’elle est nettement plus libérale que celle de ses voisins. Les délais prévus sont plus brefs qu’en Belgique ou en Autriche, le droit de recours pour les tiers est plus restreint qu’en Belgique, en Espagne ou aux Pays-Bas et l’absence de clause de conscience pour les pharmaciens est une exception par rapport aux pratiques canadienne, belge, suisse ou autrichienne.
Ce caractère particulièrement permissif laisse d’autant plus craindre l’effet de « la pente glissante » déjà observé à l’étranger et qui se manifeste systématiquement par un élargissement progressif des conditions d’accès et d’une augmentation constante du nombre d’euthanasies. En partant d’un cadre législatif initial ultralibéral, la France risque non seulement de suivre l’exemple des autres pays, mais même d’aggraver les dérives encore plus rapidement.
Jean-Louis Wurtz.
_____
[1] Réseau Épidémiologie et Information en Néphrologie, Rapport annuel, 2022.
[2] Fondation pour la Recherche sur le Cerveau, Les maladies psychiatriques et les troubles du comportement, dernier accès le 22 juillet 2025.
[3] Oregon Health Authority Public Health Division, Loi sur la mort dans la dignité de l’Oregon : Bilan des données 2023 (Oregon Death with Dignity Act: 2023 Data Summary), p. 14.
[4] Catherine Vautrin, Fin de vie étonnant lapsus de la Ministre Vautrin, RTL Le grand jury, 21 mars 2024.
[5] Cour des comptes, Communication à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, « Les soins palliatifs une offre à renforcer », juillet 2023.
[6] Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-632, QPC du 2 juin 2017.
[7] Association Médicale Mondiale, Assemblée Générale d’octobre, 2019.
[8] Conseil de l’Union européenne, Directive 2000/78/CE, 27 novembre 2000, article 4 paragraphe 2.
[9] Conseil Constitutionnel, Décision n° 2001-446 DC, 27 juin 2001.
[10] Art. 221-5 Code pénal ; Cour de cassation, chambre criminelle, 6 septembre 2017, n° 17-84.446, Inédit.
[11] Cour de cassation, Chambre criminelle, N° 14-87.441, 1er septembre 2015, Inédit.





