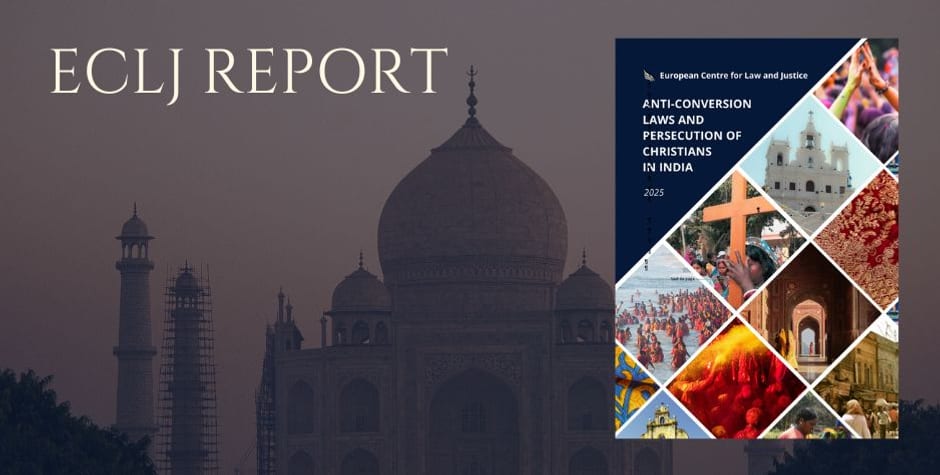

Lois anti-conversion et persécution des chrétiens en Inde
Inde: Lois anti-conversion & persécution des chrétiens
Ce rapport analyse l’intensification de la persécution des chrétiens en Inde, à la suite de la 41ᵉ session de l’Examen Périodique Universel (EPU) de l’Inde en 2022. L’étude met en particulier l’accent sur l’impact des lois anti-conversion, qui sont utilisées comme un outil d’oppression contre les minorités religieuses, en particulier les chrétiens.
Les nationalistes hindous exploitent ces lois pour accuser faussement les chrétiens de conversions forcées. En 2024, plus de 160 attaques violentes contre des chrétiens ont été signalées en Inde.[1] Ces agressions vont des attaques contre des églises et des réunions de prière jusqu’aux agressions physiques[2]. Entre janvier et septembre 2024, près de 600 services religieux ont été interrompus par des extrémistes hindous[3]. Au cours du premier semestre 2023, 400 incidents avaient été recensés, contre 274 pour la même période en 2022[4].
I. Contexte
A/ La démographie religieuse de l’Inde
L’Inde, qui compte environ 1,4 milliard d’habitants, est un pays marqué par une grande diversité religieuse[5]. Selon le recensement de 2011, les principaux groupes religieux sont :
- Hindous – 80%.
- Musulmans – 14%.
- Chrétiens – 2.3%.[6]
Le reste de la population est composé de communautés tribales et de traditions spirituelles indigènes[7]. Malgré cette diversité, les minorités religieuses, en particulier les chrétiens, sont confrontées à une discrimination et une violence croissantes[8]. Bien que la Constitution indienne garantisse la liberté religieuse, la montée des mouvements nationalistes hindous a favorisé une intolérance grandissante envers les confessions non hindoues[9].
B/ Une transformation du paysage de l'harmonie religieuse
Souvent présentée comme la plus grande démocratie du monde, l'Inde est devenue, ces dernières années, de plus en plus hostile envers les chrétiens et les autres minorités religieuses[10]. Cette tendance inquiétante, soulignée dans la contribution de l’ECLJ à l’EPU de 2022[11], contraste fortement avec la réputation du pays en matière de tolérance religieuse. L’hindouisme et le bouddhisme, qui trouvent tous deux leur origine en Inde, ont traditionnellement été perçus comme des philosophies prônant la paix[12]. Par exemple, le concept d'ahimsa (non-violence) a joué un rôle central dans la construction de l’identité culturelle et spirituelle du pays[13]. Cependant, depuis les années 1990[14], une forme plus militante et agressive de l'hindouisme a émergé, entraînant une forte régression de la tolérance envers la dissidence, les droits des minorités et la diversité religieuse[15].
C/ Le système des varnas (castes)
Avant d’aborder le système politique et juridique de l’Inde, il est essentiel de présenter son système traditionnel des castes. Il s’agit d’une structure hiérarchique qui divise la société en quatre varnas (classes) principales[16]:
- Brahmanes (prêtres, érudits)
- Kshatriyas (guerriers, dirigeants)
- Vaishyas (marchands, commerçants)
- Shudras (ouvriers, artisans, serviteurs)
Sous ces quatre varnas, se trouvent les « Dalits », historiquement appelés "Intouchables", qui étaient exclus du système des castes et relégués aux travaux les plus dégradants (ex. : ramassage des déchets, élimination des carcasses d’animaux)[17]. Le système de castes est héréditaire et détermine le statut social, la profession et l'accès aux ressources[18].
Les Dalits chrétiens et les politiques d’actions positive
Les Dalits, largement reconnus comme Castes répertoriées (CR) sont victimes de discrimination et de marginalisation extrêmes depuis des siècles[19].
Pour remédier à ces injustices, la Constitution indienne permet la mise en place de politiques d’action positive. Des articles comme l’article 15(4) et l’article 16(4) autorisent l’État à adopter des mesures spécifiques ou à réserver des emplois aux CR et aux Tribus répertoriées (TR).[20] Les TR regroupent des communautés qui ont refusé le système de castes et ont choisi de vivre dans des régions reculées, comme les jungles, forêts, montagnes...[21]
Par exemple, l’article 46 de la Constitution stipule:
- “L'État doit promouvoir avec une attention particulière les intérêts éducatifs et économiques des sections les plus faibles de la population, en particulier les Castes répertoriées et les Tribus répertoriées, et les protéger contre l’injustice sociale et toute forme d’exploitation.”[22]
Cependant, les Dalits chrétiens, qui devraient logiquement être inclus parmi les CR, sont systématiquement exclus de ces avantages en raison d’une politique discriminatoire instaurée par l’Ordre présidentiel de 1950[23]. Cet ordre stipule que seuls les Dalits appartenant à l’hindouisme, au sikhisme (depuis 1956) et au bouddhisme (depuis 1990) peuvent bénéficier des politiques d’action positive. Ceux qui se convertissent au christianisme ou à l’islam perdent automatiquement ces protections et avantages[24].
II. Paysage politique et juridique
A/ La structure politique et juridique de l’Inde
Pour comprendre comment les politiques nationales de l’Inde entrent en conflit avec ses obligations constitutionnelles et internationales, il est essentiel d’examiner le cadre politique et juridique dans lequel elles s’inscrivent.
L’Inde fonctionne comme un système fédéral[25], avec une gouvernance partagée entre le gouvernement central et 28 États, ainsi que 8 territoires de l’Union[26]. Ces derniers sont directement administrés par le gouvernement central, tandis que les États bénéficient d’un niveau variable d’autonomie[27].
L’Inde se présente comme une République souveraine, laïque et démocratique, dotée d’un système parlementaire[28]. Cependant, dans la pratique, l’influence croissante des nationalistes hindous façonne de plus en plus les politiques publiques, fragilisant la gouvernance laïque et institutionnalisant la discrimination à l’égard des minorités religieuses[29].
Le nationalisme hindou et son impact sur les minorités religieuses
La montée du nationalisme hindou, en particulier par le biais d’organisations comme Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) et ses affiliés est devenu une force motrice derrière la persécution des minorités religieuses en Inde. Ces groupes adhèrent à l'idéologie Hindutva, qui envisage l'Inde comme une nation exclusivement hindoue, dépeignant les chrétiens et les musulmans comme des menaces culturelles et démographiques. Au-delà des différences religieuses, le christianisme pose également un défi au système traditionnel de « varna » (caste).
B/ L’influence politique du nationalisme hindou et le rôle du BJP
Depuis mai 2014, l’Inde est gouvernée par le Bharatiya Janata Party (BJP)[30], un parti idéologiquement proche du Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) et fortement influencé par l’idéologie de l’Hindutva[31].
En soutenant ou en gardant le silence sur les lois anti-conversion[32], le BJP a activement poursuivi les objectifs de l’Hindutva, visant à faire de l’hindouisme la religion d’État, en contradiction avec l’engagement constitutionnel de l’Inde en faveur de la laïcité[33].
Le premier ministre Modi et son héritage
Les statistiques confirment la détérioration alarmante de la liberté religieuse en Inde. Sous la direction du Premier ministre Narendra Modi du BJP, le pays a connu une augmentation préoccupante des violences contre les chrétiens. Selon les données du United Christian Forum, le nombre d’incidents de violences anti-chrétiennes a explosé entre 2014 et 2024,[34] en corrélation avec l’influence croissante des nationalistes hindous au sein du gouvernement.
Avant de devenir Premier ministre, Modi a exercé la fonction de ministre en chef du Gujarat de 2001 à 2014. Son mandat a été marqué par l’un des pires épisodes de violences communautaires en Inde : les émeutes du Gujarat de 2002. Modi a été fortement critiqué pour sa gestion de ces événements,[35] au cours desquels une violence extrême a été dirigée contre la communauté musulmane, causant de nombreuses victimes[36]. En conséquence, Modi a été interdit d’entrée aux États-Unis pendant près d’une décennie, en raison d’accusations de "graves violations de la liberté religieuse"[37]. Malgré cette condamnation internationale, son positionnement nationaliste hindou a consolidé son soutien au niveau national, lui permettant d’être élu Premier ministre en 2014, puis réélu en 2019 et en 2024[38], renforçant ainsi son influence politique et celle du BJP.
Ce changement idéologique a fragilisé la gouvernance laïque et instauré un climat où les pratiques discriminatoires envers les minorités religieuses sont de plus en plus institutionnalisées.
La position du gouvernement
Des responsables gouvernementaux et des leaders politiques ont participé au harcèlement des minorités religieuses, comme en témoigne une lettre envoyée par un haut fonctionnaire au Premier ministre Narendra Modi[39]. Par exemple, en 2023, des activistes de la société civile ont accusé N. Biren Singh, ministre en chef du BJP, d’attiser les divisions à Manipur en soutenant politiquement des groupes violents et en présentant la communauté chrétienne Kuki comme des criminels impliqués dans le trafic de drogue et l'immigration illégale[40].
Des rapports indiquent également que la police locale a soit aidé des foules violentes à perturber les offices chrétiens, soit resté passive face aux attaques contre des croyants chrétiens[41].
Au-delà de la violence physique, une discrimination économique a aussi été encouragée, certains responsables publics appelant au boycott des commerces chrétiens et musulmans[42].
Face à cette situation, les minorités religieuses en Inde s’interrogent sur la capacité et la volonté du gouvernement à les protéger contre les violences, à enquêter sur les crimes commis à leur encontre et à garantir leur liberté religieuse[43].
Les discours et actions du gouvernement ont favorisé un climat d’hostilité, dans lequel les attaques contre les minorités religieuses deviennent de plus en plus fréquentes. La section suivante détaille des cas documentés de persécution entre 2022 et 2024.
III. Les développements récents de la persécution
Selon le United Christian Forum (UCF), les violences contre les chrétiens ont fortement augmenté depuis l’arrivée au pouvoir du Bharatiya Janata Party (BJP) en 2014[44]. Alors qu’en 2014, moins de 100 incidents avaient été signalés, ce nombre est passé à près de 300 en 2018 et a continué d’augmenter chaque année, atteignant environ 750 en 2023, soit en moyenne 2 attaques par jour contre des chrétiens[45]. L’UCF attribue cette recrudescence à des actions organisées par des groupes pro-hindous ciblant les communautés chrétiennes[46].
Le rapport "Violence Monitor 2024" de l’UCF, basé sur les cas signalés via sa ligne d’assistance, a recensé 834 incidents en 2024, avec les États de l’Uttar Pradesh (209 incidents) et du Chhattisgarh (165 incidents) en tête[47]. Cependant, ces chiffres ne concernent que les cas déclarés à l’UCF, ce qui suggère que le nombre réel d’incidents pourrait être bien plus élevé.
Les rapports annuels de la Commission des États-Unis sur la liberté religieuse internationale (USCIRF), ainsi que les conclusions d’Open Doors et de Hindutva Watch, soulignent l’aggravation de la liberté religieuse en Inde. Ces organisations rapportent de nombreuses attaques contre les minorités religieuses, ainsi qu’une utilisation abusive croissante des lois anti-conversion pour cibler les communautés vulnérables[48].
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des violations documentées entre 2022 et 2024. Compte tenu du nombre important d’incidents, ce rapport mettra en avant 3 à 5 cas clés par an, illustrant l’ampleur et la gravité de la persécution subie par les chrétiens en Inde.
A/ La persécution en 2022
Février 2022 : Des radicaux hindous détruisent un centre catholique vieux de 40 ans
En février 2022, des groupes hindous ont démoli le St. Anthony’s Holy Cross Center, une maison de prière et d’accueil catholique située dans le sud de l’Inde. Construit il y a 40 ans, ce centre servait de sanctuaire pour la communauté chrétienne locale, offrant un soutien aux familles en détresse et aux demandeurs d’asile. Les groupes hindous ont qualifié le bâtiment d’"illégal" et ont exigé sa destruction. Sans aucune justification légale, ces groupes ont amené un bulldozer sur place et ont rasé le bâtiment, laissant 30 familles chrétiennes sans abri.[49]
La même semaine, un autre acte de violence a été signalé dans le village de Kistaram, en Inde centrale, où des habitants ont incendié une église protestante.[50]
Juillet 2022 : Arrestations de chrétiens en Uttar Pradesh
En juillet 2022, les autorités de l'Uttar Pradesh ont arrêté plusieurs pasteurs et chrétiens, les accusant de conversions forcées, ce qui a conduit à l'interruption de plusieurs rassemblements chrétiens. Lors d’un incident, le pasteur S. Kanoojiya et quatre autres chrétiens ont été arrêtés et placés en garde à vue.[51] Bien qu’il ait été libéré sous caution, le pasteur Kanoojiya a été contraint de fermer son église domestique, où 150 fidèles se rassemblaient chaque semaine. Évoquant cette persécution, il a déclaré : "Les nationalistes hindous radicaux tentent constamment de faire fermer l’église." Il a ajouté qu’il prévoit désormais de rendre visite aux fidèles individuellement pour continuer les cultes et la prière.[52]
Le même jour, des groupes hindous radicaux, dont des membres du RSS, ont perturbé un autre service religieux, harcelé des chrétiens et fait pression sur la police pour qu’elle arrête cinq fidèles, sous prétexte de conversions forcées. Dans un autre incident distinct, un pasteur a été arrêté alors qu’il rendait visite à une famille locale[53].
Juillet 2022 : Arrestation de femmes dalits chrétiennes pour « conversions forcées »
En juillet 2022, six femmes dalits chrétiennes ont été arrêtées à Azamgarh, en Uttar Pradesh, après avoir été faussement accusées de pratiquer des conversions forcées lors de l’anniversaire d’un enfant. En réalité, ces femmes s’étaient simplement réunies pour prier avant de couper le gâteau, mais le chef d’un groupe Hindutva a déposé une plainte contre elles en vertu de l’Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2021. Elles ont alors été arrêtées et se sont vu refuser la libération sous caution, une décision qui semble avoir servi les intérêts politiques du groupe Hindutva.[54]
Août 2022 : Un évangéliste chrétien brutalement assassiné par sa propre famille
En août 2022, Madhavan, un évangéliste chrétien du Bengale-Occidental, a été brutalement assassiné par sa propre famille et des villageois, car il refusait de renoncer à sa foi. Il a été traîné dans une forêt, aspergé d’essence et brûlé vif[55]. De manière choquante, la police locale a refusé d’intervenir, qualifiant ce meurtre de "problème familial" et refusant d’ouvrir une enquête[56]. Cet acte atroce n’est pas un cas isolé, mais fait partie des nombreuses violences extrêmes auxquelles les chrétiens en Inde sont confrontés, souvent dans une impunité totale.
Décembre 2022 : Émeutes anti-chrétiennes dans 20 villages du Chhattisgarh
En décembre, des chrétiens de 20 villages situés dans les districts de Narayanpur et Kondagaon, au Chhattisgarh, ont été violemment attaqués par des nationalistes hindous radicaux pour avoir refusé de renoncer au christianisme et de se reconvertir à l’hindouisme. Les attaques, qui ont visé des chrétiens rassemblés pour le culte du dimanche, ont entraîné le pillage et la destruction de maisons, la profanation d’églises et des agressions physiques. Certaines victimes ont subi des blessures graves nécessitant une hospitalisation, tandis que d’autres ont fui vers la jungle ou les postes de police les plus proches.[57]
Un témoin oculaire a décrit des familles entières, y compris des femmes et des enfants, livrées à elles-mêmes dans le froid, sans nourriture ni eau. La police aurait refusé d’intervenir, déclarant aux victimes de "se débrouiller seules".[58]
Un responsable d’église a affirmé que ces attaques rappellent douloureusement les émeutes anti-chrétiennes d’août 2008 à Kandhamal, au cours desquelles 39 chrétiens ont été tués et 3 906 maisons détruites par des nationalistes hindous radicaux.[59]
B/ La persécution en 2023
Janvier 2023 : Des chrétiens laissés sans abri au Chhattisgarh
À la suite des attaques de décembre 2022, les chrétiens déplacés ont été contraints de se réfugier dans des stades à ciel ouvert et des installations gouvernementales, où les conditions étaient très précaires, sans nourriture, eau, vêtements ni couvertures. De nombreuses victimes ont rapporté que des leaders nationalistes locaux avaient incité à la violence et encouragé des boycotts sociaux, accentuant encore la marginalisation de la communauté chrétienne. Les personnes les plus vulnérables, notamment les enfants et les femmes, ont été confrontées à des menaces, des agressions physiques et des propos obscènes.[60]
Octobre 2023 : Les groupes Hindutva détournent la loi anti-conversion de l’Uttar Pradesh
Une étude menée par "Article 14" sur 101 affaires enregistrées en vertu de l'Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2021, a révélé que plus de 60 % des plaintes pour conversions forcées au christianisme ont été déposées par des tiers, principalement des organisations Hindutva, et non par les victimes présumées elles-mêmes[61]. Ces plaintes reposaient souvent sur des accusations vagues, telles que la présence de littérature chrétienne ou des rassemblements de prière, sans fondement juridique, alors que la loi stipule que seule la personne concernée ou un proche peut déposer une plainte[62].
D’anciens responsables ont dénoncé cet abus de la loi[63], qui facilite les fausses accusations et permet à la police d’engager des poursuites infondées contre des chrétiens.
Par exemple, le pasteur Paras a été arrêté en 2022 en vertu de cette loi, après qu’un tiers l’ait accusé de chercher à convertir des personnes par l’argent et la peur. En réalité, il assistait simplement à une réunion de prière et avait récité un verset de la Bible lorsque la police est venue l’arrêter. Il a ensuite passé 19 jours en prison, illustrant ainsi comment ces lois sont utilisées pour intimider et arrêter des chrétiens.[64]
Par la suite, en août 2024, l’Uttar Pradesh a modifié sa loi sur la liberté religieuse pour autoriser toute personne à déposer une plainte, élargissant encore les possibilités d’abus (cf. fn 63 pour la disposition légale)[65].
Mai 2023 : Affrontements à Manipur
En mai 2023, de violents affrontements ont éclaté entre la majorité hindoue Meitei et la population chrétienne Kuki dans l'État de Manipur, entraînant plus de 200 morts, le déplacement de 60 000 personnes[66] et la destruction de plus de 250 églises[67]. Le conflit a commencé lorsque les tribus Kuki ont organisé des manifestations contre la décision d’accorder le statut tribal à la communauté Meitei, un statut généralement réservé aux groupes marginalisés pour leur permettre d’accéder à des mesures d’action positive, telles que des emplois réservés et des protections foncières. À Manipur, cette décision a été perçue comme une menace directe pour les Kukis, car elle permettrait aux Meiteis de revendiquer des terres historiquement possédées par la communauté Kuki. Se sentant profondément lésés, les Kukis ont protesté pacifiquement, mais la situation a rapidement dégénéré en un conflit ethnique et religieux[68].
Les attaques ont été d’une extrême brutalité, comprenant des meurtres, des incendies criminels et des violences sexuelles, principalement dirigées contre la communauté chrétienne Kuki. Dans un cas particulièrement horrifiant, deux femmes Kuki ont été exhibées nues en public, tandis que leurs proches étaient battus à mort[69].
La violence ne s’est pas limitée aux divisions ethniques : des chrétiens Meitei ont également été pris pour cible par des groupes hindous. Beaucoup ont été contraints de renoncer au christianisme en signant des déclarations de conversion et en brûlant leurs Bibles. Ceux qui refusaient faisaient face à des menaces, des agressions et la destruction de leurs églises[70].
Les leaders Kuki ont accusé le gouvernement du Manipur, dirigé par le BJP, de complicité et d’inaction face à ces violences, soulignant l’échec des autorités à protéger les minorités ou à intervenir efficacement. Des rapports ont également pointé du doigt l’inaction de la police et les retards dans les enquêtes sur des crimes majeurs, comme l’agression des femmes Kuki. Malgré une plainte officielle déposée en mai, les autorités n’ont ouvert une enquête que plusieurs mois plus tard, sous la pression d’un scandale national et international, après la diffusion d’une vidéo virale de l’incident[71].
De nombreux Kukis ont décrit ces attaques comme une tentative orchestrée de les marginaliser à la fois sur le plan ethnique et religieux, mettant en évidence la vulnérabilité des chrétiens dans la région. L’incapacité des autorités à intervenir efficacement ou à prendre en charge les besoins des personnes déplacées illustre la négligence dont sont victimes les minorités chrétiennes dans cette crise[72].
En juillet 2023, OpenDoors a publié le témoignage d’une jeune chrétienne de Manipur qui a été contrainte d’accoucher dans la jungle alors qu’elle fuyait les violences qui avaient détruit sa maison[73].
En décembre 2024, la situation à Manipur reste tendue, le conflit persiste, et de nombreux déplacés vivent toujours dans des conditions précaires. Malgré les appels à l’intervention, le Premier ministre Narendra Modi ne s’est jamais rendu dans l’État depuis le début des violences et a seulement chargé le ministre de l’Intérieur Amit Shah de gérer la crise[74].
C/ La persécution en 2024
- Août 2024 : La famille d’un pasteur décédé forcée de se reconvertir pour son enterrement, Chhattisgarh
En août 2024, la famille du pasteur Manju a été contrainte de renoncer à sa foi et de subir un ghar-wapsi (rituel de reconversion à leur religion d’origine) en échange de l’autorisation d’enterrer le pasteur dans leur village. De plus, les habitants locaux ont exigé que la famille paie 200 000 INR (environ 2 300 USD) comme condition supplémentaire pour procéder à l’inhumation[75].
Malgré les supplications de la famille et la présence d’autres pasteurs venus pour célébrer les funérailles, la police a pris parti pour les villageois. Finalement, l’épouse et les enfants du pasteur ont été forcés de participer à des rituels animistes, et le pasteur Manju a été enterré selon des rites non chrétiens[76].
Très récemment, en janvier 2025, la Cour suprême a confirmé une décision de la Haute Cour du Chhattisgarh, concluant qu’une personne peut se voir refuser l’enterrement dans son propre village en raison de sa foi [77].
- Octobre 2024 : Des chrétiens attaqués au Chhattisgarh sous le regard passif de la police
En octobre 2024, une foule de plusieurs centaines de personnes a attaqué 14 chrétiens après que ces derniers ont refusé de renoncer à leur foi. Les agresseurs ont battu les victimes avec une telle violence que certaines ont eu des fractures et des traumatismes crâniens. Ils ont également détruit leurs maisons et incendié leurs récoltes. Un officier de police qui a tenté d’intervenir a été blessé, mais la majorité des policiers présents ont refusé de protéger les victimes.[78] Nagesh Micha, un militant chrétien, a dénoncé cette inaction : "La police, qui est censée défendre les droits fondamentaux des individus, a laissé 14 personnes se faire battre sous ses yeux. […] Cela signifie que des autorités supérieures soutiennent ces foules violentes[79]."
- Décembre 2024 : Perturbation des célébrations de Noël
Le Noël 2024 en Inde a été marqué par des violences et des perturbations alors que des groupes nationalistes hindous ont attaqué des rassemblements chrétiens dans plusieurs États, notamment au Kerala, au Rajasthan, en Uttar Pradesh, dans l'Odisha, au Madhya Pradesh et à Manipur. Ces violences, attribuées à des extrémistes hindous, ont inclus des actes de vandalisme dans les églises et sur les crèches, des agressions physiques contre des pasteurs et des croyants, ainsi que des perturbations des services de Noël dans les écoles, les lieux publics et les domiciles privés[80].
Au Kerala, une célébration de Noël organisée dans une école à Palakkad a été attaquée[81]. En Odisha, deux femmes et un homme ont été attachés à un arbre et battus, accusés à tort d’activités de conversion. Dans un autre incident, un pasteur et son épouse enceinte ont été contraints de piétiner des Bibles. Au Madhya Pradesh, à Jabalpur, des statues de la Vierge Marie ont été vandalisées, tandis qu’à Bhopal, les services religieux ont été perturbés. Par ailleurs, à Manipur, les violences ethniques persistantes entre les communautés Meitei et Kuki ont repris de l’ampleur, avec des attaques signalées le jour de Noël[82].
Bien que le Premier ministre indien Narendra Modi ait assisté à une célébration de Noël organisée par la Conférence des évêques catholiques de l'Inde à New Delhi, et malgré ses éloges publics envers les enseignements de Jésus-Christ sur l’amour et l’harmonie, des membres de groupes nationalistes hindous ont poursuivi leur campagne d’intimidation et de violence. Plusieurs dirigeants chrétiens et évêques ont dénoncé cette hypocrisie, accusant les nationalistes hindous de prôner publiquement l’harmonie tout en incitant à la violence contre les chrétiens dans tout le pays[83].
Les schémas de persécution entre 2022 et 2024 révèlent une réalité profondément préoccupante, les chrétiens en Inde sont confrontés non seulement à une violence ciblée de la part de groupes extrémistes, mais aussi à un harcèlement juridique facilité par les lois anti-conversion soutenues par l’État. Le nombre élevé d’attaques, allant des violences de masse et reconversions forcées aux arrestations arbitraires, illustre une campagne systématique de suppression des minorités religieuses.
Pourtant, malgré ces violations croissantes, le gouvernement indien continue de minimiser ou d’écarter ces faits. Le gouvernement a notamment rejeté les conclusions de l’USCIRF, qualifiant celles-ci de "biaisées et motivées par un agenda politique"[84]. Plutôt que d’examiner les accusations, pourtant appuyées par des documents vérifiables publiquement, l’Inde refuse d’engager le dialogue[85], révélant ainsi un schéma récurrent de déni et d’évitement. En agissant ainsi, l’Inde échoue non seulement à reconnaître la réalité de la situation, mais aussi à s’attaquer aux discriminations subies par ses minorités religieuses.
Bryan Nerren, un Pasteur étranger ciblé pour sa foi
La persécution des chrétiens en Inde ne touche pas seulement les croyants locaux, mais s’étend également aux figures religieuses étrangères. L’ECLJ souhaite rappeler le cas du pasteur chrétien et citoyen américain Bryan Nerren, qui a été arrêté et détenu injustement pendant plus de sept mois entre 2019 et 2020[86].
Durant cette période, un agent des douanes a clairement indiqué que le pasteur Nerren était ciblé en raison de sa foi chrétienne, déclarant : "Nous avons reçu l'ordre du gouvernement central d'écraser le christianisme. Pour vous empêcher, vous les Américains, d'apporter de l'argent ici, et pour éliminer le christianisme[87].”
Bryan Nerren se rendait régulièrement en Inde et au Népal dans le cadre de son ministère à but non lucratif, l’Asian Children’s Education Fellowship, qui forme des enseignants d’écoles du dimanche et apporte une aide aux enfants défavorisés[88]. En octobre 2019, il a été arrêté en Inde en vertu de la Foreign Exchange Management Act (FEMA) et du Customs Act, sous prétexte qu’il n’avait pas déclaré l’argent qu’il transportait pour son travail missionnaire[89]. Les autorités ont alors confisqué son passeport et lui ont imposé une interdiction de voyager[90], l’empêchant ainsi de quitter l’Inde. Pendant sa détention, le pasteur Nerren a rapporté avoir été maltraité et avoir subi une hostilité religieuse. Un médecin aurait craché par terre en apprenant qu’il était chrétien[91].
Comme l’illustre le cas du pasteur Nerren, ainsi que d’autres affaires mentionnées précédemment, la persécution des chrétiens en Inde ne se limite pas à la violence physique, mais repose de plus en plus sur des outils juridiques pour intimider et réprimer les minorités religieuses. Bien que le pasteur Nerren n’ait pas été inculpé en vertu des lois anti-conversion, son arrestation arbitraire, sa détention prolongée et les mauvais traitements qu’il a subis démontrent comment les cadres juridiques existants, y compris les réglementations financières, sont utilisés comme des armes pour restreindre les activités chrétiennes.
De la même manière, les lois anti-conversion, initialement conçues pour prévenir les conversions forcées, sont devenues un puissant outil de persécution des chrétiens. Ces lois criminalisent l’expression religieuse, imposent des sanctions sévères aux convertis et instaurent un climat où de fausses accusations peuvent facilement mener à des arrestations, légitimant ainsi la persécution par des moyens juridiques.
La section suivante examine la structure de ces lois anti-conversion, leur application sélective et leur impact dévastateur sur la liberté religieuse en Inde.
IV. Présentation de la situation : Les lois anti-conversion
Le gouvernement indien et diverses administrations d’État ont mis en place des lois anti-conversion sous le prétexte de protéger la religion, de protéger les plus vulnérables[92] et de préserver le patrimoine culturel et linguistique[93]. Un euphémisme bien commode pour justifier la suprématie hindoue et la marginalisation des minorités religieuses[94]. En pratique, ces lois sont appliquées de manière sélective contre les minorités religieuses, en particulier les chrétiens et les musulmans[95].
A/ Les mesures fédérales anti-conversion
Selon Selvaraj S., dans son article “Acts of Violence? Anti-Conversion Laws in India”, depuis 2019, des mesures significatives ont été prises pour ancrer une rhétorique "anti-minorités" dans les lois fédérales[96]. Parmi ces mesures clés figure:
Le Citizenship Amendment Act (CAA)
Le Citizenship Amendment Act (CAA) permet aux réfugiés de toutes les religions, à l'exception de l'islam, en provenance de pays voisins, d’obtenir la citoyenneté indienne[97]. Cette exclusion s’aligne sur l’idéologie de l’Hindutva, qui cherche à privilégier l’identité hindoue au détriment des autres minorités religieuses.
Le Code Civil Uniforme (CCU)
Une autre proposition fédérale majeure, le Code Civil Uniforme (CCU), vise à remplacer les lois personnelles fondées sur les écritures religieuses et les coutumes par un cadre juridique standardisé régissant le mariage, le divorce, l’héritage et l’adoption[98]. Les critiques, notamment la Commission des États-Unis sur la liberté religieuse internationale (USCIRF), soulignent que cette réforme fragilise les minorités religieuses, pour qui ces lois personnelles sont essentielles à leur identité et à leur liberté religieuse[99]. Bien que présenté comme une réforme juridique, le CCU est souvent utilisé comme un outil pour marginaliser les traditions non hindoues, en faveur d’une identité nationale homogénéisée[100].
Le Code Pénal Indien (CPI) et son instrumentalisation
Le Code pénal indien (CPI)[101] contient une disposition souvent utilisée pour criminaliser l’expression religieuse. Section 295A[102] (chapitre XV) pénalise les actes délibérés et malveillants visant à offenser les sentiments religieux, mais sa formulation vague et sans cadre précis[103] offre une large marge d’interprétation aux autorités, ce qui entraîne une application sélective de la loi. Par exemple, en 2022, le pasteur Kuryichan V et son épouse Salenamma ont été inculpés en vertu de l’article 295A pour une prétendue tentative de conversion de masse[104], illustrant comment ces lois sont instrumentalisées contre les chrétiens[105].
B/ Les lois anti-conversion au niveau des Etats
Les lois sur la liberté de religion adoptées au niveau des États fédérés ont intensifié la criminalisation des conversions religieuses.
Actuellement, 12 des 28 États indiens ont mis en place des lois anti-conversion:
- Odisha (1967), Madhya Pradesh (1968), Arunachal Pradesh (1978), Chhattisgarh (2000/2006), Gujarat (2003), Himachal Pradesh (2006/2019), Jharkhand (2017), Uttarakhand (2018), Uttar Pradesh (2020), Haryana (2022), Karnataka (2022)[106] et Rajasthan (2024)[107].
- Dans l’Arunachal Pradesh et au Rajasthan, ces lois n’ont pas encore été pleinement implémentées[108].
Ces lois anti-conversion présentent des dispositions très similaires. Elles visent à empêcher les conversions et prévoient différentes sanctions en cas de non-respect, certaines ayant été modifiées au fil des ans. Comme l’explique un auteur :
« L’objectif a toujours été le même dans chaque projet de loi : restreindre la capacité des communautés et des individus à se convertir ‘depuis la religion de leurs ancêtres’ souvent sous prétexte de protéger les catégories considérées comme ‘faibles’ ou plus facilement ‘influençables’ – à savoir les femmes, les enfants, les castes défavorisées et les intouchables[109].»
Tableau : Lois de certains États et leurs principales dispositions[110]:
État | Année d’adoption | Principales dispositions |
Odisha | 1967 | Exige une notification préalable de toute conversion[111]; prévoit des sanctions en cas de conversion forcée ou frauduleuse[112]. |
Madhya Pradesh | 1968 | Criminalise la conversion par "tromperie, incitation, menace, force, influence, coercition, mariage ou tout autre moyen frauduleux". Prévoit des peines allant jusqu'à 5 ans de prison (§3.1(a) & §5). Exige une déclaration officielle avant toute conversion (§10). La charge de la preuve repose sur l'accusé, qui doit démontrer que la conversion n’a pas été obtenue par la force ou la fraude (§12)[113]. |
Chhattis-garh | 2000 | Reprend la loi de Madhya Pradesh de 1968[114]. En 2024, le gouvernement a souhaité introduire des dispositions plus strictes[115]. |
Gujarat | 2003 | Reprend la même criminalisation des conversions (§3). Exige une autorisation préalable du magistrat du district pour toute conversion (§5). Prévoit des sanctions plus sévères pour la conversion de mineurs, de femmes et de personnes issues des SC/ST (§4.2)[116]. |
Uttarak-hand | 2018 | Criminalise la conversion, mais précise que "si une personne revient à sa religion ancestrale, cela ne sera pas considéré comme une conversion au sens de cette loi" (§3)[117]. |
Uttar Pradesh | 2020 | Dispositions similaires. Les reconversions à l’hindouisme sont exemptées (Act n°3, 2021, §3.2). Toute personne peut déposer une plainte pour conversion illégale (First Information Report) (Act n°.7, 2024, §4)[118]. |
L’application ambiguë et sélective des lois
Les définitions vagues contenues dans ces lois permettent aux autorités des États de cibler sélectivement les chrétiens tout en exemptant les activités nationalistes hindoues[119]. Le Bureau américain pour la liberté religieuse internationale (rapport 2023[120]) classe ces lois parmi celles qui "restreignent la conversion religieuse par tromperie, force, influence indue, coercition, incitation, fraude ou mariage[121]".
Par exemple, la loi du Chhattisgarh stipule :
- "Nul ne doit convertir ou tenter de convertir, directement ou autrement, une personne d’une foi religieuse à une autre par l’usage de la force, par incitation ou par tout moyen frauduleux, ni encourager une telle conversion."[122]
Cependant, les termes "force", "frauduleux" et "incitation" sont largement interprétables et mal définis, offrant aux autorités une marge discrétionnaire excessive[123]. Ainsi, la notion d’"incitation" (allurement) inclut des actions telles que l’offre de dons, les activités caritatives ou la promesse d’une vie meilleure[124].
De plus, ces lois imposent des procédures complexes et font peser sur les accusés de conversion forcée une charge juridique injuste. En effet, c’est à l’accusé de prouver que la conversion était volontaire et non contrainte[125], plutôt qu’à l’accusateur de démontrer l’existence d’une coercition.
Cela facilite les accusations abusives, permet une application sélective et favorise la discrimination, tout en criminalisant des pratiques légitimes d’évangélisation, telles que la distribution de Bibles[126] ou l’aide humanitaire[127].
Parallèlement, l’hindouisme bénéficie souvent d’exemptions grâce à des classifications comme "religion d’origine"[128], par exemple dans les États de l’Himachal Pradesh, l’Arunachal Pradesh[129], l’Uttar Pradesh[130] et le Chhattisgarh[131]. Les pratiques hindoues, telles que le ghar wapsi (reconversion à l’hindouisme), restent exemptées de ces restrictions[132], illustrant ainsi une inégalité juridique flagrante qui renforce davantage les discriminations à l’encontre des chrétiens.
- Dans l’Himachal Pradesh, une déclaration d’intention de se convertir est obligatoire. Cependant, la loi précise : "Aucune déclaration ne sera requise si une personne revient à sa religion d’origine[133]."
Bien que l’Himachal Pradesh ait modifié sa loi en 2019 (Act n°13) pour remplacer "religion d’origine" par "religion des parents", et que l’Uttar Pradesh ait introduit en 2021 (Act n°3) le terme "religion précédente immédiate", ces formulations maintiennent en réalité une voie légale favorisant les reconversions à l’hindouisme. Cela signifie que les reconversions forcées sont exemptées de sanctions, car elles ne sont pas considérées comme des conversions.
Ainsi, selon la loi :
- "Si une personne revient à sa religion précédente immédiate, cela ne sera pas considéré comme une conversion au regard de cette loi[134]."
Même si ces lois semblent exclure les chrétiens indiens de naissance, elles ne le font pas en pratique. Par exemple, l’Amendement de 2006 sur la liberté de religion du Chhattisgarh (Act n°18) stipule que :
- "Le retour à la religion d’origine d’un ancêtre ou à sa propre religion par toute personne ne sera pas considéré comme une ‘conversion’[135]."
De plus, même dans les États n’ayant pas d’exemptions légales explicites, le ghar wapsi est pratiqué en toute impunité. Par exemple, en août 2024, en Odisha, 120 chrétiens ont été "reconvertis" de force à l’hindouisme, et ce malgré l’enracinement chrétien ancien de leur communauté[136].
Les violations des lois sur la liberté de religion peuvent entraîner des peines d’emprisonnement allant de trois à dix ans, ainsi que de lourdes amendes, en particulier lorsque la conversion concerne des femmes, des enfants ou des personnes issues des castes et tribus répertoriées (CR/TR)[137]. Certains États, comme Haryana et Gujarat, imposent des sanctions supplémentaires, notamment l’annulation des mariages considérés comme ayant pour but une conversion, une mesure ciblant le phénomène des "Love Jihads"[138]. Dans des États comme l’Andhra Pradesh et le Telangana, le prosélytisme est interdit à proximité des temples ou dans les zones désignées comme "villes-temples", ce qui revient à bannir toute propagation religieuse non hindoue[139].
Élément | « Définition » dans les lois | Impact sur les chrétiens | |
Incitation (allurement) | Offrir des avantages matériels ou spirituels pour encourager une conversion. | Toute aide humanitaire chrétienne peut être considérée comme une conversion forcée. | |
Force | Menace, pression psychologique ou sociale pour pousser quelqu’un à changer de religion. | Toute prédication peut être interprétée comme une pression illégale. | |
Fraude | Tromper quelqu’un pour le convertir. | Toute explication de la Bible peut être assimilée à une manipulation frauduleuse. | |
Le biais juridique et la discrimination soutenue par l’État
Les développements récents illustrent davantage l’intention discriminatoire derrière ces lois. Par exemple,
L'Assam Healing (Prevention of Evil) Practices Act, 2024 prétend réglementer les pratiques de "guérison magique", mais a été explicitement associé par le ministre en chef de l’Assam à une volonté de limiter l’évangélisation chrétienne et de maintenir le statu quo religieux[140]. Les groupes de défense des chrétiens dénoncent cette loi, affirmant qu’elle assimile la prière et le prosélytisme à des pratiques de guérison magique, ce qui porte atteinte à l’article 25 de la Constitution indienne, garantissant la liberté religieuse[141]. Des critiques soulignent que cette loi cible de manière disproportionnée les pratiques chrétiennes sous prétexte de réguler la "guérison magique"[142].
D’autres mesures, comme une circulaire du Gujarat exigeant une autorisation préalable pour les conversions de l’hindouisme au bouddhisme, au sikhisme ou au jaïnisme, montrent l’application sélective de ces lois. Pendant ce temps, les pratiques hindoues comme le ghar wapsi (reconversion à l’hindouisme) restent exemptées[143].
L’escalade de la persécution anti-conversion (2024-2025)
Au cours du premier semestre 2024, les autorités de plusieurs États ont renforcé de manière significative l’application des lois anti-conversion, entraînant des dizaines d’arrestations ciblant les minorités religieuses[144]. Par exemple :
- Uttar Pradesh : En juin 2024, la police a arrêté 13 chrétiens, dont quatre pasteurs, sous l’accusation de conversions forcées. Des accusations similaires ont été portées contre sept autres chrétiens lors d’incidents distincts en juillet. De plus, l'État a proposé un projet de loi visant à renforcer sa loi anti-conversion, en introduisant la réclusion à perpétuité pour les contrevenants et en rendant les conversions religieuses non libérables sous caution[145].
Dans l’Amendement Act n°7 de 2024, l'Uttar Pradesh a justifié ce durcissement en déclarant :
- "Compte tenu de la sensibilité et de la gravité du crime de conversion religieuse illégale, de la dignité et du statut social des femmes, ainsi que des activités organisées et planifiées d'éléments et d'organisations étrangers et anti-nationaux dans les conversions religieuses illégales et les changements démographiques, il a été estimé nécessaire d’augmenter le montant des amendes et des peines prévues par l’Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2021, et de rendre les conditions de libération sous caution plus strictes. Les dispositions pénales existantes de la loi ne sont pas suffisantes pour limiter et contrôler les conversions et les conversions de masse impliquant des mineurs, des personnes handicapées, des personnes souffrant de troubles mentaux, des femmes ou des personnes appartenant aux castes et tribus répertoriées [SC et ST]. De plus, il est devenu nécessaire de résoudre certaines difficultés rencontrées par le passé dans l’interprétation de l’article 4 de la loi. Par conséquent, il a été décidé de modifier ladite loi [146]."
- Chhattisgarh : En février 2024, les responsables de l'État ont annoncé un durcissement de la législation contre les conversions dites "illégales", accusant fréquemment les pasteurs chrétiens de forcer des hindous à se convertir[147].
En février 2025, des chrétiens ont été directement accusés d’être des tueurs de vaches dans plusieurs vidéos[148]. Étant donné que la vache est un animal sacré dans l’hindouisme, ces accusations ont déclenché un appel à la violence. Un certain Aadesh Soni a exhorté des milliers de personnes à attaquer des villages chrétiens le 1er mars 2025. Un leader religieux influent a également incité à des actions violentes, déclarant : "Ne demandez pas la peine de mort pour les tueurs de vaches. Tuez-les et demandez la peine de mort pour vous-même. N’attendez pas que la loi agisse pour vous[149]." Heureusement, aucun événement majeur ne s’est produit le 1er mars, comme l’a indiqué Anugrah Kumar, un journaliste indien, lors de son interview avec l’ECLJ le 3 mars 2025.
Conclusion
En résumé, les lois anti-conversion adoptées au niveau des États en Inde ne visent pas à prévenir les conversions forcées, mais servent plutôt de mécanisme juridique pour intimider et criminaliser les minorités religieuses. Elles dépassent largement le cadre de la lutte contre la coercition et reposent sur un langage vague et excessivement large, utilisé pour cibler spécifiquement les chrétiens. Ces lois violent le principe de prévisibilité juridique, créent un climat de peur et sapent les garanties constitutionnelles de la laïcité et de la liberté religieuse.
Elles imposent notamment l’obligation pour les individus de notifier les autorités avant toute conversion, le transfert de la charge de la preuve sur l’accusé, des peines sévères d’emprisonnement et de lourdes amendes[150]. De plus, les autorités, y compris la police, collaborent souvent avec des groupes de justiciers hindous pour accentuer l’intimidation des minorités[151].
En fin de compte, ces lois institutionnalisent la discrimination religieuse dans le cadre juridique de l’Inde et instaurent un climat de peur pour les chrétiens.
Au-delà des implications juridiques des lois anti-conversion (qui seront examinées dans la section 7), il est essentiel de comprendre le système plus large de violence qui permet et perpétue la persécution religieuse en Inde. La section suivante analysera le fonctionnement de ce système et les engagements internationaux de l’Inde en matière de protection de la liberté religieuse.
V. Violations à l’encontre des minorités religieuses
A/ Un système de violence
La persécution des chrétiens en Inde va bien au-delà des attaques physiques et des cas individuels (cf. Section 4). Elle s’inscrit dans un système de violence plus large, qui sape leurs droits fondamentaux. Le cadre tripartite de la violence développé par Johan Galtung permet d’analyser cette persécution à travers trois formes de violence interconnectées[152]:
- Violence directe – Il s’agit des attaques physiques, telles que les passages à tabac, menaces de mort, viols et meurtres. Ces actes de violence sont clairement documentés, comme l’illustre la Section 4, où sont détaillés les attaques de foules, conversions forcées et agressions contre les chrétiens.
- Violence structurelle – Elle repose sur des inégalités systémiques ancrées dans les cadres juridiques et institutionnels. Les lois anti-conversion en sont un exemple frappant, institutionnalisant la discrimination, restreignant les droits des minorités religieuses et créant des risques légaux pour ceux qui choisissent de se convertir.
- Violence culturelle – Cette forme de violence repose sur la stigmatisation et la normalisation de la persécution, renforcées par une rhétorique nationaliste qui présente le christianisme comme une menace étrangère. Les autorités étatiques restent complices de cette narrative Hindutva, soit par leur inaction, soit par leur approbation tacite, ce qui contribue à légitimer la violence et la discrimination.
Ce système de violence tripartite crée un environnement hostile pour les chrétiens, où les lois, le discours politique et l’opinion publique s’imbriquent pour renforcer la persécution[153].
Face à cette persécution systématique, l’Inde ne respecte pas ses obligations internationales en matière de droits de l’homme, notamment les protections garanties par l’ICCPR, ICESCR, CEDAW, CRC et le CERD. Les sections suivantes présenteront certaines de ces violations en détail.
Type de Violence | Exemples en Inde |
Violence Directe | Meurtres, attaques contre des églises, agressions de pasteurs, destruction de maisons. |
Violence Structurelle | Lois anti-conversion, complicité de la police, absence de protection pour les minorités. |
Violence Culturelle | Campagnes anti-chrétiennes, exclusion sociale des convertis, privation d’accès aux aides de l’État. |
B/ Les engagements internationaux de l’Inde
L’article 51(c) de la Constitution indienne stipule que l’État doit "favoriser le respect du droit international et des obligations issues des traités […][154]".
En plus d’être membre des Nations Unies et d’être soumise à la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) dans le cadre plus large du système des droits de l’homme de l’ONU, l’Inde a ratifié plusieurs traités internationaux clés. Parmi les plus pertinents :
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR) – 10.04.1979
- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ICESCR) – 10.04.1979
- Convention relative aux droits de l’enfant (CRC) – 11.12.1992
- Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) – 09.07.1993
- Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD) – 03.12.1968
C/ Les violations[155]
Rappel concis et non exhaustif des violations.
Dans le cas présent, des meurtres, actes de torture, traitements dégradants et violences sexuelles ont été documentés à Manipur et Chhattisgarh, où des chrétiens ont été tués, torturés et agressés sexuellement. Ces actes violent l’article 6 (droit à la vie) et l’article 7 (interdiction de la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants) de l’ICCPR.
Les attaques contre les rassemblements religieux, la destruction d’églises et les lois anti-conversion constituent des violations des articles 18, 20 et 21 de l’ICCPR. L’utilisation des lois anti-conversion pour criminaliser les rassemblements religieux enfreint l’article 18, qui protège la liberté de religion. Les discours de haine encouragés par l’État, qui incitent à la violence, violent l’article 20, qui interdit la propagande de guerre et les discours haineux. Enfin, les restrictions imposées aux assemblées chrétiennes vont à l’encontre de l’article 21, qui garantit le droit à la réunion pacifique.
La discrimination envers les chrétiens dalits et les personnes déplacées constitue une violation de l’article 5 de la CERD et de l’article 26 de l’ICCPR. Le manque d’accès à la nourriture, à l’eau et à un abri pour les réfugiés et personnes déplacées chrétiennes (par exemple à Manipur) viole l’article 11 de l’ICESCR.
Les enfants subissent des pressions pour assister à des enseignements anti-chrétiens, en particulier dans les camps de réfugiés, en violation de l’article 13 de l’ICESCR et des articles 2 et 14 de la CRC.
La persécution systémique des chrétiens n’est pas seulement motivée par des forces sociales et politiques, mais elle est aussi profondément intégrée aux cadres juridiques. La persistance et l’application sélective des lois anti-conversion soulèvent des préoccupations concernant leur légalité. La section suivante analysera ces lois et expliquera comment elles violent les protections constitutionnelles de la liberté religieuse en Inde ainsi que ses obligations internationales.
VI. Le conflit entre la persécution et les obligations constitutionnelles et internationales de l’Inde
Comme mentionné précédemment (cf. III.A), l’Inde se présente comme une démocratie laïque dotée de garanties constitutionnelles pour la liberté religieuse. Cependant, les lois anti-conversion adoptées au niveau des États contredisent ces principes. Cette section analysera ces contradictions juridiques, en montrant comment ces lois violent la Constitution indienne ainsi que ses obligations internationales en matière de droits de l’homme.
A/ La légalité des lois anti-conversion de l'Inde au regard de la Constitution
La Constitution indienne consacre des protections fondamentales pour la liberté religieuse et la non-discrimination. L’article 15 stipule explicitement que « l’État ne peut exercer de discrimination envers un citoyen uniquement pour des motifs liés à la religion, la race, la caste, le sexe, le lieu de naissance, ou l’un de ces éléments[156].» De même, l’article 25 garantit que « toutes les personnes ont un droit égal à la liberté de conscience et le droit de professer, pratiquer et propager librement leur religion », tout en précisant toutefois que ce droit est soumis « à l’ordre public, à la moralité, à la santé et aux autres dispositions de cette partie » [157] [158].
Malgré ces garanties constitutionnelles, les lois anti-conversion adoptées au niveau des États entrent directement en conflit avec l’article 25, qui garantit le droit de pratiquer et propager librement une religion. Une partie du débat porte sur l’interprétation du terme "propagation", où les positions divergent nettement entre les chrétiens et les partisans de l’idéologie Hindutva[159].
Les chrétiens affirment que la propagation inclut le droit d’évangéliser et de partager leur foi, un droit constitutionnel qui protège juridiquement le commandement chrétien d’évangéliser, tel que présenté dans Matthieu 28:19-20. De ce point de vue, la conversion est une composante inhérente et constitutionnellement protégée de l’expression religieuse[160].
Cependant, les partisans de l’idéologie Hindutva affirment qu’une telle propagation interfère avec le droit des hindous de pratiquer librement leur religion[161]. Certains vont même jusqu’à assimiler la conversion à une forme de violence, affirmant :
- « Ce n’est pas simplement qu’ils [les chrétiens] prêchent leur propre religion. Ils prêchent contre les autres religions. Je considère ce genre de prédication comme de la violence. Je veux qu’ils comprennent que c’est violent. Je suis blessé et beaucoup d’autres personnes comme moi sont blessées. Des millions de gens sont blessés. »[162]
Cette perspective a influencé les interprétations juridiques, notamment dans la décision de la Cour suprême de 1977, dans l’affaire Rev. Stainislaus v. État du Madhya Pradesh. Dans cet arrêt, la Cour a rejeté l’idée selon laquelle la propagation inclurait le droit de convertir autrui, en raisonnant ainsi:
- « Il n’existe pas de droit fondamental à convertir une autre personne à sa propre religion, car si une personne entreprend délibérément la conversion d’autrui à sa religion, à distinguer d’un simple effort pour transmettre ou diffuser les principes de sa religion, cela porterait atteinte à la liberté de conscience garantie à tous les citoyens du pays. » [163]
Ainsi, la Cour suprême a établi que la liberté de conscience (de la personne convertie) prévaut sur le droit de propager une religion, et qu’il n’existe pas de droit fondamental à convertir autrui[164], ce qui revient à vider l’article 25 de son sens. La Cour a également justifié les restrictions sur les conversions religieuses en reliant les conversions forcées à des préoccupations d’ordre public[165]. Cette argumentation et la jurisprudence qui en découle sont utilisées pour affirmer la légitimité constitutionnelle des lois anti-conversion, en confondant délibérément l’acte de "propager" une religion avec celui des conversions coercitives[166].
Cependant, des experts soulignent que, dans sa décision, la Cour a ignoré l’histoire législative de l’article 25. Le terme "propager" avait été volontairement inclus dans la Constitution, précisément comme compromis destiné à garantir aux chrétiens le droit de convertir autrui[167]. De plus, la Cour a omis de définir clairement certains termes-clés comme "avantage offert" (inducement) ou "incitation" (allurement), qui étaient pourtant au cœur de l’affaire[168].
Cette omission soulève des inquiétudes quant à un biais judiciaire potentiel et à l’influence politique dans l’interprétation juridique. Le double standard est évident : les conversions chrétiennes sont traitées comme des actes de coercition, alors que les reconversions à l’hindouisme (ghar wapsi) restent exemptées de tout contrôle. Sen Ronojoy affirme ainsi que cet arrêt reflète une inclinaison historique de la Cour suprême en faveur d’un positionnement "pro-hindou"[169].
En conclusion, les lois anti-conversion adoptées par les États semblent en contradiction à la fois avec l’interprétation littérale et historique de l’article 25. Malgré les tentatives du gouvernement pour justifier ces lois, leur mise en œuvre est motivée par des considérations politiques et idéologiques, ce qui affaiblit la liberté religieuse et cible de manière disproportionnée les minorités religieuses.
B/ La légalité des lois anti-conversion de l’Inde au regard du droit international
Le droit international des droits de l’homme garantit à chacun le droit de choisir, changer ou abandonner sa religion ou ses convictions, sans crainte de persécution ni de coercition. L’article 18 de la DUDH protège explicitement ce droit en affirmant que toute personne jouit de la liberté de religion ou de conviction, incluant le droit de changer de croyance religieuse. De même, l’article 18(1) ICCPR, accompagné du Commentaire Général n°22[170], affirme le droit de toute personne « d’avoir ou d’adopter la religion ou la conviction de son choix », renforçant ainsi la liberté individuelle en matière de décisions personnelles concernant la foi.
Au-delà de la protection du droit à la conversion, le droit international des droits de l’homme garantit également le droit de persuader ou d’accompagner volontairement autrui dans leur décision d’adopter une autre religion ou croyance[171]. L’article 18 de la DUDH garantit que chacun peut manifester ses croyances religieuses par « l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites », tandis que l’article 18(1) de l’ICCPR affirme le droit de manifester sa religion ou sa croyance par « le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement ». Ces dispositions soulignent que les individus et les communautés religieuses doivent être libres d’exprimer et de partager leurs convictions religieuses.
De manière essentielle, le droit international des droits de l’homme interdit également toute coercition en matière religieuse. L’article 18(2) de l’ICCPR prohibe explicitement toute coercition susceptible de porter atteinte à la liberté d’une personne d’avoir ou d’adopter une religion ou conviction de son choix. Toutefois, les lois anti-conversion en Inde contredisent ce principe, car elles créent un environnement dans lequel les individus sont exposés à la persécution lorsqu’ils choisissent de se convertir ou de pratiquer une religion autre que l’hindouisme.
Des pratiques telles que le ghar wapsi mettent davantage en évidence cette coercition. Ces pratiques compromettent l’autonomie religieuse individuelle et démontrent ainsi que les lois anti-conversion ne sont pas seulement incompatibles avec les garanties constitutionnelles prévues à l’article 25, mais violent également les obligations internationales de l’Inde.
Malgré ces violations manifestes du droit interne et international, l’Inde n’a cessé d’échouer à traiter ces questions. L’Examen périodique universel (EPU) a appelé à plusieurs reprises l’Inde à protéger la liberté religieuse, mais le gouvernement continue de résister à ces recommandations. La section suivante analysera les conclusions de l’EPU, en soulignant le refus persistant de l’Inde d’adopter les réformes essentielles nécessaires à la protection des minorités religieuses.
VII. Recommandations de l’Examen périodique universel (EPU)
L’illégalité et l’inquiétude internationale concernant ces lois anti-conversion ne sont pas nouvelles. Cette section examine les recommandations formulées à l’égard de l’Inde lors de l’EPU de 2022, montrant que ces questions ont été soulevées auprès de l’Inde à plusieurs reprises, mais que des mesures concrètes tardent à être adoptées.
Dans sa contribution à l’EPU de 2022, l’ECLJ a souligné que l’Inde n’a soutenu aucune des recommandations essentielles concernant la liberté religieuse[172]. Cette observation se réfère aux recommandations déjà formulées lors de l’EPU de 2017, dont beaucoup demeurent encore sans mise en œuvre. Malheureusement, la situation ne s’est pas améliorée après l’EPU de 2022. Au cours de cet examen, l’Inde a reçu un total de 339 recommandations, parmi lesquelles elle en a « accepté » 221 et simplement « pris note » des 118 restantes[173].
Parmi celles dont elle a seulement « pris note », ressortent particulièrement les recommandations portant sur la « liberté de pensée, de conscience et de religion »[174]. L’Inde a choisi de n’en accepter aucune, malgré leur accent mis sur la nécessité d’adresser l’abus des lois anti-conversion et d’assurer le respect des normes internationales relatives aux droits de l’homme et des protections constitutionnelles en matière de liberté religieuse. À titre d’exemple, la recommandation 151.119 formulée par l’Irlande appelait explicitement les États indiens à abroger les lois anti-conversion qui violent les obligations internationales en matière de droits humains[175]. Ces recommandations visaient aussi à instaurer des mesures destinées à prévenir la discrimination et les violences contre les minorités religieuses, ainsi qu’à promulguer des lois pour empêcher les violences religieuses collectives ou ciblées[176].
De même, les recommandations concernant l’État de droit et la lutte contre l’impunité n’ont été que « notées » par l’Inde. Parmi ces recommandations figurent la recommandation 151.323 du Saint-Siège, qui proposait d’adopter une législation nationale complète visant à poursuivre les auteurs de violences ou de menaces contre les minorités religieuses[177], ainsi que la recommandation du Pakistan demandant que les fonctionnaires publics soient tenus responsables lorsqu’ils incitent à la haine[178]. En choisissant simplement de « prendre note » plutôt que d’« accepter » ces recommandations, l’Inde soulève des interrogations quant à son absence de volonté ou de capacité réelle à mettre en œuvre les réformes nécessaires.
Même si l’Inde a accepté certaines recommandations sur le thème de la liberté de pensée, de conscience et de religion, celles-ci étaient généralement très générales, axées sur des principes larges, sans mesures concrètes et immédiates[179]. Cette acceptation sélective permet à l’Inde de projeter une image apparente de progrès en matière de liberté religieuse tout en évitant de s’engager sur des réformes ciblées essentielles.
La non-mise en œuvre des recommandations de l’EPU a des conséquences directes pour les minorités religieuses indiennes. La discrimination systématique, les persécutions juridiques et les violences ciblées persistent sans entrave, affectant de nombreuses personnes, y compris des enfants comme Pranathi, une jeune chrétienne dalit de 8 ans. Lorsqu’on lui a demandé son ambition, elle a répondu : « Je veux devenir médecin. » [180] Son rêve est entravé par tous ces obstacles, pourtant elle garde espoir et affirme qu’elle « essaiera jusqu’au bout ». C’est aussi notre conviction à l’ECLJ, où nous continuerons à défendre ses droits[181]. Cette réalité reflète une dynamique plus large de persécution, qui dépasse les restrictions juridiques et se manifeste comme un véritable système de violence global.
CONCLUSION
A/ Violations des obligations
Les lois anti-conversion et les obligations légales
Comme examiné précédemment dans la Section 7, les lois anti-conversion en Inde sont en contradiction à la fois avec sa Constitution et avec ses obligations internationales en matière de droits de l’homme.
Lors de l’Examen périodique universel (EPU) de 2022, plusieurs États, dont l’Irlande, ainsi que le Saint-Siège, ont exhorté l’Inde à abroger les lois anti-conversion afin qu’elle se conforme à ses engagements en matière de droits humains (recommandations 151.119 et 151.121) [182]. L’Inde ne se trouve donc pas simplement face à une recommandation, mais à une obligation légale d’abroger ces lois et de se conformer aux normes internationales qu’elle a ratifiées.
Les échecs de l’Inde en matière de droits de l’homme
En rappelant la typologie des obligations tripartites en matière de droits humains, l’Inde est tenue de :
1. Respecter – Obligation de non-ingérence – c'est-à-dire s’abstenir d’adopter des lois ou des politiques qui violent directement les droits humains.
L’échec de l’Inde à respecter
L’Inde a mis en place des lois et politiques qui restreignent activement la liberté religieuse. Les lois anti-conversion violent directement le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 18 de l’ICCPR) et instaurent un environnement juridique hostile qui légitime la persécution.
2. Protéger – Obligation de protection – prévenir et remédier aux violations commises par des tiers, y compris des acteurs privés.
L’échec de l’Inde à protéger
L’Inde n’a cessé d’échouer à prévenir ou à répondre de manière adéquate aux violences contre les chrétiens, comme le montrent les cas de Manipur et du Chhattisgarh. L’inaction des forces de l’ordre et parfois même leur complicité dans les attaques illustrent l’échec de l’État à protéger ses citoyens des violences perpétrées par des tiers.
3. Mettre en œuvre – Obligation de facilitation – prendre des mesures positives pour garantir l’exercice effectif des droits humains, en promouvant, facilitant et assurant les protections nécessaires.
L’échec de l’Inde à mettre en œuvre
Plutôt que de lutter contre la discrimination, l’Inde a ignoré les recommandations ciblées et cruciales de l’Examen périodique universel (EPU) de 2022. Le gouvernement a échoué à fournir des services de base aux chrétiens déplacés et refuse de reconnaître la persécution des chrétiens dalits, les privant ainsi de protections socio-économiques essentielles.
Le traitement des chrétiens en Inde montre que l’État échoue dans ces trois domaines fondamentaux. L’Inde viole clairement ses obligations en vertu de multiples traités internationaux.
B/ Recommandations
Sur la base des conclusions de ce rapport, l’ECLJ exhorte l’Inde à prendre des mesures immédiates et concrètes pour protéger les minorités religieuses et respecter ses obligations constitutionnelles et internationales. Les recommandations suivantes définissent les réformes juridiques, politiques et d’application nécessaires pour répondre à l’aggravation de la persécution des chrétiens et des autres minorités religieuses en Inde.
Il est essentiel de rappeler que l’Inde a émis une invitation permanente à toutes les procédures spéciales thématiques des Nations Unies le 14 septembre 2011, s’engageant ainsi à accepter systématiquement les demandes de visite des rapporteurs spéciaux de l’ONU[183]. Pourtant, malgré cet engagement, la dernière visite du Rapporteur spécial sur la liberté de religion remonte à 2008. Une demande officielle de visite a été soumise le 10 juillet 2023, suivie d’un rappel le 25 avril 2024, mais l’Inde n’y a toujours pas répondu[184]. De même, le Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités fait face à un silence persistant du gouvernement indien, malgré une première demande de visite en 2018, suivie d’un dernier rappel le 18 décembre 2024[185].
Cette attitude soulève une fois de plus des doutes sur la sincérité de l’Inde dans sa volonté de traiter ces questions.
L’inaction de l’Inde ne ferait qu’accentuer son isolement sur la scène internationale, ternir davantage sa réputation de démocratie laïque, et aggraver la souffrance des communautés vulnérables.
Actions recommandées : 1. Abroger ou amender les lois anti-conversion. 2. Autoriser les visites des rapporteurs spéciaux de l’ONU demandées. 3. Respecter ses obligations constitutionnelles et internationales en matière de droits humains. 4. Enquêter et poursuivre les crimes haineux contre les minorités religieuses. 5. Mettre fin à l’application sélective des lois contre les minorités religieuses. 6. Assurer la protection des victimes de persécutions religieuses. 7. Adresser la complicité et l’inaction des forces de l’ordre. 8. Mettre un terme à la diffusion de discours de haine et à l’intolérance religieuse en engageant des poursuites contre les dirigeants politiques et les responsables publics qui incitent à la violence. |
______
[1] CNA, (2025), Christians face arbitrary arrests, grave religious freedom violations in India.
[2] Ibid.
[3] Open Doors, (2024), Persecution increases in Uttar Pradesh under harsher anti-conversion laws.
[4] The Christian Post, (2023), At least 400 acts of violence committed against Christians in India in first half of 2023: report.
[5] Open Doors, (2025), Situation of Religious Freedom for Christians, India, World Watch List 2025, p.2
[6] Population Census, (2011), Christian population in India.
[7] Open Doors, (2025), op. cit., p.2
[8] ECLJ, (2022), India UPR, §3
[9] Id., §§ 2,4
[10] ECLJ, (2022), India UPR, §2
[11] Ibid.
[12] Open Doors, (2024), India: Background Information, World Watch Research, p.3
[13] Apam Napat, (n.d.), Ahimsa and Indian culture: A journey through history, philosophy, and modern relevance, Consulté le 10 février 2025
[14] Sajib K. Banik, (2021), The development of Hindu Nationalism (Hindutva) in India in the twentieth century: a historical perspective, Philosophy and Progress, Vols. LXIX-LXX, p.213
[15] Open Doors, (2024), op. cit., p.3
[16] Manali S. Deshpande, (2010), History of the Indian Caste System and it’s Impact on India Today, California Polytechnic State University, p.3
[17] Id., pp.3, 15, 27
[18] Id., pp.16-18
[19] Id., p.29
[20] Articles 15(4) & 16(4), Constitution indienne. Exemples : Les réservations en matière de représentation politique peuvent être trouvées à l'article 330 et suivants de la Constitution.
[21] Manali S. Deshpande, (2010), op. cit., pp.3, 15, 27, 29
[22] Article 46 Constitution indienne. (Traduction littérale de l’anglais)
[23] Durani T., (29 mai 2023), Marginalized twice over: The struggle of Dalit Christians in India, Oxford Human Rights Hub., Consulté le 10 février 2025, §§ 1, 3
[24] Ibid.
[25] Open Doors, (2024), India: Background Information, World Watch Research, p.4
[26] Government of India, (n.d.), States and Union Territories, Consulté le 10 février 2025
[27] Waseem A. Sofi, (2021), Autonomy of a State in a Federation, A special case study of Jammu and Kashmir, Palgrave macmilan, State autonomy in the context of Indian Federation, p.51
[28] Government of India, (n.d.), States and Union Territories, Consulté le 10 février 2025
[29] Open Doors, (2024), op. cit., p.4
[30] Open Doors, (2024), op. cit., p.3
[31] Sajib K. Banik, (2021), op. cit., pp.224-227
[32] Library of Congress, (n.d.), State Anti-conversion Laws in India, section “III. Examination of State-Level Legislation”, subsection “D. Chhattisgargh”. Voir aussi: [entre autres], Open Doors, (2024), India: Background Information, World Watch Research, pp.14-15
[33] Open Doors, (2024), op. cit., p.4
[34] International Christian Concern, (26 décembre 2024), New data shows sharp increase in attacks on Christians, Consulté le 10 février 2025
[35] Sher A. Bukhari, (2024), The Rise of Hindutva Politics in India, Centre for Strategic and Contemporary Research (CSCR), Consulté le 10 février 2025
[36] Ibid.
[37] U.S. Department of State, (2005), Issue of Gujarat Chief Minister Narendra Modi’s Visa Status, Consulté le 10 février 2025
[38] Open Doors, (2025), Situation of Religious Freedom for Christians, India, World Watch List 2025, p.2
[39] U.S. Department of State, (2024), 2023 Report on International Religious Freedom: India, pp.1, 3
[40] HRW, (2024), World Report 2024, India Events of 2023, section “Religious Minorities, Dalits, and Tribal Groups”
[41] U.S. Department of State, (2024), op. cit., pp.1-2
[42] Id., p.5
[43] Id., p.1
[44] International Christian Concern, (25 novembre 2024), Christians increasingly face persecution throughout India, Consulté le 10 février 2025, §6
[45] Id., §§6-7
[46] Id., §7
[47] The Wire, (10 janvier 2025), 834 Attacks on Christians in India in 2024, 100 more than 2023: Rights Group, Consulté le 10 février 2025
[48] USCIRF, (2023), India, USCIRF-recommended for countries of particular concern (CPC), section “Attacks on Religious Minorities”
[49] The End Time News, (8 février 2022), Radical Hindus destroy 40-year-old Catholic center, Consulté le 10 février 2025
[50] Ibid.
[51] International Christian Concern, (7 décembre 2022), More Christians arrested in India, Consulté le 10 février 2025
[52] Ibid. (Traduction littérale de l’anglais)
[53] Ibid.
[54] The Wire, (8 août 2022), UP: Six Dalit-Christian women jailed after VHP alleges “forced conversions” at birthday party, Consulté le 10 février 2025
[55] CSW, (23 août 2022), Christian man burnt to death by his own family, Consulté le 10 février 2025
[56] Ibid.
[57] CBN News, (29 décembre 2022), Anti-Christian riots surge across 20 villages in India: 'Increasingly dangerous climate', Consulté le 10 février 2025
[58] Ibid. (Traduction littérale de l’anglais)
[59] Hindutva Watch, (22 décembre 2022), Anti-Christian riots in India surge across 20 villages: Persecution, Consulté le 10 février 2025
[60] Portes Ouvertes, (6 janvier 2023), Inde: des centaines de chrétiens sans abri, Consulté le 10 février 2025
[61] Kumar A., (11 octobre 2023), Hindutva groups are misusing UP's anti-conversion law, as police register cases with no legal standing, section “Prayagraj, Uttar Pradesh », Article 14, Consulté le 10 février 2025
[62] Uttar Pradesh prohibition of unlawful conversion of religion act, No. 3 of (2021), version anglaise p.8, §4. Voir aussi: Kumar A, op. cit., section “Behind the FIRs”
[63] Kumar A, op. cit., section “Behind the FIRs”
[64] Id., section “The Case of Pastor Paras”
[65] Act No.3 de 2021: "Toute personne lésée, ses parents, son frère, sa sœur ou toute personne ayant un lien de parenté avec elle par le sang, le mariage ou l'adoption peut déposer un First Information Report […]"
Act No. 7 de 2024, Amendement du §4: “Toute personne peut signaler une infraction aux dispositions de la loi […]”. (emphases ajoutées). Amendement, version anglaise p.20 du PDF. (Traduction littérale de l’anglais)
[66] BBC, (20 septembre 2023), Torture, rape, killings in Manipur: An Indian state's brutal conflict, Consulté le 10 février 2025
[67] USCIRF, (22 juin 2023), Violence against tribal Christians in Manipur, India, Consulté le 10 février 2025
[68] Portes Ouvertes, (12 juin 2023), Inde : comprendre les violences au Manipur, Consulté le 10 février 2025
[69] BBC, (20 septembre 2023), op. cit.
[70] New Lines Magazine, (27 décembre 2023), Meitei Christians in India’s Manipur face broad attacks, Consulté le 10 février 2025
[71] BBC, (20 septembre 2023), op. cit.
[72] Ibid.
[73] Portes Ouvertes, (19 juillet 2023), Inde (Manipur) : « Dieu a protégé mon bébé et ma vie ! », Consulté le 10 février 2025
[74] Associated Press, (23 décembre 2024), Tens of thousands displaced by ethnic violence in northeast India suffer squalid conditions in camps, Consulté le 10 février 2025
[75] International Christian Concern, (30 août 2024), Family of deceased pastor coerced to re-convert for burial, Consulté le 10 février 2025
[76] Ibid.
[77] Scroll.in, (29 janvier 2025), Why a Christian pastor was denied a burial in his own village by India’s Supreme Court, Consulté le 10 février 2025
[78] Voice of the Martyrs Canada, (14 novembre 2024), Police watch as Christians suffer mob attack, Consulté le 10 février 2025
[79] Archons of the Ecumenical Patriarchate, (8 novembre 2024), India: Police watch as mob attacks 14 Christians in Chhattisgarh, Consulté le 10 février 2025. (Traduction littérale de l’anglais)
[80] International Christian Concern, (28 décembre 2024), Hindu nationalists disrupt Christmas services throughout India, Consulté le 10 février 2025
[81] Hindutva Watch, (24 décembre 2024), Kerala: Christmas crib vandalised in school days after VHP leaders arrested for disrupting school Christmas event, Consulté le 10 février 2025
[82] International Christian Concern, (28 décembre 2024), op. cit.
[83] International Christian Concern, (28 décembre 2024), Hindu nationalists disrupt Christmas services throughout India, Consulté le 10 février 2025
[84] The Hindu, (9 octobre 2024), What does the USCIRF report say about India?, Consulté le 10 février 2025. (Traduction littérale de l’anglais)
[85] Ibid.
[86] ACLJ, (30 mars 2021), ACLJ presents at the U.N. to address religious freedom violations occurring in India and elsewhere around the world, Consulté le 10 février 2025
[87] ECLJ, (19 juin 2020), Declaration for Pastor B. Nerren and Christians in India. Consulté le 10 février 2025
[88] Ibid.
[89] Baptist Press, (4 novembre 2019), U.S. pastor stranded in India awaiting hearing, Consulté le 10 février 2025
[90] Ibid.
[91] Ibid.
[92] Library of Congress, (n.d.), State Anti-conversion Laws in India, section “II. Overview of State Initiatives”
[93] USCIRF, (2024), Country Update: India, Increasing Abuses against Religious Minorities in India, p. 1
[94] Ibid.
[95] Library of Congress, (n.d.), op.cit., section “V. Implementation and Enforcement”, subsection “A. Human Rights Concerns”
[96] Selvaraj S., (2024), Acts of Violence? Anti-Conversion Laws in India, Social & Legal Studies, p.791
[97] Ibid.
[98] Citizen Rights Protection Council, (n.d.), Uniform civil code in India, Consulté le 10 février 2025
[99] USCIRF, (2024), op. cit., p. 4
[100] Id., p. 1
[102] Code Pénal Indien (CPI), section 295 A
[103] Singh Z., (2021), Munawar Faruqui: a case study on the misuse of section 295A of the Indian Penal Code, section “3.3. The case against Section 295A”
[104] Hindustan Times, (19 mai 2022), Pastor booked in Kodagu over conversion charges, say police, Consulté le 10 février 2025
[105] Open Doors, (2024), India: Background Information, World Watch Research, p.5
[106] Id., pp.4-5
[107] International Christian Concern, (9 décembre 2024), Rajasthan set to become 12th Indian state with anti-conversion law, Consulté le 10 février 2025
[108] Ensure IAS., (2025), Arunachal Pradesh’s dormant anti-conversion law revived after 46 years. Voir aussi: Open Doors, (2024), op. cit., p.5
[109] Coleman R. J., (2007), Authoring (in)authenticity, regulating religious tolerance: the legal and political implications of anti-conversion legislation for Indian secularism, University of Pennsylvania, p.23. (Traduction littérale de l’anglais – emphase ajoutée)
[110] Certaines dispositions figurent dans plusieurs lois ; afin de préserver la concision, elles sont présentées de manière sélective.
[111] Orissa Freedom of Religion Rules, (1989), §4. (Traduction littérale de l’anglais)
“"Toute personne souhaitant changer de religion doit faire une déclaration préalable devant un magistrat […] avant ladite conversion, indiquant qu’elle entend changer de religion de son propre gré." Il est également exigé que le prêtre communique la date et le lieu de la cérémonie, ainsi que les noms et adresses des personnes concernées par la conversion (§5.1).
[112] Orissa Freedom of Religion Act, No. 2 de (1968), §§3-4
[113] The Madhya Pradesh Freedom of Religion Act, No. 5 de (2021), version anglaise p. 6. (Traduction littérale de l’anglais)
[114] Gulf News, India, (2006), Chhatisgarh passes anti-conversion bill
[115] Times of India, (2024), Chhattisgarh to bring in law to stop illegal conversions, Consulté le 26 février
[116] Gujarat Freedom of Religion Act, No. 22 de (2003)
[117] Uttarakhand Freedom of Religion, Act No.28 de (2018). (Traduction littérale de l’anglais)
[118] Uttar Pradesh prohibition of unlawful conversion of religion, Act. No. 3 de (2021), version anglaise p.8. Voir aussi: Act. No.7 de (2024), version anglaise p.20 du PDF
[119] Library of Congress, (n.d.), State Anti-conversion Laws in India, section “V. Implementation and Enforcement”, subsection “A. Human Rights Concerns”
[120] U.S. Department of State, (2024), 2023 Report on International Religious Freedom: India
[121] Id., Section “II. Status of government respect for religious freedom”, p.8
[122] ECLJ, (2022), India UPR, §6. Voir aussi: Madhya Pradesh Freedom of Religion Act, No. 27 de (1968), Section 3. (cf. n.112). (Traduction littérale de l’anglais)
[123] Id., §7
[124] U.S. Department of State, (2024), 2023 Report on International Religious Freedom: India, section “II. Status of government respect for religious freedom”, p.9
[125] Ibid. Voir aussi: The Madhya Pradesh Freedom of Religion Act, No. 5 (2021), version anglaise p.6, §12
[126] ECLJ, (2022), India UPR, §7
[127] U.S. Department of State, (2024), op. cit., p.9
[128] ECLJ, (2022), India UPR, §7
[129] Library of Congress, (n.d.), State Anti-conversion Laws in India, section “II. Overview of State Initiatives”
[130] Uttar Pradesh prohibition of unlawful conversion of religion, No. 3 de (2021), version anglaise p.8, §3.2
[131]Library of Congress, (n.d.), op.cit., section “III. Examination of State-Level Legislation”, subsection “D. Chhattisgarh”.
[132] Id., section “V. Implementation and Enforcement”, subsection “A. Human Rights Concerns”
[133] Himachal Pradesh Freedom of Religion, Act No. 5 de (2007), §4.1(b). / Act No.13 de (2019) dit “religion des parents”, §7.1(b). (Traduction littérale de l’anglais)
[134] Uttar Pradesh prohibition of unlawful conversion of religion, No. 3 de (2021), version anglaise, p.8, §3.2. (Traduction littérale de l’anglais)
[135] Chhattisgarh Freedom of Religion (Amendment), Act No.18 de (2006), §2. (emphase ajoutée). Voir aussi: Uttarakhand Freedom of Religion, Act No.28 de (2018), §3(b). (Traduction littérale de l’anglais)
[136] Voice of the Martyrs, (2024), Christians forced to “reconvert” to Hinduism, Consulté le 27 février 2025
[137] U.S. Department of State, (2024), op. cit., pp.9-10
[138] USCIRF, (2023), India, USCIRF-recommended for countries of particular concern (CPC), section “Anti Conversion Laws”
[139] U.S. Department of State, (2024), op. cit., pp.9-10
[140] Ibid.
[141] Library of Congress, (29 mars 2024), India: Assam Legislative Assembly passes Assam Healing (Prevention of Evil) Practices Bill, 2024, section “Reaction to the Act’s Passage”, §2
[142] Ibid.
[143] Library of Congress, (n.d.), State Anti-conversion Laws in India, section “V. Implementation and Enforcement”, subsection “A. Human Rights Concerns”
[144] USCIRF, (2024), Country Update: India, Increasing Abuses against Religious Minorities in India, p. 4
[145] Ibid.
[146] Uttar Pradesh prohibition of unlawful conversion of religion, Amendment, Act No. 7 de (2024), version anglaise p.22 of the PDF, (emphases ajoutées). (Traduction littérale de l’anglais)
[147] Ibid.
[148] Portes Ouvertes, (2025), Prière urgente pour les chrétiens indiens qui craignent une vague de violence, Consulté le 27 février 2025
[149] Ibid.
[150] USCIRF, (2023), India, USCIRF-recommended for countries of particular concern (CPC), section “Anti Conversion Laws”
[151] Ibid.
[152] Selvaraj S., (2024), Acts of Violence? Anti-Conversion Laws in India, Social & Legal Studies, p.800
[153] Un exemple clair de cela est le ghar wapsi, où les individus convertis au christianisme font face à des pressions et des menaces pour se reconvertir à l’hindouisme. Comme nous l’avons vu, dans un de ces cas, une famille a été contrainte de se reconvertir simplement pour pouvoir enterrer un proche décédé dans leur village.
[154] Article 51(c) Constitution Indienne. (Traduction littérale de l’anglais)
[155] Open Doors, (2025), Situation of Religious Freedom for Christians, India, World Watch List 2025. Voir aussi: Part IV du document
[156] Article 15 Constitution Indienne. (Traduction littérale de l’anglais)
[157] Article 25 Constitution Indienne. (Traduction littérale de l’anglais)
[158] ECLJ, (2022), India UPR, §4
[159] Selvaraj S., (2024), Acts of Violence? Anti-Conversion Laws in India, Social & Legal Studies, p.799
[160] Ibid.
[161] Ibid.
[162] Ibid. (Traduction littérale de l’anglais)
[163] Rev. Stainislaus v. State of Madhya Pradesh & Ors, 1977 SCR (2) 611 (India). Extrait de Indian Kanoon. (Traduction littérale de l’anglais)
[164] Ibid.
[165] Library of Congress, (n.d.), State Anti-conversion Laws in India, section “IV. Treatment by the Supreme Court”
[166] Selvaraj S., (2024), Acts of Violence? Anti-Conversion Laws in India, Social & Legal Studies, p.799
[167] Faizan M. & Sohi J.S., (2017), Freedom of Religion in India: Current Issues and Supreme Court Acting as Clergy, 2017(4) BYU L. Rev. 915, p.942
[168] Ibid.
[169] Selvaraj S., (2024), Acts of Violence? Anti-Conversion Laws in India, Social & Legal Studies, p.799
[170] United Nations Human Rights Committee, (1993), General Comment No. 22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion), CCPR/C/21/Rev.1/Add.4
[171] USCIRF, (2023), Issue Update : India’s State-Level Anti-Conversion Laws¸ p.1
[172] ECLJ, (2022), India UPR, §3
[173] OHCHR, (27 mars 2023), Human Rights Council adopts Universal Periodic Review outcomes of India, Finland, and the Philippines, Consulté le 10 février 2025
[174] OHCHR, (n.d.), Universal Periodic Review – India, 4th Cycle – 41st Session, Matrix of recommendations, “Noted”
[175] Id., Recommendation 151.119
[176] Id., “Noted”
[177] Id., Recommendation 151.323
[178] Id., Recommendation 151.88
[179] Id., “Supported”
[180] International Christian Concern, (9 novembre 2024), Against all odds: Pranathi’s journey from poverty to possibility, Consulté le 10 février 2025. (Traduction littérale de l’anglais)
[181] Ibid.
[182] OHCHR, (n.d.), Universal Periodic Review – India, 4th Cycle – 41st Session, Matrix of recommendations, 151.119 & 151.121
[183] OHCHR, (2025), Standing Invitations, India
[184] OHCHR, (2025), Country visits, India, SR on freedom of religion
[185] Id., SR on minority issues
Lire le document PDF





